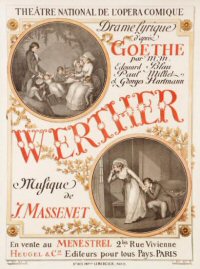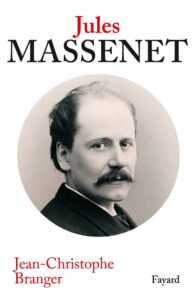Sur les quelque vingt-cinq opéras que Massenet composa, La Navarraise et Sapho sont les deux seuls dont l’intrigue soit « contemporaine ». Désormais pratiquement limité à Manon – bientôt sur la scène de l’Opéra de Paris – et à Werther, les deux titres sur lesquels repose sa renommée internationale, le compositeur fait figure d’artiste passéiste, nostalgique, replié sur un siècle antérieur au sien. Pourtant, les sentiments de ses personnages sont bien de son temps, voire atemporels ; quant à la couleur dix-huitiémiste que prend parfois sa musique, elle n’a rien de rétrograde, loin de là.
Manon et Le Portrait de Manon
Avant 1884, rien n’indique dans la musique de Massenet un intérêt particulier pour les compositeurs du siècle précédent. Pourtant, selon Gérard Condé, Manon marque la troisième étape dans l’apparition du néo-classicisme sur la scène lyrique française. Le premier jalon en est Le Médecin malgré lui, de Gounod (1857), et le deuxième, Le Roi l’a dit, de Delibes (1873). Et une fois le succès de Manon établi, Massenet continuera jusqu’à la fin de ses jours à revisiter le xviiie siècle… Lorsqu’il compose Werther, l’éditeur Hartmann loue pour lui « aux Réservoirs, à Versailles, un vaste rez-de-chaussée, donnant de plain-pied sur les jardins de notre grand Le Nôtre. La pièce où j’allai m’installer était de plafond élevé, aux lambris du dix-huitième siècle, et garnie de meubles du temps. La table sur laquelle j’allais écrire était elle-même du plus pur Louis XV ». Et Massenet s’appropria les fastes de l’Ancien Régime lorsqu’il acquit en 1899 le château d’Egreville (Seine-et-Marne), largement reconstruit après la Révolution.
Dans Manon, le pastiche de musiques du xviiie siècle joue un rôle important dans la création d’une certaine couleur locale (en l’occurrence, il faudrait pouvoir parler de « couleur temporelle »). C’est surtout vrai au troisième acte, et surtout durant le premier tableau. Cet acte était initialement introduit par un prélude festif, mais Massenet lui substitua le menuet que l’on entendait seulement ensuite, et par bribes. Lointainement inspiré de Don Giovanni, et initialement composé en 1862 pour une première cantate du Prix de Rome, ce menuet avait été particulièrement apprécié du public. Poussette, Javotte et Rosette chantent leur bref trio « La charmante promenade », qui évoque lointainement le grand siècle. Lescaut chante son air à Rosalinde, assez archaïsant. Vient ensuite le fameux « Obéissons quand leur voix appelle », gavotte douce-amère ajoutée pour Marie Roze lorsqu’elle reprit le rôle à Londres en 1885, et qui est en fait le recyclage d’une mélodie de 1880 intitulée « Sérénade de Molière », d’après un « Menuet des Comédiens du Roy » (en 1894, Massenet composa pour Georgette Bréjean-Silver, un « fabliau » lui aussi néo-xviiie siècle, avec rires en aigus piqués, qui supplanta la gavotte à l’Opéra-Comique, et que l’on chantait encore Salle Favart dans les années 1950). Le sommet dans l’art du pastiche est atteint avec les quatre entrées de ballet, lorsque Guillot fait venir la troupe de l’Opéra : Massenet y cherche clairement à « faire du Rameau », à moins que ce ne soit du Bach. Puccini devait lui-même introduire un madrigal archaïsant au deuxième acte de sa Manon Lescaut, à des fins similaires. Au profane succède le sacré pour le deuxième tableau, à l’église Saint-Sulpice : on y entend d’abord une musique d’orgue, une courte fugue tonale à trois voix. Plus tard, en coulisses, des voix chantent un Magnificat de style archaïque. Passé le troisième acte, on peut encore signaler l’air ridicule de Guillot, précédé d’un récitatif prétentieux, avec sa ritournelle qui évoque vaguement une sonate de Scarlatti.
Pourtant, ce dix-huitiémisme n’a absolument rien de décoratif : il permet à Massenet de matérialiser l’affrontement entre galanterie dérisoire et austérité patriarcale, et plus généralement entre comédie sociale et spontanéité des sentiments. « Quand on regarde par ailleurs la musique qui s’attache aux personnages, on constate que l’idiome néo-classique est en proportion inverse du degré de leur sincérité : le style d’époque est un masque pour Guillot, Lescaut, les trois amies, les Dévotes, les Aigrefins, qui parlent à la cantonade, toujours en représentation » (G. Condé). Manon chante tantôt en style néo-classique, lorsqu’elle emprunte le masque de ceux qu’elle envie, tantôt en style « moderne » lorsqu’elle exprime honnêtement ce qu’elle ressent. Des Grieux, lui, n’est jamais néo-classique car il est toujours sincère. Toujours selon Gérard Condé, « Dans Manon, le néo-classicisme est un élément essentiel de la dramaturgie musicale : il n’est pas seulement le cadre élégant dans lequel se déroule un drame cruel, il devient le symbole du factice qui persécute l’authenticité ». C’est bien pour cette raison que dans Werther, la musique du xviiie siècle est quasi absente, car tous les personnages y sont sincères (à peine si l’on peut considérer comme relevant du pastiche le Cortège célébrant les cinquante ans de mariage du pasteur, à la fin du deuxième acte, ou le « Vivat Bacchus » fugué des deux buveurs)… Dans Manon, « Le biscuit rococo s’effrite au moment même où il nous est présenté ; la pseudo-mémoire esthétisante du xviiie siècle s’abolit face à la passion intemporelle de la protagoniste » (J. Joly)
En 1894, pour l’acte intitulé Le Portrait de Manon, Massenet montre un Des Grieux vieilli, devenu baryton, accompagné de son vieux camarade Tiberge (ténor bouffe). Les amoureux sont désormais Jean de Mortcerf (une mezzo en travesti) et la roturière Aurore (soprano), idylle que voit d’un assez mauvais œil Des Grieux, tuteur du jeune homme. La musique souligne le décalage entre les deux générations, notamment en permettant à Tiberge de déclamer son dernier poème, sur un rythme de menuet (le madrigal « La rose est douce à regarder »). Dans un genre bien moins aristocratique, Jean et Aurore terminent leur duo sur une bergerette, « Au jardin, Colin ».
Du Grand Siècle à la Révolution
Avec Cendrillon, Chérubin et Thérèse, Massenet parcourt d’un bout à l’autre un xviiie siècle qui va des dernières années du règne de Louis XIV jusqu’à la tourmente révolutionnaire.
Dans Cendrillon, le Grand Siècle s’impose d’emblée, avec une musique dont le caractère solennel et grandiloquent signale clairement l’opposition entre les précieux ridicules et les personnages sincères. Alors que Cendrillon – ici appelée Lucette, prénom beaucoup plus Belle Epoque que xviiie siècle –, son père et le Prince se voient confier des mélodies typiques de Massenet, et donc « modernes », qui sont autant de sommets d’émotion, Mme de la Haltière et ses filles, toujours en représentation, sont liées au style ancien : « le néo-classicisme reste une façon de marquer la distance » (G. Condé). Le pastiche est à son comble lors du fameux Bal imposé par le conte de Perrault. Le divertissement dansé se divise en cinq numéros : Les Filles de noblesse, les Fiancés, les Mandores, la Florentine et le Rigaudon du Roi.
« Les trois tendances essentielles de la mémoire du xviiie chez Massenet : la stylisation de Manon, l’intériorisation de Werther, l’ironie du Portrait, se retrouvent dans Chérubin » (J. Joly). Dans les années 1890-1910, Mozart était très à la mode en France, et fut même le compositeur le plus représenté en 1899 à Paris. En 1859, lorsque Massenet avait obtenu son premier prix de piano au conservatoire, son professeur lui avait offert la partition d’orchestre des Noces de Figaro. En juin 1901, ayant assisté à la générale de Chérubin, comédie de Francis de Croisset, le compositeur décida aussitôt d’en tirer un opéra-comique. Le personnage de Beaumarchais n’a plus ici 13 ans, mais 17. Le choix d’une chanteuse en travesti renvoie explicitement à Cherubino et à une tradition que Richard Strauss devait à son tour prolonger avec des héros comme Octavian ou le Compositeur d’Ariane à Naxos (Massenet lui-même venait d’offrir à une voix de femme le personnage du Prince dans sa Cendrillon). L’hommage à Mozart est particulièrement évident dans les dernières mesures de cet opéra, avec une citation de la sérénade de Don Giovanni, qui transforme Chérubin en futur séducteur et la douce Nina en future Elvire abandonnée. Tout au long de Chérubin, on trouve divers pastiches dix-huitiémistes ; lors du duel du 2e acte, les violons présents sur scène jouent à la demande du héros une gavotte qui reprend en fait la mélodie de l’andantino « très rythmé, dans le vieux style » que Chérubin chantait au 1er acte : « Nous danserons, c’est bien mieux, / En dépit des modes nouvelles, / Les vieilles danses des aïeux, / Je n’en connais pas de plus belles ». Tout un programme…
Thérèse (1907) permet d’aborder la période révolutionnaire, le cataclysme qui met un terme à cet Ancien Régime qui inspira Massenet à plusieurs reprises. Déjà en 1891, la Terreur lui avait inspiré les deux mélodies avec clavecin destinées à accompagner le roman Floréal, d’Armand Silvestre (« Epithalame » et « Rien n’est que de France »). Dans Thérèse, la romance de Fabre d’Eglantine, « Il pleut, bergère », fredonnée en coulisse, inspire cette remarque : « Mais il pleut des décrets proscrivant les bergers ». Le contexte révolutionnaire fournit certes son vacarme, avec une ouverture tonitruante, et des chansons de soldats, comme dans Manon, mais l’intrigue et la distribution vocale ressemblent fort à celle de Werther : une mezzo mariée par devoir à un baryton lui préfère un ténor… Le beau proscrit s’appelle ici Armand de Clerval, et Thérèse est l’épouse d’un certain André Thorel, digne successeur d’Albert : « Si je ne t’aimais pas, serais-je pas ingrate ? […] mon devoir à moi, c’est ton bonheur », lui chante-t-elle. Lors des retrouvailles de Thérèse avec celui qu’elle aime, le ténor lui fait le coup du « Souviens-toi », en lui rappelant leur idylle de naguère, au son d’un menuet interprété par un clavecin (c’est selon Gérard Condé la première apparition de cet instrument dans un ouvrage lyrique moderne) : « Ah, le doux menuet tendre, mélancolique, le menuet de cour, le menuet d’amour par le beau soir d’été ». Ce « Menuet d’Amour » est repris par l’orchestre comme interlude entre le premier acte, censé se dérouler en octobre 1792, et le second, situé en juin 1793. Sa mélodie répétitive et lancinante cède bientôt la place à de noirs accords, tranchants comme un couperet de guillotine, couperet auquel s’offre finalement l’héroïne, dans un moment de violence paroxystique plus proche de Tosca que des Dialogues des carmélites.
Lully, Gluck et… Massenet ?
Dans sa dernière décennie créative, Massenet semble avoir voulu s’assimiler un modèle ancien, sans toutefois recourir à la démarche plus flagrante du pastiche. Catulle Mendès, librettiste d’Ariane (1906), déclarait ainsi : « J’ai eu la parfaite joie de trouver en Massenet, sans qu’il renonçât lui non plus, cela va sans dire, à sa personnalité et la technique moderne, un merveilleux Lulli, un parfait Rameau et un très parfait Gluck ». Dans cet opéra aujourd’hui bien délaissé, le compositeur laisse affleurer sa passion pour la déclamation gluckiste, et les scènes dansées rappellent Orphée. Pour les airs, Massenet a fréquemment recours à des basses rythmiques obstinées comme en trouve chez Rameau ou chez Haendel. Bacchus, deuxième volet du diptyque, prend même des allures d’opéra-ballet à l’ancienne. Au début du xxe siècle, « le culturel est entré dans le registre affectif : la grandeur, c’est Gluck, la grâce, c’est Mozart, la fraîcheur, c’est la Renaissance, le sacré, c’est Palestrina… » (G. Condé).
Menuets nostalgiques ou gavottes narquoises, pré-romantisme des sentiments exacerbés dans Werther ou musique néo-Régence guindée dans Cendrillon, échos de Mozart dans Chérubin, austérité inspirée de Gluck dans les dernières années créatrices : l’influence du xviiie siècle chez Massenet va bien au-delà du pastiche rococo de Manon auquel on l’a souvent limitée. Et la réinterprétation de modèles hérités du Siècle des Lumières est une tendance qu’il partageait avec des confrères aussi éminents que Ravel (Le Tombeau de Couperin) ou Richard Strauss (Le Chevalier à la rose, Ariane à Naxos). Du reste, notre époque, si prompte à recycler toutes celles qui l’ont précédée, jusqu’aux plus récentes, et dont la musique vraiment moderne trouve si peu d’oreilles disposées à l’écouter, n’a guère de leçon à donner aux autres en matière de passéisme.
Bibliographie :
- Branger, Manon de Jules Massenet ou le crépuscule de l’opéra comique, Metz, 1999.
- Branger, « Massenet à l’ombre de Berlioz », Hector Berlioz, Ostinato Rigore n° 21 (2003).
- Gérard Condé, « Histoire du néo-classicisme en France, de l’école de Choron au Chérubin de Massenet », J.-C. Branger et V. Giroud, dir., Aspects de l’opéra français de Meyerbeer à Honegger, Symétrie, 2009.
- Gérard Condé, commentaire musical de Manon, Avant-Scène Opéra n° 123.
- Jacques Joly, « Le XVIIIe siècle dans l’œuvre de Massenet », Manon, Avant-Scène Opéra n° 123.
Sur scène
- Manon, Opéra National de Paris, du 10 janvier au 13 février 2012 (plus d’informations)