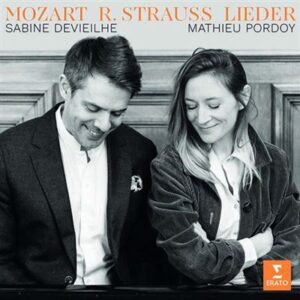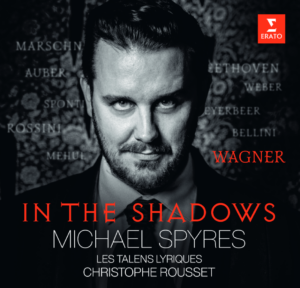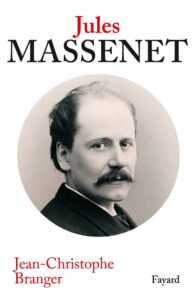Il était temps que Madame Favart rentre à la maison ! Et il s’agit d’une première, l’œuvre ayant été créée non pas à l’Opéra Comique mais aux Folies Dramatiques.
Dans cet hommage au genre de l’opéra comique, Offenbach et ses librettistes se sont inspirés, librement, de faits et de personnages réels. Charles-Simon Favart et son épouse Justine, forment un couple épanoui : il écrit des pièces, elle les interprète avec succès. C’était sans compter sur le Maréchal de Saxe qui s’amourache de Madame Favart ; pour préserver la vertu de Justine, les époux doivent fuir et c’est là que commence l’opéra. Dans une auberge d’Arras dont le tenancier cache le Sieur Favart, arrivent le Major Cotignac – qui est là pour quémander auprès du gouverneur Pontsablé un poste de lieutenant de police – et sa fille, la charmante Suzanne, suivis de près par le prétendant de cette dernière, Hector de Boispréau. Justine Favart arrive sur ces entre-faits pour retrouver son mari. Elle se fait ensuite passer pour l’épouse d’Hector auprès du libidineux gouverneur Pontsablé, afin d’obtenir pour Hector le poste de lieutenant de police et la main de Suzanne. Vous suivez ? Et nous n’en sommes qu’au premier acte, l’acte 2 voyant les deux couples intervertir leurs identités et adopter des déguisements divers pour échapper au maréchal de Saxe et fuir les assiduités de son émissaire, le gouverneur Pontsablé. Tout finira pour le mieux : La Favart obtient un triomphe devant le roi et ainsi le châtiment du gouverneur, le bonheur d’Hector et Suzanne et surtout la nomination de son époux à la tête de l’Opéra Comique.
Ce livret quelque peu décousu est surtout prétexte à d’incessants (et réjouissants) quiproquos et travestissements, Justine passant tour à tour de jeune servante, à fausse épouse, de vielle rombière à vendeuse ambulante tyrolienne.
La partition recèle bien des pépites qui nous trottent longtemps dans l’oreille après avoir quitté la salle. Après une ouverture qui alterne joyeux galop, passage plus dramatique et une flûte particulièrement rêveuse, nous sommes entrainé sans temps mort dans un tourbillon mêlant airs et ensembles, comiques ou sentimentaux. Surtout, avec une chanson campagnarde égrillarde, un duo tyrolien, des airs à base d’onomatopées, l’œuvre semble un condensé des composantes du rire chez Offenbach qu’identifiait notre collègue Jean-Marcel Humbert, ce qui explique sûrement en partie l’énorme succès (l’un des derniers pour Offenbach) que connut l’ouvrage lors de sa création.
Laurent Campellone empoigne avec visible gourmandise la partition, cravache les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris qui le suivent dans une belle griserie : cela vit, emporte, sans temps mort, au prix de menus décalages qui se règleront au fil des représentations.
Des longueurs, on pourrait en revanche en trouver quelques-unes dans les (longs) dialogues, parfois inutilement explicatifs. On comprend qu’Anne Kessler, en tant que sociétaire de la Comédie Française, n’ait pas voulu couper dans le texte. On devine également le travail approfondi de la metteuse en scène avec les chanteurs sur ces dialogues, dans la diction, le rythme, le ton. Quelques petits accrocs nous rappellent que nous sommes à la première, mais le jeu, l’intelligibilité, la précision scénique sont remarquables, au bénéfice de l’effet comique.
On sera moins sensible à quelques pas de danse redondants et surtout à un décor passe-partout. Non qu’il soit vilain, au contraire : ces galeries de part et d’autre de la scène sont élégantes mais ne sont guère utilisées et pourraient sans aucun problème être recyclés pour un tout autre spectacle. De même, pourquoi avoir situé l’acte 1 dans l’atelier de couture de l’Opéra Comique en lieu et place de l’auberge du livret ? On comprend bien ici l’évocation du thème du travestissement qui irrigue toute l’œuvre, mais cette transposition n’est au final que peu exploitée et ne sert qu’à rendre certaines répliques incongrues.
Le chant nous aura, lui, globalement comblé, surtout chez les femmes.
A tout seigneur tout honneur, Marion Lebègue embrasse le rôle-titre avec fougue. Au-delà des qualités vocales requises qui sont réelles, Madame Favart exige une présence scénique : c’est sur son abattage que repose l’essentiel de la réussite de l’œuvre. Or la jeune mezzo est la femme de la situation : accents contrefaits, chanson leste de la fille de taverne… rien ne lui fait peur ! Le léger défaut de projection au premier acte est vite oublié, et l’opulence du timbre conjugué à la gouaille de l’interprète font ici merveille. Anne-Catherine Gillet est une parfaite Suzanne. Qui mieux que la soprane belge parvient à retranscrire simultanément une certaine candeur, de l’élégance et de la juvénilité ? La voix a gardé toute sa ductilité et sa fraicheur avec une légère acidité un peu surannée qui fait mouche.
Chez les ténors, François Rougier campe un Hector un peu lourdaud. Si la voix est claire et bien projetée, on aurait aimé davantage de demi teintes ; cependant le chanteur utilise efficacement ses aigus émis en force à des fins comiques dans une tyrolienne bien acrobatique. Eric Huchet lui ne fait qu’une bouchée de Pontsablé : le personnage est fat à souhait sans que cela ait une influence sur le style chatié et la belle souplesse de l’émission.
Le Charles-Simon Favart de Christian Helmer laisse plus perplexe. La voix séduit par sa rondeur et ses teintes sombres, mais le baryton semble gêné par la tessiture tendue et les quelques allègements dans sa belle romance du troisième acte frôlent le détimbrage. En Cotignac et Biscotin, Franck Leguérinel et Lionel Peintre ont, eux, peu à chanter : par leur présence scénique ils n’en campent pas moins des personnages savoureux.
Nous n’oublierons pas le Chœur de l’Opéra de Limoges, fort sollicité tout au long de l’œuvre et qui brille par son équilibre et son intelligibilité.