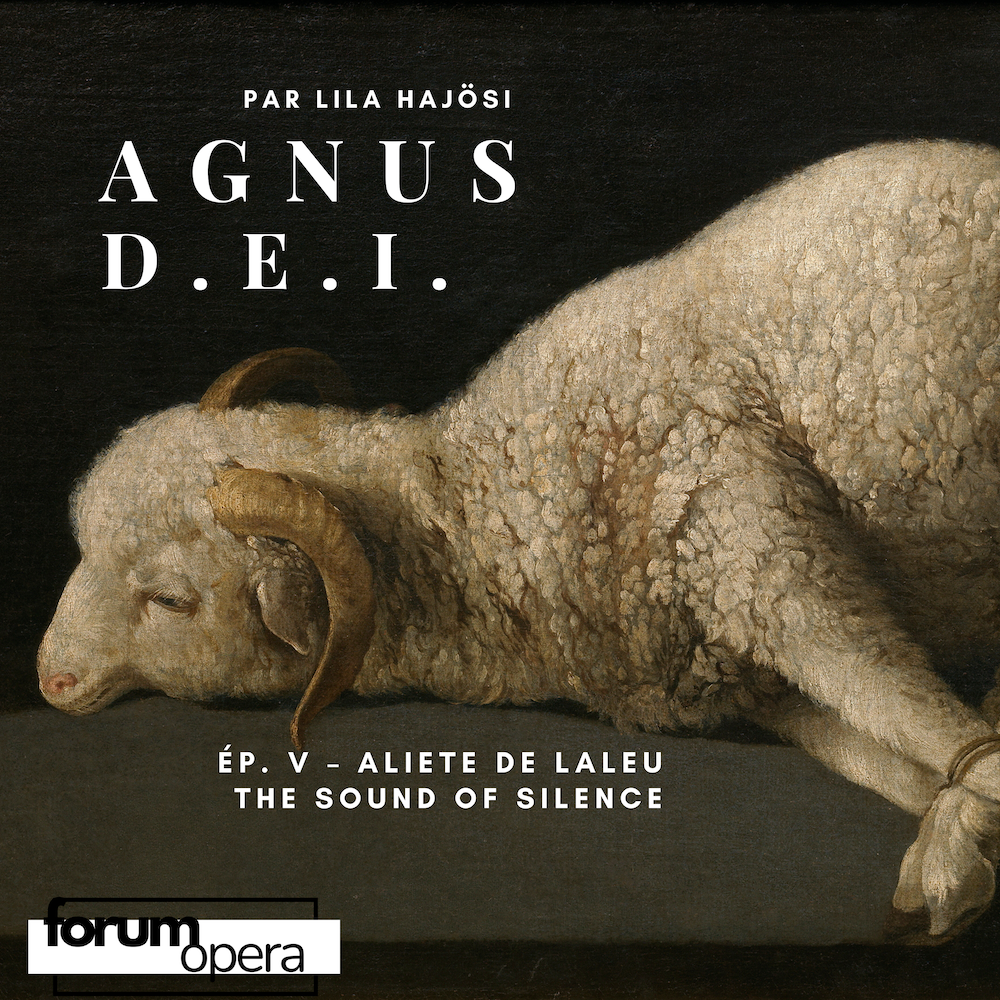Créée à Milan en 1830, Anna Bolena occupe actuellement l’affiche de l’Opéra de Bordeaux. A cette occasion, L’Avant-Scène consacre son 280e numéro à l’opéra de Donizetti. Nous en avons extrait cinq points clés pour mieux appréhender l’œuvre.
1. Ange ou démon ?
Que de mystères autour d’Anne Boleyn. Même sa date de naissance est inconnue. Née en Angleterre entre 1499 et 1512, elle fut condamnée à mort par son époux, Henri VIII, sans que l’on sache aujourd’hui si elle était vraiment coupable. Fille de Thomas Boleyn et d’Elisabeth Howard, elle fut élevée aux Pays-Bas avant de partir pour la France. Belle, pouvait-il en être autrement, il semble que la vertu n’ait pas été sa qualité première. Elle fut la maîtresse du roi de France François 1er avant qu’Henry VIII, par sa beauté alléché, obtienne qu’elle soit attachée à la reine d’Angleterre, son épouse, Catherine d’Aragon. Couverte de cadeaux et de lettres enflammées, elle sut résister à son royal soupirant jusqu’à ce qu’à bout de nerfs, il lui promette de l’épouser. Face au refus du Pape Clément VII d’annuler son premier mariage, Henry VIII abandonna la religion catholique, répudia sa première femme et convola en noces plus ou moins justes avec Anne le 25 janvier 1533. De la naissance d’une fille, qui deviendra Elisabeth 1ère, à la mort prématuré d’un garçon, Henry duc de Cornwall, en passant par plusieurs fausses couches, la nouvelle reine ne parvint pas à donner un héritier à la couronne d’Angleterre. Certains parlaient de punition divine tandis que le roi, désappointé, passait de plus en plus de temps avec la jeune Jane Seymour. Devenue embarrassante, Anne fut accusée de sorcellerie, d’adultère avec son musicien favori, Smeaton – qui avoua tout sous la torture – et d’inceste avec son frère Georges Boleyn, vicomte de Rochefort. A tort ou à raison ? This is the question. Enfermée à la Tour de Londres, condamnée à mort, elle fut décapitée à l’épée le 19 mai 1536, deux jours après son frère et mille jours après son mariage avec Henry VIII.
Cette histoire tragique devait donner naissance à deux pièces de théâtre – Anna Bolena d’Alessandro Pepoli en 1787, et Henri VIII de Marie-Joseph Chénier, le frère d’André, en 1791 – qui à leur tour, inspirèrent Felice Romani, le librettiste de Donizetti. Les libertés prises par l’opéra avec la réalité ne sont pas si gênantes dans la mesure où subsistent, comme on l’a dit, de nombreuses interrogations. L’ouvrage débute en 1536 quand Henri VIII, déjà lassé d’Anna Boleyn, courtise effrontément sa dame de compagnie, Jeanne Seymour, qu’il voudrait épouser. Cette dernière, bien que percluse de remords, ne peut lutter contre ses coupables sentiments. Pour parvenir à ses fins, le roi rappelle d’exil l’ancien fiancé de la reine, Henry Percy. La situation se tend lorsqu’Anna, par un malheureux concours de circonstances, est surprise dans sa chambre en compagnie de Percy et de son musicien Smeaton. Arrêtés, jugés, ils seront, malgré l’intervention de Jeanne Seymour, condamnés à mort et exécutés le jour des noces d’Henri VIII avec sa nouvelle épouse.
Comment ne pas compatir à ce cruel destin quand la musique de Donizetti, d’une grande hauteur d’inspiration, ferait pleurer des pierres ? Anna Bolena telle qu’elle nous apparaît dans l’opéra est davantage victime que bourreau et de ce fait, engendre une sympathie légitime. Ange, donc ? Si le compositeur semble prendre fait et cause pour la reine abandonnée, le librettiste, au moyen de quelques répliques, apparaît moins affirmatif. L’attitude d’Anna vis-à-vis de Percy – elle l’a tout de même abandonné pour suivre le roi –, son ambition, son orgueil ne plaident pas en sa faveur. A l’interprète du rôle-titre de choisir d’accentuer ou non son indéniable part d’ombre. Reste que ce refus de tout manichéisme fait la force du drame et donc son intérêt.

Anne Boleyn © DR
2. Le premier chef d’œuvre de Donizetti
En aout 1830, lorsqu’il reçoit la commande d’Anna Bolena, Gaetano Donizetti jouit d’une certaine réputation. A l’âge de 33 ans, le compositeur compte déjà 28 opéras à son actif dont plusieurs succès. Les titres de ces premiers ouvrages ne parleront qu’aux plus familiers de son œuvre. Zoraida di Granata (Rome, 1822), ou encore Elisabetta al castello di Kenilworth (Naples, 1829), ont aujourd’hui totalement sombré dans l’oubli, mais firent suffisamment de bruit à l’époque pour qu’un triumvirat – le duc Pompeo Litta, le banquier Giuseppe Marietta et le négociant Pietro Soresi – désireux de voir le Teatro Carcano à Milan supplanter la Scala, lui commandent à cette intention un nouvel opéra. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les trois hommes font appel à l’un des meilleurs librettistes du moment, Felice Romani, et à des chanteurs d’exception : la soprano Giuditta Pasta, le ténor Giovanni Battista Rubini auxquels s’ajoute la basse Filippo Galli dans le rôle d’Enrico (Henri VIII).
Un mois suffit à Donizetti pour venir au bout de la tâche qui lui a été confiée. Les répétitions débutent le 10 décembre. Il parait que le soir de la création, le 26 décembre, le premier acte fut accueilli froidement avant que le second ne remporte un triomphe qui devait perdurer les représentations suivantes. Perfectionniste, Donizetti demanda pourtant en janvier 1831 que l’ouvrage soit retiré de l’affiche pour procéder à plusieurs modifications, dont l’ajout d’un duo destiné à Percy et Anna. Ces retouches, en atténuant encore la séparation entre les différents numéros, témoignent d’une maturité artistique et marquent un jalon dans l’œuvre du compositeur. Il y a indubitablement dans l’écriture donizettienne un avant et un après Anna Bolena. L’opéra vola ensuite de succès en succès, en Italie mais aussi dans les grandes capitales d’Europe, rendant célèbre le nom de Donizetti au-delà des frontières italiennes.

Maria Callas, Anna Bolena à Milan en 1957 © DR
3. Quelle voix pour Anna ?
Comme beaucoup d’ouvrages lyriques, Anna Bolena repose pour l’essentiel sur les épaules de la prima donna, cette voix de soprano à laquelle Donizetti confia non seulement le rôle-titre mais aussi celui de Giovanna Seymour qu’une mauvaise tradition attribue aujourd’hui aux mezzo-sopranos. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si l’opéra doit sa renaissance contemporaine à une chanteuse, et pas n’importe laquelle : Maria Callas en 1957 à La Scala dans une mise en scène de Luchino Visconti. Inégalable, la « divine » devait définir le mètre-étalon à partir duquel seraient appréciées ensuite toutes les téméraires qui tenteront de lui ravir la couronne. Elles sont nombreuses pourtant, de Leyla Gencer – qui était sa doublure lors de ces fameuses représentations scaligères de 1957 – jusqu’à Anna Netrebko et, à Bordeaux cette saison, Elsa van den Heever. Le point commun entre ces différentes sopranos ? Le tempérament. Voix apathiques, cœurs tièdes, âmes suaves passez votre chemin. Il faut un chant incendiaire pour exprimer les blessures de la reine répudiée, ce mélange inédit de fierté outragée et de morbidité qui se délite dans la scène de folie finale.
La créatrice du rôle, Giuditta Pasta (1797-1865), est considérée comme la première diva romantique en raison précisément de son jeu expressif. Anna Bolena fut pensée à son exacte mesure, d’autant plus que Donizetti composa en grande partie son opéra dans la villa de la cantatrice au bord du Lac de Côme. D’après les témoins de l’époque, son timbre manquait de pureté, la justesse laissait même parfois à désirer. Tous s’accordent en revanche pour saluer son phrasé et sa manière unique d’introduire des sanglots dans son chant. Soprano vraiment ? Il semblerait que son véritable registre était celui d’un mezzo auquel elle ajoutait artificiellement les aigus, jusqu’au contre-ré. Ce type de voix est appelé aujourd’hui soprano dramatique. Il faut ici lui adjoindre le terme de « colorature », la virtuosité, l’agilité dans l’aigu et la capacité à orner son chant de multiples effets – trilles, arpèges, notes piquées, messa di voce – étant impérativement requises. Soprano dramatique colorature donc, rompue au style belcantiste et douée d’une personnalité hors du commun. Telle est l’équation complexe que doit résoudre l’interprète d’Anna Bolena pour parvenir à dessiner l’un des plus beaux portraits de femme que l’opéra nous ait donné.

Anna Netrebko, Anna Bolena à Vienne en 2011 © DR
4. Scène de la folie pas ordinaire
S’il n’y avait eu quelques glorieux précédents – Imogene dans Il Pirata de Bellini (1827) et bien avant les Orlando de Vivaldi (1727) et de Haendel (1733) –, la scène finale d’Anna Bolena aurait bouleversé l’histoire de la musique. Mais auparavant d’autres compositeurs avaient déjà prétexté la folie de leur personnage pour faire éclater le cadre de la convention. Donizetti n’est pas le premier donc. Du moins utilise-t-il le procédé avec une intelligence qui force l’admiration. A une époque où l’opéra est structuré en numéros séparés, cette scène se caractérise par une liberté formelle où alternent sans transition apparente, recitativo accompagnato, arioso et aria. De ce discours erratique mais logique, serrant ou plus près le cheminement mental de l’héroïne nait la vérité dramatique.
Une décomposition de la scène laisse entrevoir distinctement deux cantabile durant lesquels la reine insane cède à la nostalgie des jours heureux (« Al dolce guidami ») puis adresse au ciel une fervente prière (« Cielo :a’ miei lunghi spasimi »). Ces deux mouvements lents sont suivis d’une cabalette. La rupture de ton se justifie dramatiquement par le sursaut de révolte qui anime la condamnée lorsqu’elle entend au loin le son des cloches et les coups de canon célébrant l’union d’Enrico et Giovanna. Curieusement, texte et musique se mettent alors à diverger : « Couple inique, je n’invoque pas en cette heure terrible, une vengeance extrême ; dans le tombeau qui, ouvert, m’attend, je veux descendre le pardon aux lèvres… ». Sur un rythme ternaire obstiné, cinglé de notes héroïques, l’appel à la miséricorde apparaît comme une malédiction proférée à l’encontre du couple illégitime. La reine se dresse, menaçante devant ses assassins. Faut-il voir dans la dichotomie entre geste vocal et verbal un nouveau trouble du comportement ? Si oui, cet ultime coup de folie serait coup de génie.

Elsa van den Heever, Anna Bolena à Bordeaux en 2014 © Frédéric Desmesure
5. Une reine parmi les reines
Ironie de l’histoire. Alors qu’Anna Bolena périt décapitée pour – entre autres – n’avoir pas su donner un héritier à la couronne d’Angleterre, son avatar lyrique devait, lui, engendrer une longue lignée de reines britanniques appelées à son exemple, à souffrir et souvent mourir sur scène. Le succès de son opéra donna envie à Donizetti d’explorer les amours contrariés d’autres souveraines insulaires. Déjà, Elisabetta al castello di Kenilworth en 1829 voyait la fille d’Anne Boleyn, Elisabeth 1ère, disputer à Amelia Robsart les faveurs d’Alberto Leicester. En février 1834, Rosmonda d’Inghilterra raconte l’affrontement entre Eléanor d’Aquitaine, épouse d’Henry II Plantagenet, et sa rivale dans le cœur du roi, Rosamund Clifford. Un coup de poignard réglera leur différend. Avec son opéra suivant, Maria Stuarda, en octobre 1834, c’est carrément deux reines que le compositeur met en musique : Marie Stuart et de nouveau Elisabeth 1ère. Leur antagonisme se traduit par une bordée d’injures qui, à l’époque, fit frémir la censure. On retrouve Elisabeth trois ans plus tard dans Roberto Devereux. Sa funeste passion pour le héros éponyme de l’œuvre la conduit à abdiquer en faveur de James 1er.
Donizetti ne fut pas le seul compositeur à faire des têtes couronnées outre-Manche un sujet d’inspiration. Anna Boleyn occupe de nouveau le devant de la scène aux côtés de Catherine d’Aragon dans Henry VIII de Saint-Saens (1883). Toujours en avance sur son temps, Rossini avait proposé à Naples en 1815 une Elisabetta, regina d’Inghilterra qui lui avait valu un triomphe. Citons aussi une Margherita d’Anjou – épouse d’Henry VI – chez Giacomo Meyerbeer et Giovanni Pacini (1820 et 1827), ce dernier comptant également à son catalogue une Maria, regina d’Inghilterra (1843), qui n’est autre que la fille de Catherine d’Aragon. Si Henriette de France, veuve de Charles 1er, traverse rapidement Les Puritains de Bellini (1835), il appartient à Benjamin Britten de refermer cette galerie de portraits royaux avec Gloriana (1953), composée à l’occasion du couronnement d’Elisabeth II. L’image peu flatteuse renvoyée à la jeune souveraine de son ancêtre, Elisabeth 1ère de nouveau au centre d’une intrigue lyrique, choqua le public officiel et valut à l’œuvre d’être mal accueillie. A l’opéra, God doesn’t save the queen !
>> Plus d’informations sur Anna Bolena dans L’Avant Scène Opéra n° 280