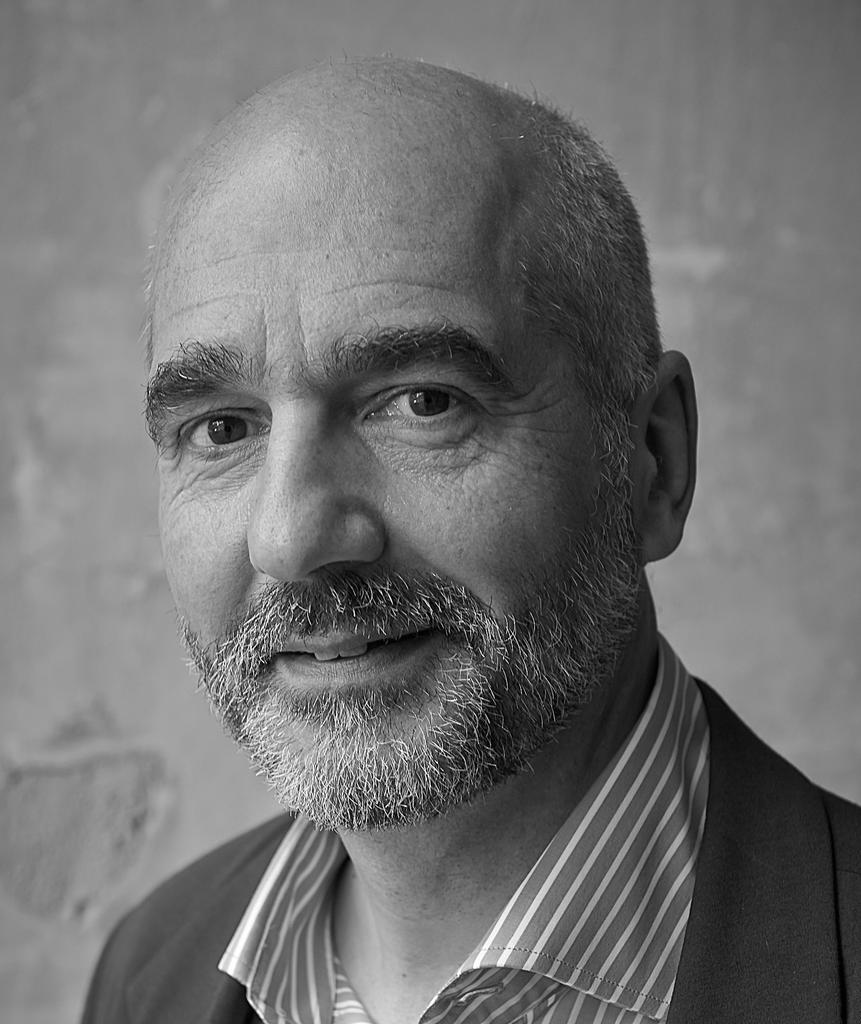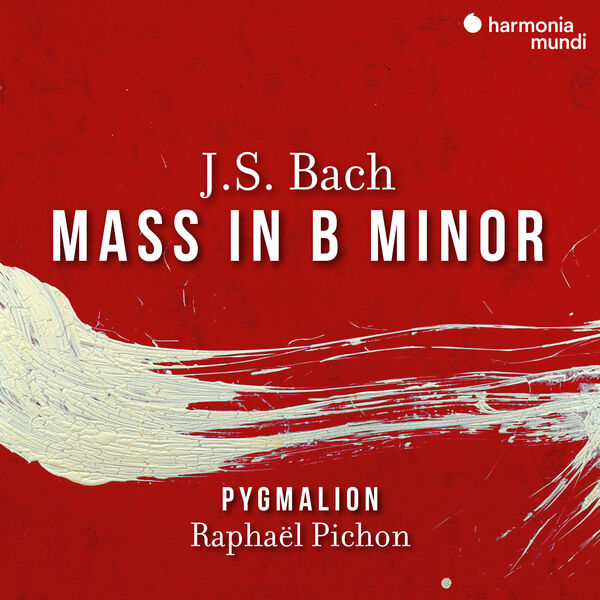Une des partitions les plus monumentales de Bach, revue et complétée dans les derniers mois de la vie du compositeur, probablement avec l’aide de son fils Johann Christoph Friedrich, la Messe en si est, par sa construction architecturée, son ampleur et sa portée spirituelle, un chef-d’œuvre absolu de la musique liturgique, toutes religions confondues.
Porté par sa parfaite compréhension du contrepoint et de l’étagement des voix, Raphaël Pichon livre ici une interprétation ambitieuse dont le ressort principal repose sur le contraste des tempi, soit très lents, soit très rapides, sans qu’on ne comprenne bien le sens de cette alternance ni le lien avec le texte, mais toujours menés avec une rigueur immuable et quasi mécanique, propre à mettre en évidence le caractère monumental de l’œuvre et la virtuosité des interprètes. Cette volonté d’introduire du relief dans la partition, pour toute légitime qu’elle soit, pourrait néanmoins reposer sur des critères plus variés, une palette de couleurs plus large, une variété dans les attaques, un continuo plus imaginatif.
Le chœur de l’ensemble Pygmalion est ici composé de trente chanteurs, six par pupitre, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est guère avantagé par la prise de son, assez lointaine, ce qui donne une impression d’espace et de profondeur sonore, mais qui ne rend pas justice à la diction ni au travail de précision, peu perceptibles ici. L’orchestre – au contraire – très en avant et particulièrement soigné, semble faire l’objet de toute l’attention du chef. Au final, l’interprétation de Raphaël Pichon paraît assez froide, la dimension liturgique est peu présente, on est loin du texte et loin de l’émotion des fidèles, ce qui est un peu étonnant lorsqu’on se souvient de la foi particulièrement humaine et bienveillante du compositeur, qui mit toute sa vie et toute sa science au service de son Dieu.
Le chœur d’entrée, Kyrie très lent et solennel, est opposé au Christe eleison, très rapide au contraire, mais qui donne aux deux solistes, Julie Roset (soprano) et Beth Taylor (mezzo-soprano) l’occasion de briller. Tempo rapide également pour le Gloria, aux limites de la capacité d’exécution des chanteurs.
Le Gratias agimus tibi, monumental, magnifique construction architecturale, suscite l’admiration, mais la solennité ne doit pas masquer l’intensité d’expression. L’expression de la foi, ce qu’on pourrait appeler aussi la ferveur spirituelle est fort peu présente.
Lucile Richardot, alto, ne séduit guère dans son premier air, Qui Sedes, voix pincée et peu épanouie.
La basse Christian Immler offre dans le Quoniam une simplicité bienvenue : la voix est puissante, l’émission très libre et l’intensité dramatique vient sans doute d’autant plus naturellement qu’il ne recherche aucun effet. La première partie de l’œuvre se termine par le chœur Cum Sancto Spiritu, vraiment précipité.
Sans passer en revue systématiquement les 23 numéros de la partition, signalons tout de même au passage l’Incarnatus est intimiste, recueilli mais curieusement dépourvu d’intensité dramatique, le Crucifixus, avec une belle âpreté dans les attaques de l’orchestre, moins dans les chœurs par manque de consonnes (encore un effet de la prise de son), les effets très spectaculaires de rapidité et de virtuosité dans Et resurexit, la qualité de l’air de basse Et in Spiritum, suivi (nouveau saisissant contraste de tempo mais cette grammaire-là devient un peu répétitive) du Confiteor très rapide.
Le monumental Sanctus fait son effet, malgré un chœur très lointain à la prononciation peu articulée.
Vient ensuite le Benedictus, un dialogue très réussi entre le ténor Emiliano Gonzales Toro et la flûte dans une belle atmosphère chambriste. Lucile Richardot semble bien plus à l’aise dans son second air, l’Agnus Dei, acmé de cette grande fresque, simple et recueilli, émouvant, parfait.
Dans le chœur final Dona nobis Pacem, le chef confirme ses choix stylistiques et sa maîtrise du sens de la grandeur et de la construction.