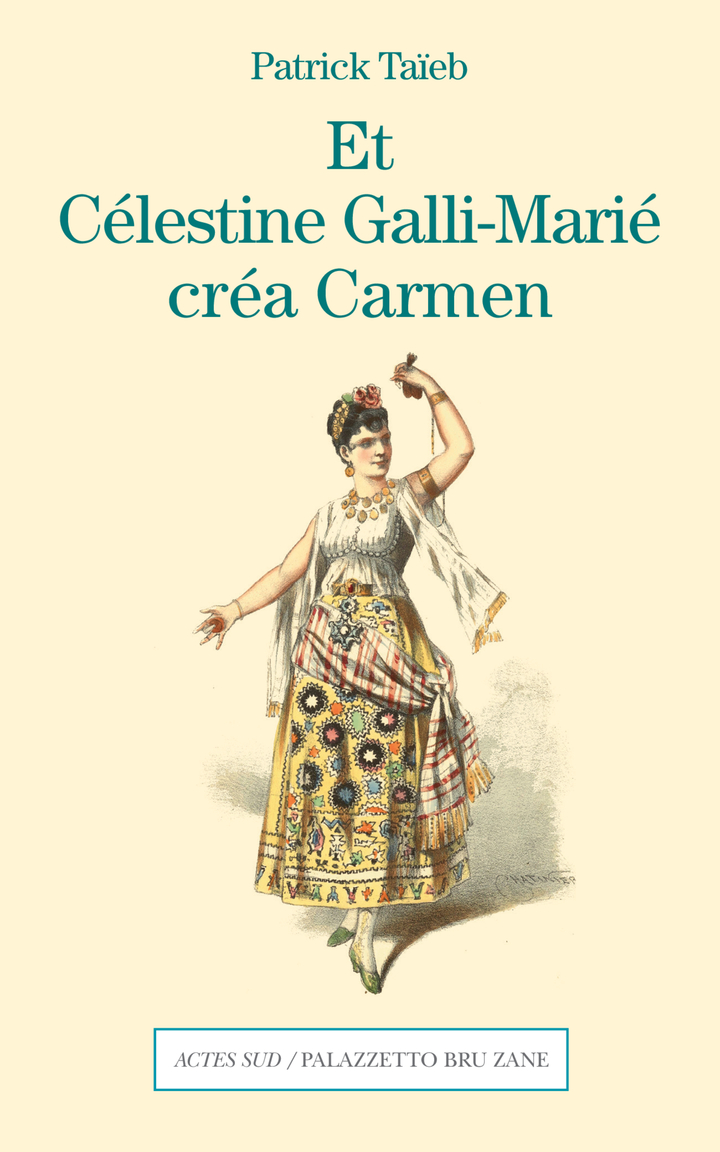Célébration de sa disparition il y a 150 ans, l’année Bizet a été généreuse en publications, le Palazzetto Bru Zane y ayant largement contribué. Dernier en date, l’ouvrage que signe Patrick Taïeb, centré sur l’extraordinaire personnalité de la créatrice de Carmen (1), se signale par sa démarche aussi originale qu’opportune. Rappel bienvenu, « une banalité (…), les opéras… sont l’œuvre de leurs auteurs, musicien et librettiste, autant que de leurs créateurs, car les premiers conçoivent leurs personnages en fonction de leurs interprètes, et non seulement de la source littéraire (…) qui les inspire » (p.23). Cet éclairage va présider à la passionnante étude dont la lecture se révèle aussi instructive que passionnante.
L’ouvrage renseigne évidemment sur la personnalité de Célestine Galli-Marié, mais aussi – tout autant – sur la vie lyrique, ses règles, ses rouages, ses acteurs, son public et ses critiques. La biographie familiale et sociale nous éclaire sur sa jeunesse, comme sur le réseau relationnel où elle s’insère. Rappelons qu’elle est née (2) dans une famille d’artistes (le père, pédagogue, fit une carrière honorable à l’Opéra de Paris, deux de ses sœurs furent artistes lyriques, une nièce à l’Opéra-Comique jusque 1914). Ainsi la formation, les débuts – avec la mise à l’épreuve du public – , la constitution et le fonctionnement des troupes sont-ils détaillés. Chaque scène fréquentée (Strasbourg, Toulouse, Lisbonne, Rouen, avant l’Opéra-Comique de Perrin) fait l’objet d’une présentation documentée. Les péripéties de sa riche carrière sont rapportées force détails. Aucun n’est indifférent. Par exemple, le personnage de la bohémienne, qu’elle aborde dès 1862. Ses rôles, les critiques consécutives, les correspondances échangées, les témoignages, tout est là. Non point tant accumulation de documents que fil d’Ariane du labyrinthe lyrique de la fin du XIXe siècle. Au fil des pages, le fabuleux répertoire alors en vogue (et que redécouvre patiemment le Palazzetto Bru Zane) se déroule sous nos yeux émerveillés.
Brune aux yeux noirs, son aspect physique est méticuleusement décrit, en miroir avec celui de ses compagnes de scène. « Forte chanteuse de grand opéra »,« plutôt comédienne que cantatrice » (3), femme de caractère, charmante et pleine d’humour, mezzo-soprano, douée pour la scène (mais aussi pianiste, peintre), d’une exceptionnelle conscience professionnelle et d’un engagement admirable (jusqu’à 70 répétitions pour Carmen), elle aura créé 17 ouvrages, dont Mignon, Robinson Crusoé, Fantasio, Don César de Bazan, entre autres, où elle a toujours le premier emploi féminin. L’altérité de Carmen, à venir, se lit déjà dans ses rôles précédents, soigneusement étudiés, comme les codes de son jeu dramatique. Lui aussi tiré de la nouvelle de Mérimée, La Fille d’Egypte, opéra-comique du neveu de Meyerbeer, sur un livret de Jules Barbier (1862), précède Carmen. Les livrets et leur source sont comparés.
Le parcours des partenaires de notre cantatrice – au premier rang desquels Lhérie (4), fait l’objet d’un suivi attentif – et anticipe ses échanges avec le compositeur concernant l’écriture vocale du rôle. On en retiendra la comparaison avec celui de Marguerite.
L’auteur a tout écouté, particulièrement les témoignages enregistrés par la nièce de Célestine, et souligne les qualités d’interprétation spécifiques à ce chant. L’analyse vocale et rythmique des ouvrages contemporains permet de souligner l’insertion de Bizet dans le tissu musical de son temps (p. 82), comme son originalité, sujet qui sera développé au chapitre XI (La vraie note de l’opéra-comique). Pour finir, un fait-divers sordide (le frère de la cantatrice a poignardé sa femme après une violente altercation, à proximité de la Rotonde) pourrait avoir influencé la réalisation du finale de Carmen… dont la reprise, en 1883, avec une héroïne assagie, fit regretter Célestine Galli-Marié.
Comme il se doit, illustrations, bibliographie et index (5) complètent cette nouvelle contribution importante à la connaissance de Carmen et de sa créatrice. L’ouvrage est savant, certes, mais il ne doit décourager ni les interprètes, ni les mélomanes, ni le plus large public : ils feront leur miel de cette passionnante plongée dans la vie lyrique française de la seconde moitié du XIXe S.
(1) La dernière édition de l’Avant-Scène Opéra consacrée à Carmen (n°318, 2020, 186 p. dédiées spécifiquement à l’ouvrage) est cruellement indigent à l’endroit de sa créatrice. (2) L’auteur, après de patientes recherches, rétablit la véritable date de naissance, le 15 mars 1837, alors que Célestine s’est employée, avec succès, à se rajeunir de trois ans... « Une femme n’a que l’âge qu’elle paraît avoir » (Vizentini, 1867). (3) « Plutôt comédienne que cantatrice, elle manie avec esprit son gros mezzo-soprano et sauve avec force d’intelligence ses défectuosités d’organes », Vizentini, 1868, cité p.153. (4) Leur duo dans Mignon et dans l’Ombre les avait déjà consacrés. (5) A signaler, l’insertion dans le texte de codes QR des partitions et enregistrements cités.