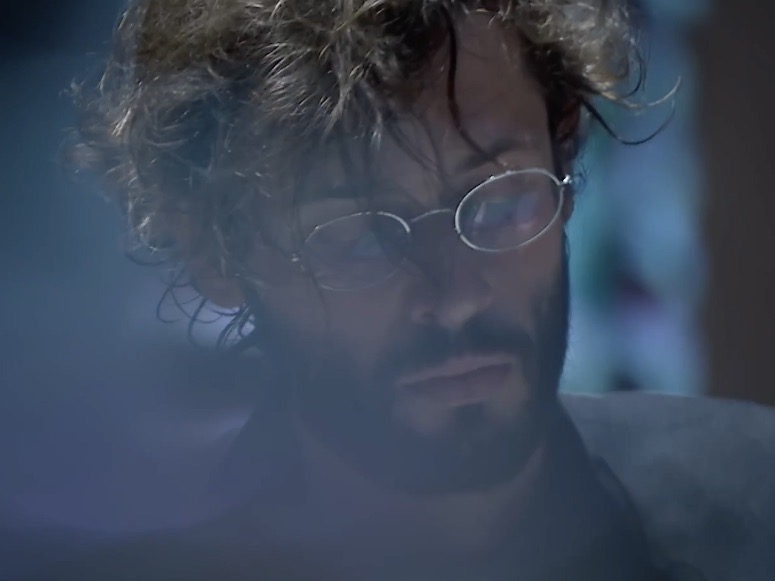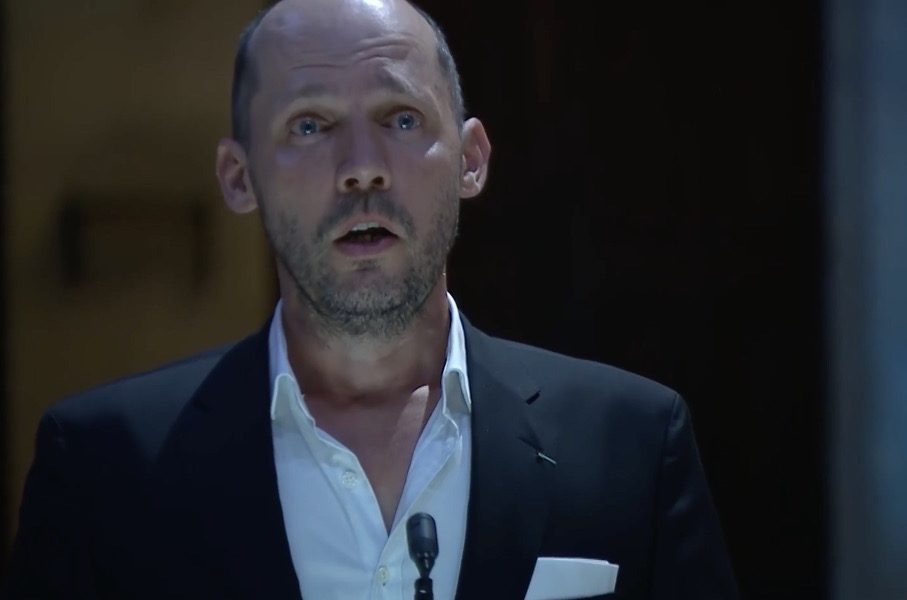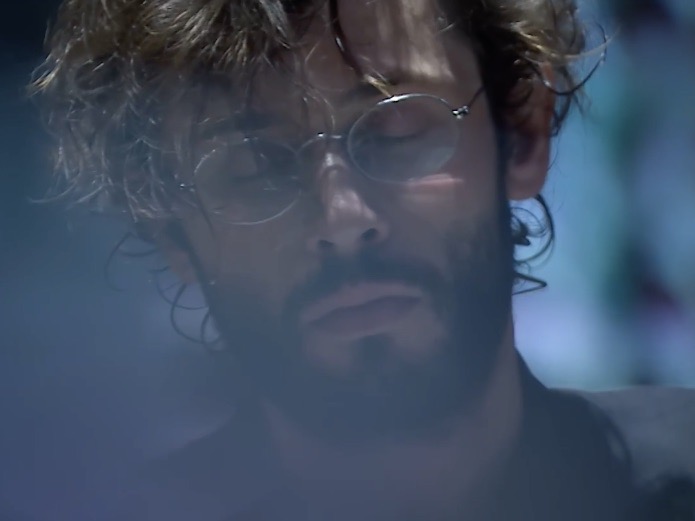Deux chanteurs très inspirés et treize musiciens fusionnels avec eux, ceux du Balcon dirigés par Maxime Pascal, donnent ici une très vibrante version du cycle de Lieder quasi testamentaire de Mahler, dans l’orchestration de Schönberg qui en met à nu l’architecture sans jamais en appauvrir les couleurs, bien au contraire, et encore moins l’émotion.
Deux chanteurs très inspirés et treize musiciens fusionnels avec eux, ceux du Balcon dirigés par Maxime Pascal, donnent ici une très vibrante version du cycle de Lieder quasi testamentaire de Mahler, dans l’orchestration de Schönberg qui en met à nu l’architecture sans jamais en appauvrir les couleurs, bien au contraire, et encore moins l’émotion.
Avant d’être un disque, ce fut un concert donné à huis-clos pour six caméras, à l’époque du confinement, dans la Basilique de Saint-Denis, le 2 juillet 2020. D’où peut-être ce mélange de confession intime et de spiritualité. Musique de chambre devant les vitraux du XIIe siècle et parmi les gisants royaux.
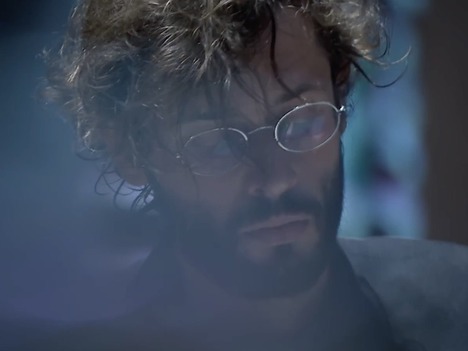
Maxime Pascal. Capture d’écran
Message personnel
« Je crois n’avoir rien fait jusqu’ici de plus personnel », écrit Mahler à Bruno Walter. C’est l’été 1908, à Toblach, qu’il travaille à ce cycle, juste un an après la mort de sa fille Maria, emportée par la diphtérie et la scarlatine le 12 juillet 1907. De surcroît un médecin vient de lui interdire tout exercice physique, randonnée ou natation, après avoir diagnostiqué une malformation cardiaque menaçant sa vie même. C’est donc enfermé dans son Haüschen, sa « cabane » des Dolomites, qu’il se consacre à sa « symphonie de Lieder », qu’il considèrera comme sa Neuvième sans prononcer le chiffre fatal, la Neuvième de fait étant pour lui la Dixième.
Un ami, Théobald Pollak, lui a offert un recueil de poésies chinoises des huitième et neuvième siècle, Die chinesische Flöte, anthologie composée par Hans Bethge (1879-1946) à partir de recueils en français ou allemand. Mahler jette son dévolu sur des poèmes parmi les plus mélancoliques, en accord avec son état intérieur : « Mein Herz ist müde – Mon cœur est fatigué », est-il dit sans ambages dans le deuxième, et Mahler fera précéder d’un silence cette phrase comme pour attirer l’attention sur elle.

Capture d’écran
Un long regard nostalgique
On pourrait rattacher le choix, finalement fortuit, de ces poèmes chinois à l’orientalisme en vogue (Pierre Loti, les estampes japonaises, Madame Butterfly, etc.), et Mahler aura recours à des gammes pentatoniques et à des timbres évocateurs d’un Orient imaginaire, mais ce qu’écrit Théodor W. Adorno (dans Le long regard ) est peut-être plus intéressant : « La jeune fille du Chant de la terre jette à celui qu’elle aime en secret de « longs regards nostalgiques ». Tel est le regard de l’œuvre elle-même, remplie d’envie et de doute, se tournant vers le passé avec une tendresse infinie : comme seul l’avait fait le ritardando de la Quatrième symphonie, mais comme le fait aussi la Recherche proustienne, parue à la même époque. Les jeunes filles en fleurs de Balbec sont les mêmes que les jeunes Chinoises qui, chez Mahler, « cueillent des fleurs ». La fin du Lied Von der Schönheit, le passage de clarinettes du début de l’épilogue – une page comme il n’en est accordé à la musique que tous les cent ans – retrouve le temps comme perdu sans retour… »
Délicatesse de Schönberg
C’est en 1920 que Schönberg écrivit pour la Société d’exécutions musicales privées de Vienne une version pour ténor, baryton et treize instrumentistes. Mahler n’avait pas tout de suite adhéré à la personnalité musicale de son jeune confrère. « Je ne comprends pas sa musique, aurait-il déclaré après l’audition de la Kammersymphonie, mais il est jeune et il a peut-être raison ». Alors que pour Schönberg la Troisième symphonie de Mahler avait été un « véritable événement intérieur ». Sa transcription du Chant de la terre témoigne d’une admiration et d’une compréhension profondes, d’autant peut-être que toute l’œuvre s’appuie sur une cellule structurante de trois notes descendantes, la, sol, mi…
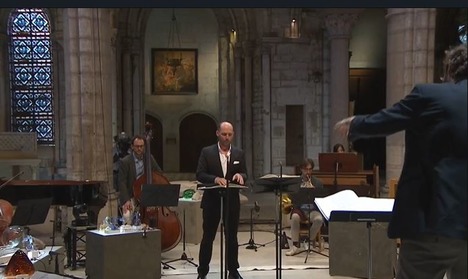
Stéphane Degout © D.R.
Un chambrisme sensuel
C’est à dessein que nous avons fait figurer dans les « détails » les noms de tous les musiciens, car précisément ce n’en est pas un. L’écriture de Schönberg établit une conversation entre les différentes voix, mettant en valeur le violon soliste, particulièrement lyrique, et même à l’occasion sentimental comme peut l’être Mahler, de You Jung Han, le hautbois pastoral et le cor anglais de Ye Chang Hung, et les clarinettes d’Iris Zerdoud. Peut-être la prise de son ne met-elle pas assez en évidence l’harmonium, dont au reste Maxime Pascal dit bien qu’il « agit toujours en complément » : « Schönberg conserve de la partition originale les voix supérieures des différents groupes d’instruments (cordes, cors…) et il confie les autres à l’harmonium », ajoute-t-il.
En tout cas, les choses sont menées de telle sorte qu’on ne ressent aucune frustration sonore. Et le mélange des cordes graves de la contrebasse, du piano, avec la percussion, parvient à créer des sonorités d’une saisissante profondeur. S’y ajoutent des instruments coloristes (le cor, le basson, la clarinette basse) et des alliages (flûte et hautbois par exemple) dont Schönberg joue avec une frémissante sensualité. Rien d’analytique et encore moins de froid dans cette réalisation, mais une poésie parfois désolée, la nostalgie d’une gamme descendante du basson, les appels boisés du cor, et surtout des chambristes qui s’écoutent les uns les autres, et une direction très fluide, dansante, qui sait suspendre le cours du temps.

Maxime Pascal © D.R.
Ajoutons qu’il s’agit d’une (superbe) prise de son multi-micros, et donc que l’équilibre et l’esthétique de ce qui est donné à entendre ici doit beaucoup beaucoup au goût et aux soins de Baptiste Chouquet (direction artistique et mixage) et de Pierre Favrez (ingénieur du son). De l’ampleur et du piqué, peu de réverbération, même si on est dans le chœur de Saint-Denis, mais beaucoup de proximité, de clarté et une cohésion très organique à la fois. De là l’impression que les instruments, tout proches, font jeu égal avec les chanteurs, et qu’ils chantent – et disent – autant qu’eux.
L’avis, qu’on peut contester, de Bruno Walter
Citons ici Bruno Walter, pour tout de suite nous inscrire en faux (avec tout le respect, etc.) contre ce qu’il affirme : « Lors de la création de Das Lied von der Erde, j’avais choisi le grand artiste Friedrich Weidemann, étant donné que Mahler me laissait le choix entre un contralto et un baryton. « Jamais plus », déclarai-je à l’époque, et depuis ce premier concert j’ai toujours choisi un contralto pour cette partie (Mme Charles-Cahier, Kerstin Thorborg, Sigrid Onegin, Kathleen Ferrier, etc.) Deux voix d’hommes ne conviennent pas à l’œuvre. Mahler n’entendit jamais Das Lied, mais je suis convaincu que s’il l’avait entendu il aurait lui aussi reconnu que c’était une erreur de confier trois mélodies à un baryton ».
Il y a une dizaine années nous avions été bouleversé par une audition en concert de cette version de Schönberg par Michael Schade et Christian Gerhaher, où l’un et l’autre faisaient des merveilles. C’était pour nous une découverte et la voix de baryton nous y était apparue comme une évidence. L’interprétation extraordinaire de Stéphane Degout nous donne ici une émotion semblable.

Kévin Amiel. Capture d’écran
Kévin Amiel rayonne
Mais d’abord saluer Kévin Amiel. Le jeune ténor se lance avec panache dans le premier Lied Das Trinklied von Jammer der Erde, chanson à boire de la douleur de la terre particulièrement tendue et exigeante, presque constamment dans les aigus. La voix est rayonnante, d’une belle ampleur, avec de l’éclat – mais aussi la couleur tragique que Mahler prête à cette pièce, pilier du cycle, dont Der Abschied sera le symétrique.
Au passage, remarquer le bel interlude instrumental et les interventions tuilées des cor anglais, violon solo, clarinette, puis piano, cor, et à nouveau cor anglais, et le retour poignant du ténor, ses interventions de plus en plus escarpées (et exposées) jusqu’à l’exacerbation du si bémol sur « in den süssen Duft des Lebens – dans le doux parfum de la vie » et à la descente vers la sentence finale « Dunkel ist das Leben, ist der Tod – Sombre est la vie et la mort aussi » qui revient pour la troisième fois, amère et presque apaisée.
Kévin Amiel pourra montrer d’autres couleurs, légères et goguenardes (mais toujours assez haut perchées) dans Von der Jugend (De la jeunesse), manière de scherzo, donnant dans la gamme pentatonique et une chinoiserie parodique préfigurant Ping, Pang, Pong. On aime la clarté du timbre sur les bavardages du hautbois, comme le pittoresque des percussions et du piano. On aime aussi un très joli mélisme sur « im Spiegelbilde ». Dans Der Trunkene im Frühling (l’ivrogne au printemps), Kévin Amiel aura à nouveau l’occasion de montrer son aisance sur les sommets (un la 3 qui revient quasi obsessionnellement) et la lumière de sa voix, mise en valeur par un rutilant habillage orchestral, le violon incarnant un oiseau printanier et l’ensemble des vents s’unissant pour évoquer le babillage d’une nature peut-être faussement joyeuse, mais en tout cas davantage que cet ivrogne qui boit pour oublier.

Stéphane Degout. Capture d’écran
Le regard intérieur
Les Lieder confiés au baryton suggèrent un autre monde de sentiments. Dans Der Einsame im Herbst (le solitaire en automne), Stéphane Degout doit utiliser toute la longueur de sa voix. Il doit souvent rester sur les hauteurs de sa tessiture, ce qui est assez inconfortable et l’on ressent d’autant plus physiquement le désespoir du paysage hivernal couvert de givre et embrumé que décrivent les vers. Degout est particulièrement en phase avec la langue et la culture allemandes, et il a cet art de savoir donner aux mots leur juste couleur. On frissonne à l’entendre dire/chanter « Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder – Un vent froid incline les tiges [des fleurs] vers le bas » accompagné par un hautbois déchirant. Après une ritournelle lointaine du violon le « Mein Herz ist müde » tombera avec une manière d’accablement, et c’est paradoxalement dans toute la plénitude et la puissance superbe de la voix que montera l’aveu de fragilité du Solitaire : « Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen – Soleil de l’amour, ne brilleras-tu jamais plus ? »
Le quatrième Lied, Von der Schönheit – De la beauté, commence dans un joyeux sol majeur, la voix comme rassérénée évoque des jeunes filles cueillant des fleurs et s’offre des brillances qu’on pressent éphémères. Car, à peine a-t-on pris plaisir au timbre du baryton, et laissé ses oreilles en jouir, que surgit dans un agitato frénétique une troupe de cavaliers qui viennent piétiner les fleurs (les fameux chevaux Tang, c’est l’époque). Degout peut montrer ici sa virtuosité et sa violence, dans un grand déchaînement de rutilances instrumentales. L’épisode s’achèvera dans des voluptés calmes et le plus doré de la voix (les couleurs sur « Sehnsucht » !) précédant un nocturne sensuel, manière de concert de bois lancé par le hautbois, comme une promesse de bonheur, qui ne sera bien sûr pas tenue.
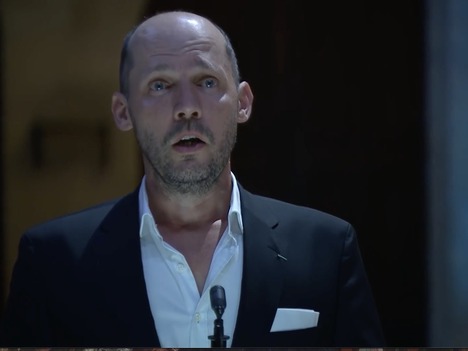
Stéphane Degout. Capture d’écran
Un temps suspendu
Enfin, voilà Der Abschied, autre démonstration de la maîtrise de Stéphane Degout, encore que le mot maîtrise soit un peu restrictif, en ce qu’il ne met en avant que le côté technique de son art, alors que c’est sur la profondeur de l’expression qu’il faudrait insister, sur son humanité, et sur les perspectives qu’il ouvre.
Longue page d’un intensité presque insoutenable, cet Adieu, lancée par le cor anglais, Degout la dit avec la plus parfaite sobriété, confiant aux longues phrases et à leur ligne impeccable le soin de transmettre l’émotion, sans pathos. Là encore, il doit avoir recours au plus haut de sa tessiture, tandis que derrière lui un hautbois évoque un monde pastoral ou que le cor lance des appels pathétiques. Radieuse plénitude du grand cri d’extase « O Schönheit, O ewigen Liebens – Lebens – trunkne Welt ! – Ô beauté l Ô monde ivre d’amour éternel et de vie » où la voix atteint des sommets d’expansion, de gravité solaire, de rayonnement.
Coups de boutoir dans le grave, plaintes du cor anglais, déchirement du cor, étirement des silences, amples respirations des voix, commentaires ironiques du cor et de la clarinette, effusions sentimentales à la viennoise des cordes, tonnerre soudain des percussions, les six minutes centrales du mouvement sont un extraordinaire moment suspendu entre sérénité et angoisse.
Puis viendra la longue fin désolée, après l’interrogation « warum es müsste sein ». Dépouillement extrême du baryton, sur les flux et reflux des vagues sonores, pour dire l’errance de l’âme cherchant l’apaisement. Grand lyrisme intérieur et grands éclats de la voix, sur un souffle inépuisable.
Jusqu’à ce que l’esprit enfin rassemblé aille reposer dans la terre bien aimée, éternellement. Ewig.
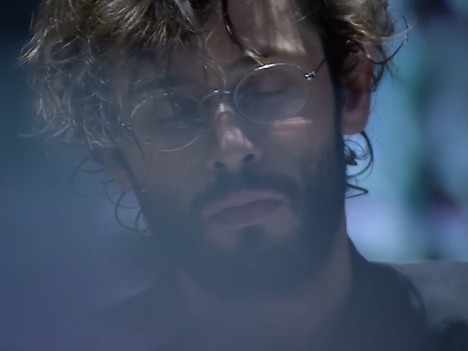
Maxime Pascal. Capture d’écran