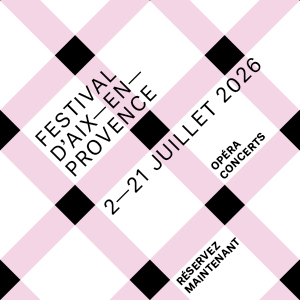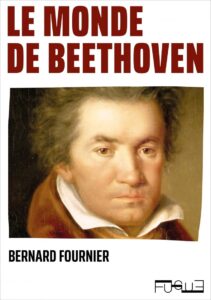À l’issue de l’avant-première jeune, la metteuse en scène Chiara Muti nous invite à découvrir le plateau de sa nouvelle production de Macbeth de Giuseppe Verdi. L’occasion d’en apprendre davantage sur sa vision de ce chef-d’œuvre du répertoire italien et sur son approche de la mise en scène, résolument ancrée dans la tradition plutôt que dans une relecture contemporaine.
« Dans la loge de… » vous plonge dans les coulisses d’une maison d’opéra, en compagnie d’un(e) artiste qui vous fait découvrir l’envers du décor en un seul plan-séquence.