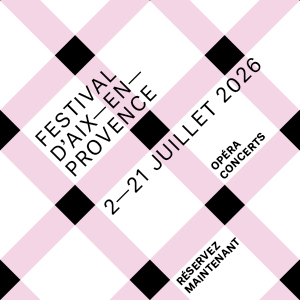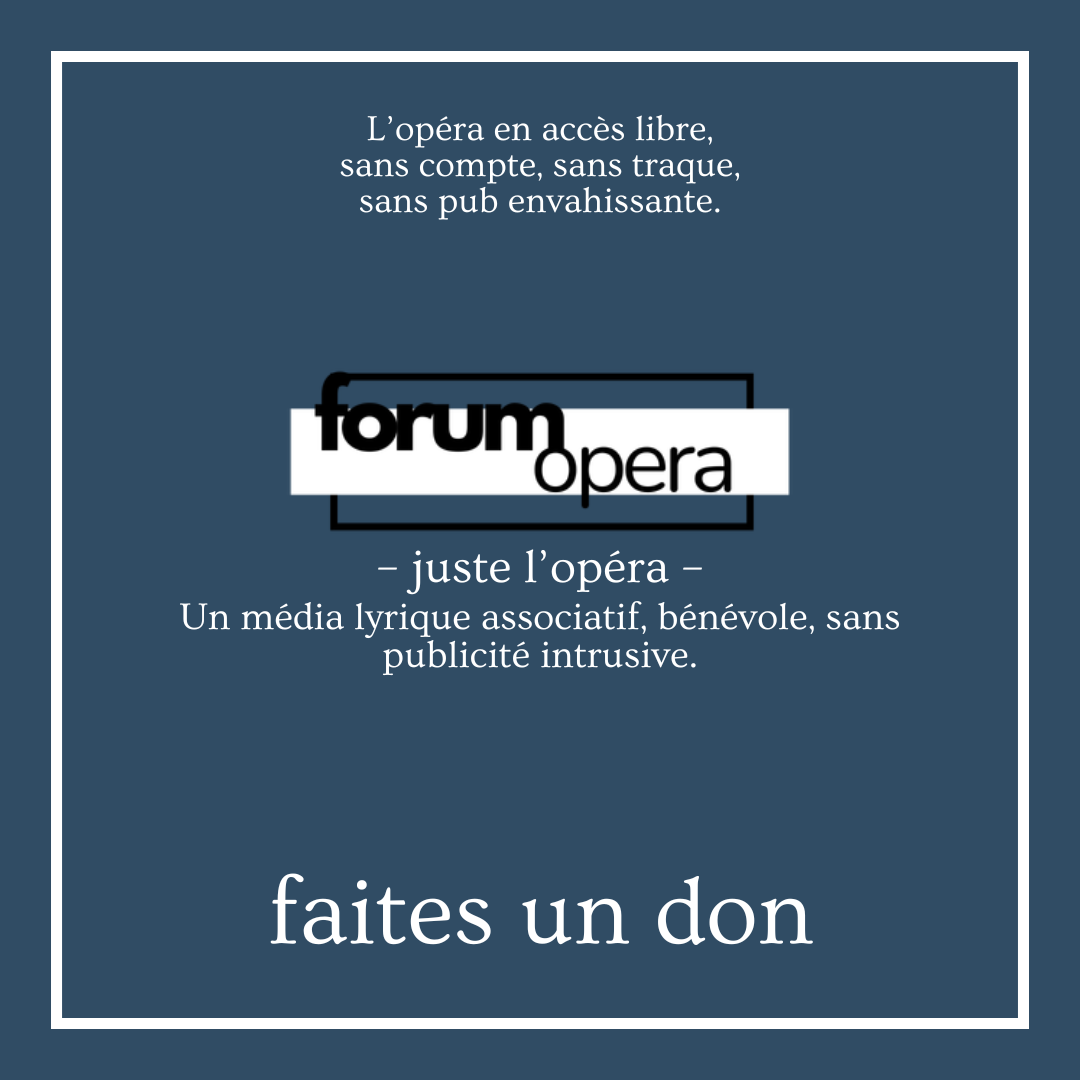Brouillon auto
Partager sur :
22 février 2026
- Œuvre
- Auteur
- Compositeur
- Editeur
- Labels
- Lieu
- Saison
- Orchestre
- Artistes
Commentaires
VOUS AIMEZ NOUS LIRE… SOUTENEZ-NOUS
Vous pouvez nous aider à garder un contenu de qualité et à nous développer. Partagez notre site et n’hésitez pas à faire un don.
Quel que soit le montant que vous donnez, nous vous remercions énormément et nous considérons cela comme un réel encouragement à poursuivre notre démarche.
- Œuvre
- Auteur
- Compositeur
- Editeur
- Labels
- Lieu
- Saison
- Orchestre
- Artistes
Nos derniers podcasts
Nos derniers swags

Plus qu’un témoignage, une somme capitale
LivreSWAG
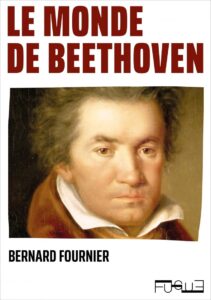

Les dernières interviews
Les derniers dossiers
Zapping
- 21 février 2026
- 17 février 2026
- 15 février 2026
Vous pourriez être intéressé par :
Il n’avait pas attendu que Gérard Corbiau le campe en « maître de musique » pour apparaître, dans son chant, dans son art, comme une référence, modèle de probité et de force. A quoi reconnaît-on un tel magistère ? Non aux postures ni aux maximes, mais à ceci : lorsqu’il avait chanté, il semblait qu’il n’y eût plus qu’à méditer et se taire.
Pene Pati est l’Edgardo de la Lucia incarnée par Jessica Pratt à Toulouse. Ils reconstituent un duo qui avait triomphé à Naples en 2022 dans Lucia di Lammermoor. Rencontre à cette occasion avec le ténor samoan qui nous parle de sa jeune carrière et de sa vision du chant.
La Boesmans Wave 26 va déferler sur Bruxelles !
Le jeune chanteur australien vient de triompher dans le rôle du Wanderer à l’Opéra de Paris. En mars, il sera John Claggart à l’Opéra de Lyon.
[themoneytizer id="121707-28"]