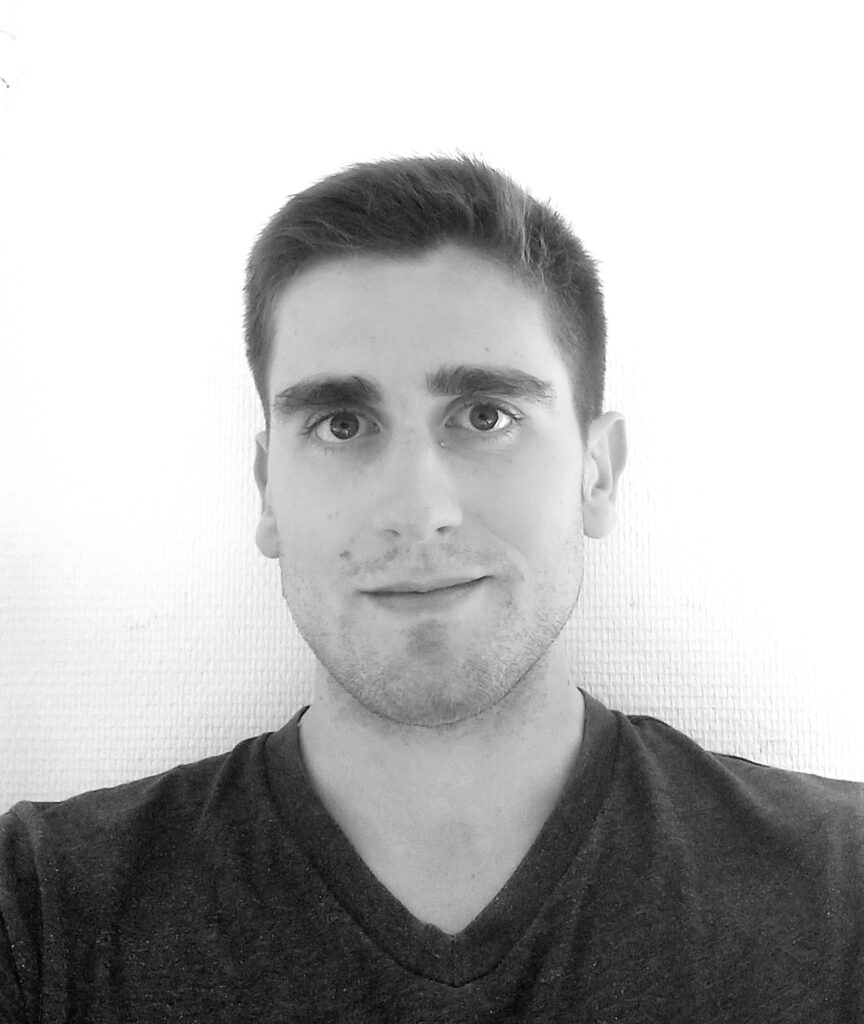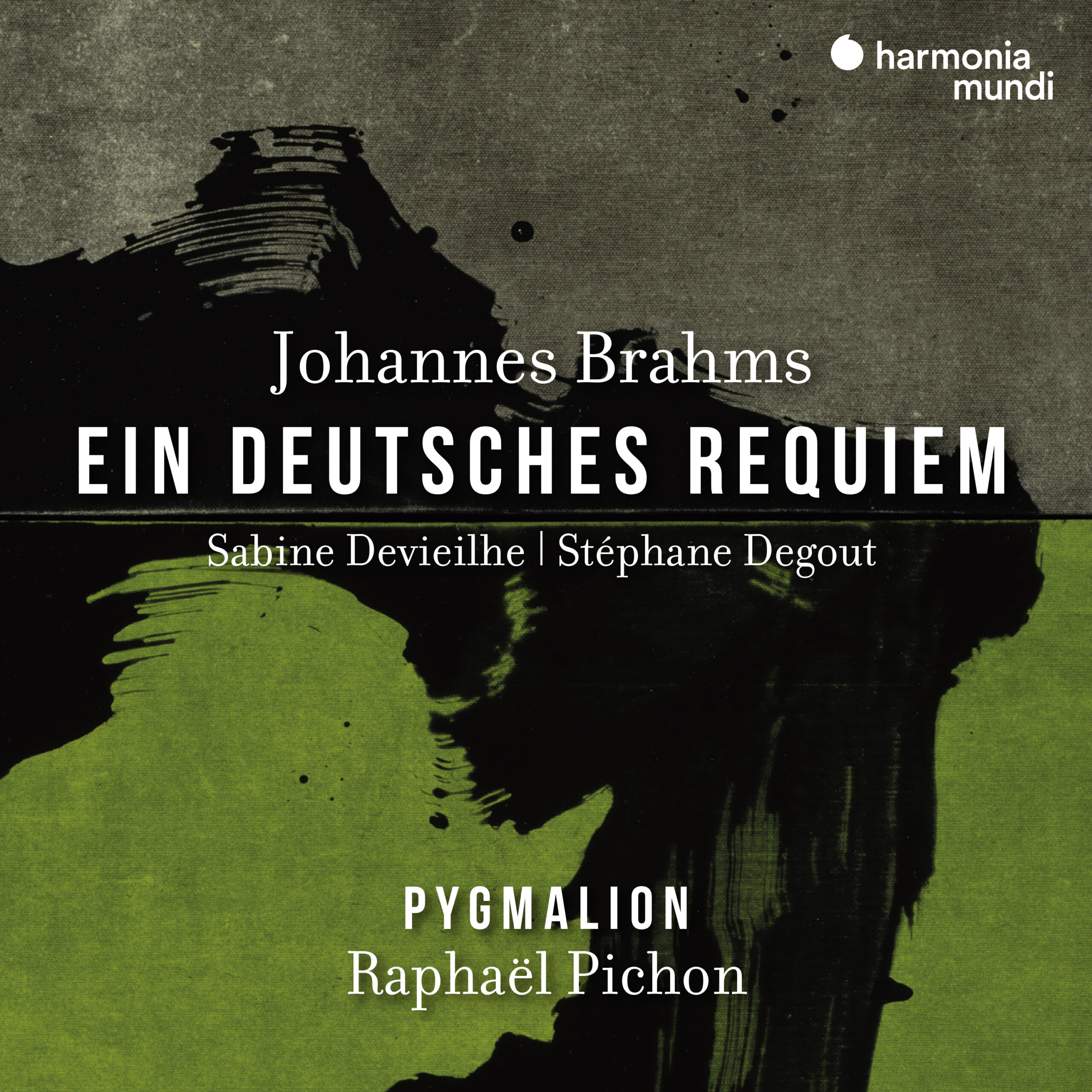Dès l’ouverture aux scansions très noires de violoncelles et de contrebasses, sur lesquelles se greffe un chant plein d’une lumière douce mais indéniablement crépusculaire, on est frappé par l’amplitude du geste orchestral et l’art de colorer les atmosphères sonores – des qualités qui font de ce deutsches Requiem par l’ensemble Pygmalion et son chef Raphaël Pichon un petit miracle de densité spirituelle et de beauté. L’entrée du chœur dans cette première section (« Selig sind die da Leid tragen »), quand l’orchestre s’est tu, est simplement poignante, son tempo suspendant légèrement celui de l’introduction orchestrale, la texture vocale se déployant en douceur avec très peu de vibrato, un son très concentré mais de plus en plus étoffé qui explore les différents stades de la ferveur. À la fin de cette première section, pour le retour du thème initial, le chœur trouve un son irréel, proche du murmure mais très aérien et serein, quelque chose qui évoque un harmonica de verre qu’effleurerait le chef. Le tout est magnifiquement soigné, dans une osmose irréprochable à l’intérieur de chaque pupitre et entre l’orchestre et le chœur, avec une prononciation consciencieusement travaillée et des dynamiques franches.
Le ton est donné pour l’ensemble d’un enregistrement qui vous saisit par la profondeur de sa simplicité et par sa ferveur très juste, jamais forcée. On a beaucoup écrit sur ce requiem qui n’en est pas un au sens de la liturgie, qui se veut un requiem humain, tissé à partir de textes bibliques de différentes natures que Brahms a assemblés à la manière d’un patchwork ou d’un centon littéraire. On voit la proximité entre ce matériau composite et de récents projets qui ont occupé Pygmalion : le Requiem de Mozart augmenté de diverses pièces ou le Samson de Rameau recréé avec Claus Guth. Si on ajoute à cela que Brahms lorgne sans conteste du côté d’une musique (celle d’un J.-S. Bach) qui a été le cœur de répertoire de l’ensemble, on comprend aisément les affinités qui ont conduit Pygmalion au Requiem allemand. Pichon y trouve de toute évidence les ressources d’une spiritualité émouvante, d’un sacré aux proportions de l’homme et de son doux drame terrestre. Sa lecture très conduite s’impose avec force, avec drame mais surtout avec recueillement.
Le duo mystique des timbales de Koen Plaetinck et de la harpe de Marion Sicouly font merveille dans le deuxième mouvement, qui voit aussi le chœur se saisir avec une joie non dissimulée de la première fugue d’une œuvre qui témoigne d’un art redoutable du contrepoint et plus largement de la polyphonie. La cauda triomphante de cette section prend des accents de célébration haendélienne qui témoigne de la plasticité du chœur.
Stéphane Degout propose des interventions très déclamatoires et malgré tout émouvantes dans la façon qu’il a de jouer de menues inflexions (comme cette reprise piano de son imprécation « Herr, lehre doch mich » dans le troisième mouvement). La noblesse de son émission, le tranchant de son timbre tirent son baryton du côté du récitant d’oratorio, notamment dans la sixième section où il incarne un Paul prophétique s’adressant aux gentils pour formuler la promesse de la résurrection. Cette section est sans doute le morceau de bravoure de l’enregistrement, tant elle exige de couleurs, de ressources dramatiques, de sincérité du soliste, de symbiose du chœur, de ferveur mystique puis de joie pour l’allegro final en do majeur.
Sabine Devieilhe dialogue magnifiquement avec les hautbois, flûtes et clarinettes, dans un quatuor angélique au début du cinquième mouvement « Ihr habt nun Traurigkeit ». Son soprano est très incarné malgré le splendide timbre translucide qu’on lui connaît et, par son engagement, elle rend à son intervention sa dimension d’adresse. On entend une saynète emplie du poids d’une promesse maternelle, presqu’une berceuse consolatrice et non une simple voce dal cielo. Le murmure très aéré qui achève la pièce (« ich will euch wieder sehen ») est empli d’une ferveur qu’on trouve teintée d’une nuance de fragilité absolument bouleversante.
Jusqu’à son finale (« Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben ») plein d’espoir et de pardon, porté par un chœur en état de grâce et par le retour émouvant de la harpe pour une ultime élévation consolante, cette version du Requiem allemand de Brahms entremêle ombre et lumière dans un vacillement perpétuel qui trouve le chemin d’un recueillement sobre mais puissant. Il va de soi qu’on gardera précieusement cet enregistrement qui s’installe aux sommets d’une discographie pourtant fournie.