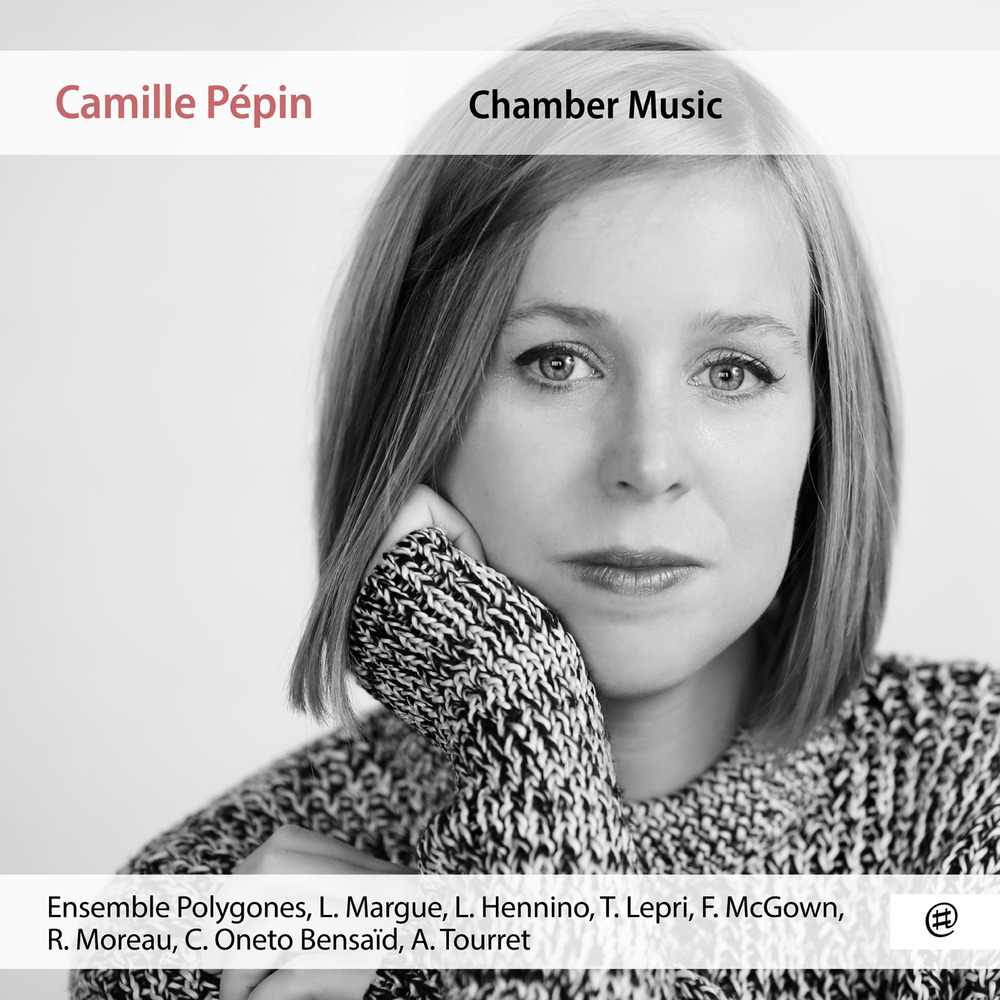Dans un livre récemment consacré aux Compositrices, elle est la benjamine du groupe, puisque née en 1990. Même pas trentenaire, Camille Pépin n’en est pas moins déjà en train de s’imposer dans la cour des grands : l’Orchestre national de Lyon créera prochainement une de ses œuvres, et elle bénéficie régulièrement de commandes prestigieuses.
Si le premier enregistrement commercial de sa musique porte un titre en anglais, ce n’est pas du tout pour se donner un genre. Certes, il inclut exclusivement de la musique de chambre, mais là n’est pas la raison ; non, si le disque que vient de faire paraître le label NoMadMusic s’intitule Chamber Music, c’est parce que c’est là le titre de ce que Camille Pépin considère elle-même comme la « pièce maîtresse » du CD, un cycle de mélodies d’une durée d’une demi-heure, d’après les poèmes écrits par le tout jeune James Joyce et publiés en 1907, deux ans avant Dubliners. Parmi les 36 poèmes du recueil, la compositrice en a retenu exactement la moitié. Joyce lui-même estimait que certains de ses textes étaient « assez jolis pour être mis en musique », et ils avaient déjà inspiré des compositeurs aussi divers que Barber, Szymanowski, Berio, pour ne citer que des compositeurs « savants ». La première incursion de Camille Pépin dans le domaine de la voix était un groupe de Sonnets – Hommage à Henri Dutilleux ; depuis Chamber Music, elle a également conçu des Dancing Poems pour mezzo-soprano, violoncelle et piano.
Lorsque l’on apprend qu’elle a été au Conservatoire de Paris l’élève de personnalités comme Thierry Escaich ou Guillaume Connesson, on devinera que Camille Pépin a choisi de s’inscrire dans une certaine tendance qui tourne plus ou moins le dos à l’avant-garde dure du siècle dernier. Sa musique n’a rien d’agressif, rien d’hostile pour les oreilles, elle est tout à fait tonale. Si on devait lui trouver des ancêtres directs, on avouerait qu’elle sonne parfois comme du Michael Nyman, sans doute à cause du recours fréquent au martellement de rythmes obstinés, et l’on croit parfois entendre la bande-son d’un film de Peter Greenaway. Le choix des instruments rassemblés pour ce cycle de mélodies mérite qu’on s’y arrête : aux côtés des habituels piano, violon et violoncelle se placent la clarinette et le cor, avec des couleurs moins fréquentes, encore que Britten – autre ancêtre possible ? – ait tiré d’intéressants effets de l’association entre cor et voix).
Quant au traitement de la voix, il s’avère tout à fait respectueux du gosier humain, en l’occurrence celui de Fiona McGown, que l’on a pu entendre dans Le Nain de Zemlinsky, à Lille et à Rennes, et plus récemment dans La finta pazza présentée à Dijon et à Versailles. Le timbre est beau, et s’envole sans peine dans l’aigu pour certains passages plus vocalisants. Une des originalités de Chamber Music est d’associer parlé (non pas du Sprechgesang, mais du véritablement parlé) et chanté : on croit d’abord à une alternance immuable, un poème déclamé, un poème chanté, mais la formule s’assouplit bientôt, certains textes démarrent en parlé puis basculent dans le chanté, parfois pour revenir au parlé en fin de parcours. La plupart du temps, les pièces s’enchaînent sans solution de continuité, formant comme un grand tout.
Le reste du programme se compose de musique de chambre non-vocale, de la pièce pour un instrument soliste comme Kono-Hana (violoncelle seul), pour violon et piano comme Indra à des œuvres réunissant cinq instrumentistes sous la direction du chef Léo Margue, comme Lyrae et Luna. On y retrouve le climat frénétique de certaines mélodies de Chamber Music, qui rappelleront à certains la musique de film, mais aussi des réminiscences des grands quatuors et quintettes français du début du XXe siècle. A d’autres moments, une atmosphère de dépaysement quasi-orientaliste s’installe, au début de Luna, notamment, ou dans Kono-Hana.
De toutes ces influences qu’il est possible d’identifier, se dégage-t-il vraiment une voix nouvelle ? Peut-être est-il encore trop tôt pour le dire, mais on espère bien que l’avenir le confirmera.