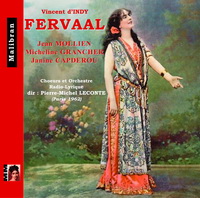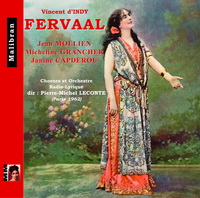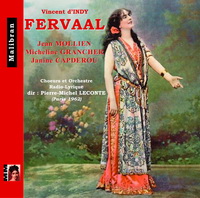Ressusciter des partitions tombées dans l’oubli, c’est formidable. Faire découvrir des compositeurs dont le nom même n’est plus connu que de quelques spécialistes, c’est une excellente idée. Evidemment, on n’exhume pas toujours des merveilles, mais c’est une tâche infiniment louable. Pourtant, il y aurait peut-être encore mieux à faire : donner les chefs-d’œuvre avérés mais qu’on ne joue jamais. Et Fervaal est incontestablement de ceux-là. Vincent d’Indy a composé là une partition puissante, séduisante, enthousiasmante, totalement wagnérisée et pourtant française.
Qui pourrait croire que cette œuvre n’a jamais été remontée sur scène, absolument nulle part, depuis les représentations de 1912 à Garnier ? On sait que l’Opéra de Berne en donna deux exécutions de concert en mai-juin 2009, mais depuis, plus rien. Ce serait à devenir fou s’il n’y avait pas à ce silence assourdissant des raisons assez évidentes. Fervaal est une œuvre lourde à monter, qui exige un très grand orchestre, des chœurs, avec de nombreux personnages et de solides exigences théâtrales. Le « poème », dû à D’Indy en personne, est un peu casse-gueule, tant il sonne parfois daté, mais il en faudrait plus pour faire peur aux metteurs en scène d’aujourd’hui, habitués à transposer dans des parkings souterrains les actions les plus héroïques et les plus surnaturelles. Non, le vrai problème de Fervaal, c’est la distribution vocale qu’il appelle : le rôle principal féminin, mélange de Kundry, d’Isolde et de Vénus, est conçu sur un format authentiquement wagnérien, et le héros, sorte de Parsifal-Tannhäuser-Lohengrin, appelle également un véritable heldentenor. La déesse Haïto est une autre Erda, et le druide Arfagard est un baryton aussi à l’aise dans l’aigu que dans le grave.
Face aux terribles difficultés que présente l’ascension de telles altitudes lyriques, la RTF sut pourtant, en 1962, rassembler des noms sur lesquels personne, à tort, ne parierait aujourd’hui, mais qui parviennent admirablement à faire vivre Fervaal et à nous le faire aimer. Bien sûr, la partition qu’on entend est criblée de trous, un vrai gruyère, à commencer par l’amputation pure et simple du prologue et de la scène 1 de l’acte I (soit les 70 premières pages dans l’édition piano-chant qui en compte 390 !), mais qu’importe, ce qu’il reste de l’intrigue se suit malgré tout, et peut-être même ces coupes rendent-elles parfois l’oeuvre plus digeste. Bien sûr, on pourrait rêver d’une prise de son de studio moderne rendant mieux justice à la vigueur de l’orchestration, mais Pierre-Michel Leconte dirige avec conviction une formation qui n’était certes pas la plus raffinée, et il a de la fougue à revendre.
Là où il n’est pas certain qu’on puisse faire mieux de nos jours, c’est pour les voix. Micheline Grancher est à présent bien oubliée, et c’est une injustice criante. Décédée l’an dernier, cette soprano avait à son répertoire Mélisande mais aussi Elisabeth de Valois, Elsa ou Madame Lidoine, et bien des théâtres rêveraient à présent de pouvoir compter sur une voix aussi large et bien timbrée, à la diction exemplaire. Jean Mollien est un nom qui revient fréquemment dans les distributions de concerts de la radio française dans ces années 1950 et 1960, mais on l’entend rarement dans des rôles de premier plan : quelle injustice ! Plus souvent entendu dans des rôle légers, le ténor interprète ici un personnage qui ne le ménage à aucun instant, presque toujours au-dessus de la portée et s’élevant régulièrement au si bémol ou naturel. Pierre Germain peut d’abord sembler un peu clair, mais le druide Arfagard n’est pas Gurnemanz, et le baryton a toute l’autorité nécessaire à imposer sa présence paternelle. Surtout connue pour des enregistrements d’opérette, mais grande Dalila, Janine Capderou est superbe en Haïto. Donc, ne cherchez plus le chef-d’œuvre méconnu de l’opéra français : il est là, dans une interprétation partielle mais splendide. Et maintenant, quand verra-t-on Fervaal sur une de nos courageuses scènes nationales qui nous révèlent depuis quelques années des titres trop peu fréquentés ?