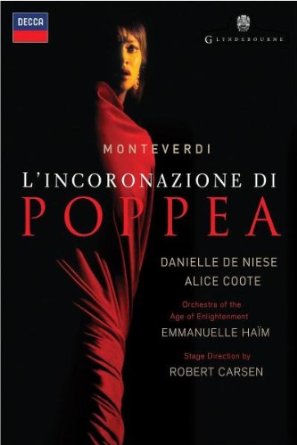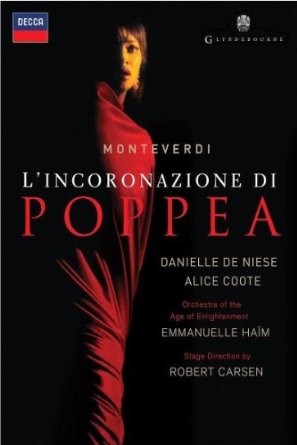Modeste dans son air, débauchée dans ses mœurs,
Elle sortait peu, et toujours le visage demi-voilé
pour laisser quelque chose à désirer aux yeux, et
peut-être parce qu’elle était mieux ainsi.
Tacite, Annales.
Sans aucun doute l’œuvre la plus sexy jamais écrite ! s’enflamme Robert Carsen.
Oui, mais il est tout de même aussi question de politique, de morale et d’ambition personnelle. La politique ? C’est d’un ennui ! Exit l’ubris, seul le pouvoir irrationnel de l’amour intéresse le metteur en scène, et il se décline, forcément, en rouge, ad nauseam, du rideau de scène aux draps de Poppée – c’est finalement toujours dans la même étoffe qu’elle se love. Et si malgré le lit, les soupirs, les caresses, les étreintes fougueuses, nous venions à l’oublier, un Cupidon en velours cramoisi (Amy Freston) tend sa flèche dorée et se charge de nous le rappeler. Invisible pour les protagonistes, notamment les Soldats de Néron entre lesquels il s’insinue et minaude – y aurait-il anguille sous roche entre ces fringants jeunes gens ? –, mais omniprésent pour le spectateur, Amour distrait jusqu’à la caméra de François Roussillon durant le monologue de Sénèque. Rasoir le stoïcien, gros plan sur le gamin ! Nous sommes là pour divertir. Le public rit d’ailleurs de bon cœur aux œillades que lui adressent Nutrice, en tailleur bleu et brushing à la Thatcher ou Arnalta, métamorphosée à la fin de l’opéra en Queen Mum. Et ce pique-nique dans les jardins de Poppée, avec fraises et champagne, ne serait-ce pas une allusion aux mœurs de Glyndebourne ? Quel esprit ! Pour le reste, Carsen recourt à son vocabulaire habituel : ses valets plantés comme des piquets, ses soubrettes, ses complets vestons, ses négligés de satin, son luxe de nouveau riche…
Un cliché résume cette production. Poppée tente une dernière fois de retenir Néron, sa main glisse vers son pantalon et l’empoigne dans un geste sans équivoque et rédhibitoire: l’explicite tue le désir. Là où Grüber, à Aix, tenait le spectateur en haleine et distillait un érotisme fou sans que les amants ne se touchent, Carsen exhibe le sexe et tombe dans la facilité. La sensualité explosive et trop évidente de Danielle de Niese aurait dû stimuler son imagination. Las ! Tout est dit, d’emblée, sans laisser la moindre chance au drame de se nouer et de nous captiver. L’Amour, fausse bonne idée et vraie tête à claque, s’incruste et ne cesse de répéter que la loi du désir est la plus forte, que les obstacles dressés sur le chemin de Néron ne font que l’exciter davantage et ne lui résisteront pas. Comment croire un instant qu’Octavie puisse venger son honneur ? L’impératrice drapée dans sa noblesse outragée a d’ailleurs cédé la place à une bourgeoise aigrie qui se lamente dans son grand lit vide, avant de quitter Rome en portant elle-même ses valises… Vocalement, Tamara Dumford assure et promet beaucoup, mais elle n’a pas l’allure ni l’attitude qui siéent à son rang. Le Sénèque monocorde et court de Paolo Battaglia manque quant à lui de l’envergure nécessaire pour rendre un tant soit peu crédible sa joute verbale avec Néron. Câline et coquine, toujours jolie, Poppée rêve de princesses, comme toutes les petites filles. La vraie sournoise dans toute cette histoire, la seule calculatrice, c’est sa nourrice ! Timbre pulpeux et physique à l’avenant, Danielle de Niese roule des yeux et roucoule à l’envi, gaie et candide, tout étonnée de ce qui lui arrive, y compris le baiser volé d’Othon qui veut la prendre de force. Lestyn Davies est aujourd’hui ce qui se fait de mieux au Royaume-Uni en matière de contre-ténor. Touché par la grâce chez Bach, électrisant chez Haendel, il incarne l’antithèse d’un Robin Blaze. Son Othon lisse et transparent n’en est que plus déroutant. La tessiture est certes inconfortable, mais ce n’est pas une raison pour survoler le texte et faire dans la joliesse à contresens, ornementant sur le mot « dolore » !
Heureusement, on peut compter sur Dominique Visse (Nutrice) pour remplir son office, queen jusqu’au bout des ongles, et le souvenir de sa berceuse porte ombrage aux susurrements étouffés de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Arnalta). Du reste, ses nasalités si caractéristiques apportent un surcroît d’âpreté bienvenu aux plaintes des Familiers de Sénèque. La distribution des rôles secondaires aligne d’autres bonnes surprises, à commencer par le Valletto très en verve de Lucia Cirillo et la Drusilla plus fouillée qu’à l’ordinaire de Marie Arnet. Peter Gijsberten (Soldat, Liberto), lauréat du prix John Christie à Glyndebourne en 2007, ne manque pas non plus de séduction vocale ni de prestance. C’est l’excellent Andrew Tortise, ténor britannique révélé sur les scènes européennes avec le Jardin des Voix de William Christie, qui campe l’autre soldat et fête avec Néron la mort de Sénèque. Cependant, le plus lascif des duos vire ici au cauchemar. Lucain est déshabillé par les compagnons d’orgie de Néron et plongé dans une baignoire. L’empereur y entre à son tour, tout habillé, embrasse d’abord fébrilement les lèvres de rubis de son favori puis l’étrangle. C’est le sexe et l’effroi, pour reprendre le titre de l’édifiant essai de Pascal Quignard sur la sexualité mortifère et angoissée de la Rome antique. Si la bisexualité de Néron ne risque plus guère de choquer notre époque, en revanche, ce snuff movie d’un goût douteux jure avec le libertinage raffiné de Busenello et Monteverdi. L’allusion au suicide de Sénèque dans son bain n’est pourtant pas gratuite : Lucain est le neveu du philosophe et a compté parmi les innombrables victimes du fils d’Agrippine.
Mâle et carnassier, l’œil torve, le Néron d’Alice Coote domine le plateau de sa silhouette inquiétante et de son chant incendiaire. Loin des adolescents ambigus et maniérés, la mezzo campe un fauve, impulsif, brutal et voluptueux, parfois assoupi, mais toujours prêt à bondir. Carsen charge le portrait et renoue avec les fantasmes du Moyen Age, à ceci près que Néron n’incarne plus le diable, mais un tyran paranoïaque. Le parti pris est discutable, mais la composition d’Alice Coote en tout point remarquable. Le couple qu’elle forme avec Danielle de Niese ne laisse pas de fasciner : les amants auront rarement été aussi dissemblables et en même temps fusionnels, ils forment d’ailleurs l’attrait principal de cette production. Leurs duos prouvent à quel point la transposition du rôle de Néron est une aberration, qui brise l’image spéculaire voulue par Monteverdi et dénature son chef-d’œuvre.
Dans la fosse, les musiciens issus de l’Orchestra of the Age of Enlightenment déploient un véritable éden sonore au gré des sinfonie et ritornelli et varient habilement le continuo, guidés par une Emmanuelle Haïm plus attentive que jamais aux chanteurs et aux richesses harmoniques de la langue montéverdienne. Néanmoins, sa conduite sensible ne peut suppléer les carences d’une mise en scène statique et d’une direction d’acteurs par trop inégale qui privent le drame de colonne vertébrale, de tensions et de rebonds.
Bernard SCHREUDERS