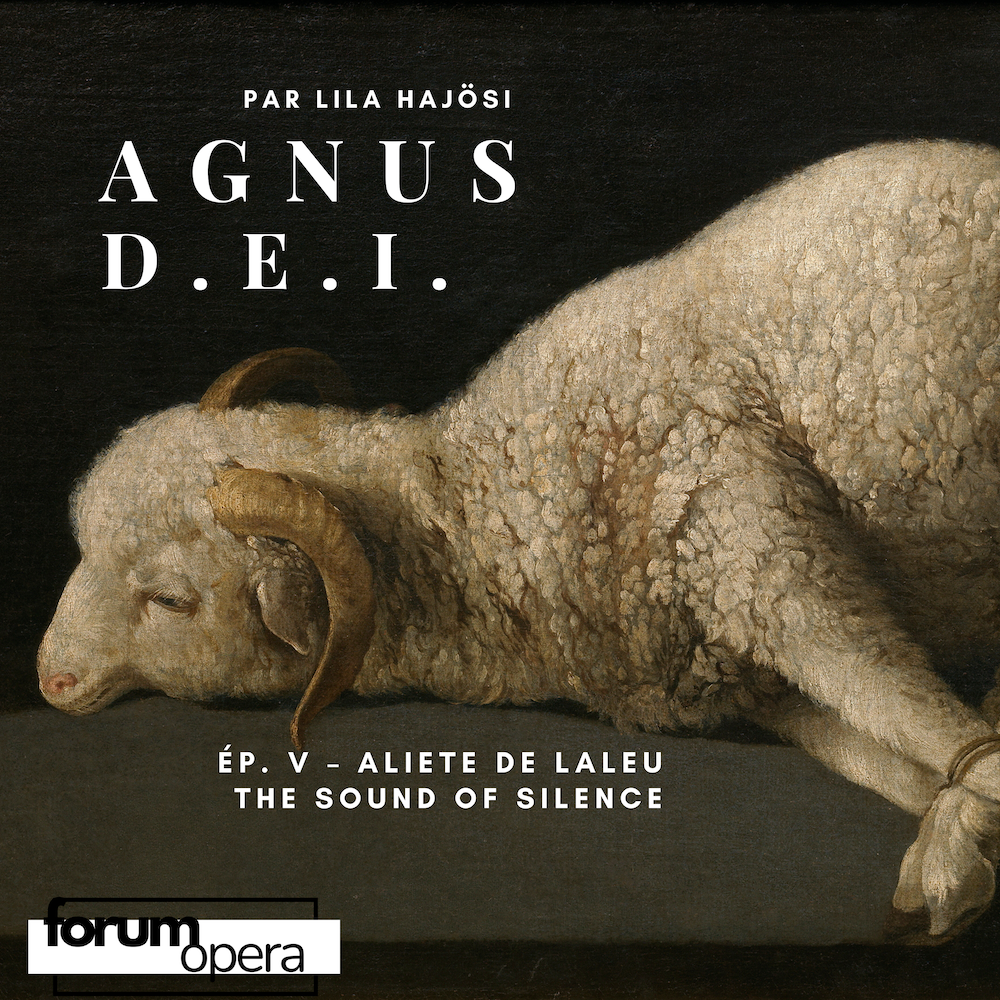Georges Aperghis, vous êtes à l’honneur de l’édition 2026 du Festival Présences. Voyez-vous cela comme une rétrospective ou comme une occasion propice à la réflexion ?
Une rétrospective marque la fin de quelque chose – c’est fini. Moi, je continue. Je vois cela comme un retour à Paris. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu de projet dans la capitale. C’est aussi l’occasion d’écouter côte à côte des pièces de natures différentes. Également celles d’autres compositeurs. C’est une fête et en même temps, c’est lourd : il faut porter les répétions, les entretiens. Je ne regarde jamais en arrière. Une fois que les pièces sont faites, je ne les écoute plus. Mais je vois le festival comme un travail qui me permet d’y voir plus clair, de faire le point.
Et de retrouver des amis, comme l’Ensemble Musikfabrik avec lequel vous avez beaucoup travaillé.
Absolument, c’est une famille que j’aime beaucoup.
Aves-vous participé à la conception du programme ?
Nous l’avons fait ensemble avec Pierre Charvet et Bruno Beranger de France Musique et Radio France. Ils m’ont suggéré des interprètes formidables que je ne connaissais pas, ce qui m’a ouvert les horizons. J’ai aussi invité de jeunes compositeurs et compositrices internationaux, de Grèce, d’Iran, ainsi que notre aînée Betsy Jolas.
On vous associe généralement au terme de « théâtre musical » et, plus particulièrement, à la déconstruction théâtrale du texte, au langage qui devient geste, au texte qui devient matériau au lieu d’être tout simplement mis en musique. Dans quelles œuvres du programme retrouvons-nous cet aspect théâtral ?
Il y a une pièce vocale qui s’appelle Pubs/Reklamen avec un travail sur les phonèmes et sur la voix. Ensuite, il y a une pièce très particulière pour trompette et électronique, Trompe-oreille, avec des bruits d’animaux, comme si un chaman leur parlait. Dans cette musique, on peut imaginer des situations qui dépassent le cadre normal d’un concert. Comme souvent. Dans toute musique il y a un peu de théâtre. Et la mienne devient souvent action, même s’il n’y a rien à voir. Pour ce qui est du théâtre musical, il y a La Construction du monde pour un seul percussionniste et une table. Je voulais effectuer un retour à la démarche des années 1970. Cette pièce peut être montée partout ; Richard Dubelski va la jouer à l’Agora de la Maison de la Radio. Il y a également un spectacle au Théâtre Le Ranelagh pour lequel un trio d’artistes s’est emparé de certains de mes textes musicaux et œuvres pour raconter une histoire autour de ce montage.
Rien que le titre de Babil pour clarinette et ensemble renvoie au langage et à la prononciation. Peut-on tirer comparer cette pièce avec les Récitations pour voix seule, une de vos œuvres phares ?
Ce qu’elles ont en commun, c’est la clarinette qui parle. On a l’impression d’entendre un récitatif qui se finit par une très longue complainte. Cette pièce est construite comme une passacaille avec un épilogue inattendu à la fin, une sorte de lamento.
Comment faites-vous parler la clarinette ?
Avec des combinaisons de quarts de tons et des procédés rythmiques. On a l’impression qu’elle crie, qu’elle veut dire quelque chose. Cela passe de choses très intimes à d’autres davantage criées.
Cet aspect s’observe aussi dans vos œuvres vocales. Le texte est déconstruit mais toute l’expression est là, comme si quelqu’un commençait une phrase ou s’apprêtait à dire quelque chose, sachant ce qu’il va raconter.
Pour moi, la musique vocale et instrumentale, c’est la même chose. On peut passer de l’une à l’autre, c’est la même conception.
Même quand vous écrivez un opéra ?
Les moyens changent, mais le fond de l’affaire est le même : tout parle ! On passe de l’humour à des choses très graves, en prenant de la distance, en se disant que rien n’est grave comme tout est grave. Il y a longtemps, j’ai écrit des opéras qui nécessitaient un travail sur le texte. Il était important qu’on le comprenne, ce qui induisait aussi l’écriture vocale. J’avais beaucoup travaillé sur comment faire en sorte que la phrase soit « audible » et compréhensible. Dans ce que j’ai fait après, le texte n’est pas préalable à la musique, rien n’est préalable, tout est au même niveau, il faut tricoter et tisser sans hiérarchie : les éclairages ne sont pas moins forts que la musique, la vidéo n’est pas moins forte que le texte… Il faut trouver la polyphonie de tout cela. C’est la différence avec l’opéra où tout converge pour raconter une histoire précise.
Justement, vos œuvres ne sont pas linéaires. Elles fonctionnent plutôt par superposition de structures créant une polyphonie. Vous vous intéressez au contrepoint. Vous êtes-vous inspiré de modèles historiques, par exemple la polyphonie vocale de la Renaissance ?
Oui, j’aime beaucoup. J’ai aussi étudié Monteverdi et Gesualdo qui est sur mon piano en ce moment ; j’écris des accords qui y ressemblent. C’était un drôle de personnage.
Par rapport à votre oratorio Die Hamletmaschine, d’après Heiner Müller, vous avez dit que ce texte ne demandait aucune musique. Selon vous, quel type de texte a besoin de musique et quel type peut s’en passer ?
Les poèmes. Ils ont leur musique. Jamais je ne ferai cela. Il y a des écrivains qui ont leur propre musique. Beckett par exemple, si on ajoute quelque chose, on abime sa musique à lui. Par contre, il y a des textes comme celui de Müller, qui est très toxique, très fort, qui fait mal quand on travaille dessus. Ce texte-là peut supporter la musique qui peut à son tour apporter une folie qui est déjà là mais qu’on ne voit pas tout de suite. J’ai écrit une autre pièce d’après Müller, Paysage sous surveillance, où j’avais le même sentiment.
Müller était pessimiste : l’occident touche à sa fin.
C’est pessimiste mais en même temps il y a une révolte tellement forte ! Cela pourrait être optimiste aussi, c’est un paradoxe. J’ai découvert Müller grâce à Jean Jourdheuil, traducteur et ami proche de l’écrivain, qui faisait connaître ses textes en France lorsqu’ils étaient encore interdits en RDA. Puis, j’avais un projet à Munich et j’ai beaucoup échangé avec Elisabeth Schweeger, la directrice du Théâtre Marstall, qui était très proche de Müller. Mail il était déjà mourant. Cela m’a intéressé en l’an 2000, à la fin du siècle dernier. On pensait qu’on allait vers un siècle meilleur, on avait un peu peur, on avait raison d’avoir peur…
Vous dites que jamais vous ne mettriez en musique un poème. Qu’en est-il de votre cantate consacrée à l’écrivain suisse Adolf Wölfli ?
Ce sont plutôt des textes. J’ai pris des fragments, des lignes indépendantes et surtout des chiffres concernant la géographie, des délires d’argent… C’est le grand délire du monde, il y a tout, des Saints, des choses diaboliques ou positives. Il a créé son panthéon à lui. À Berne, à la Fondation Wölfli, j’ai vu des gros livres qu’il avait lui-même brochés et qui vont jusqu’au plafond. Ils sont remplis de chiffres, de temps en temps il y a du texte et beaucoup de peintures magnifiques. J’ai pris les titres et quelques mots par-ci par-là.
Wölfli, Müller, ce sont des textes en allemand. Dans les années 1970, vous avez fondé les ateliers ATEM (Atelier Théâtre et Musique) à Bagnolet. Atem veut dire en allemand « le souffle ». Parlez-vous cette langue ?
Malheureusement non, mais j’ai beaucoup travaillé sur des textes allemands. C’est aussi un hommage à Mauricio Kagel qui a écrit une pièce pour trompette dont le titre est Atem.
Et vous avez beaucoup travaillé avec des ensembles et des orchestres allemands.
Oui. Ensuite, j’ai été professeur à Berne, et j’ai écrit Zeugen, pour voix, marionnettiste et ensemble, sur des textes de l’écrivain suisse-allemand Robert Walser.
En 2019 est paru votre texte « Le Point de la situation », dans un recueil d’écrits réflexifs sur la composition. On y trouve l’idée de « l’orchestre à tordre », qui semble répondre à votre recherche d’une « énergie physique » dans votre musique, même s’il s’agit d’instruments. Qu’entendez-vous par cette expression et retrouve-t-on ce principe par exemple dans les Études pour orchestre dont deux sont au programme de Présences ?
C’est un vieux texte de 1979. Mais oui, c’est cela. C’est l’idée de ne pas subir cette dramaturgie puissante qu’induit l’orchestre, de ne pas aller dans ce sens-là mais de faire dire d’autres choses à l’orchestre. Dans les Études, j’essaie de lui faire dire d’autres choses.
Cela passe par un travail sur le timbre et les structures rythmiques ?
Oui, et sur la dramaturgie. Je ne voulais pas avoir ce qu’on retrouve d’habitude dans un orchestre contemporain, des espèces de montées et de descentes. Il fallait des choses plus abstraites, qui passent d’un palier à un autre palier, mais sans transition. Comme des séquences ou des surfaces à l’intérieur desquelles il se passe beaucoup de choses, mais il n’y a pas d’effet dramatique. Tout existe tel quel. Il y a des structures que je modifie, qui reviennent, mais sans passage de l’une à l’autre. C’est le contraste qui m’intéresse, comme un montage de cinéma.
Une polyphonie successive, dans le temps, comme dans certaines suites de Bach ?
Bach va toujours où l’on n’attend pas qu’il aille. On va vers quelque chose et tout à coup il bifurque. Il trouve toujours le moyen de ne pas aller au bout, il tourne autour, c’est imprévisible, c’est magnifique.
Dans « Le Point sur la situation », vous évoquez aussi Raymond Roussel. Pourquoi cet écrivain vous intéresse-t-il ?
Pour moi, c’est la lignée de Cage ou Duchamp, c’est-à-dire la rencontre des hasards, qu’il assume et qui donnent des phrases absolument incroyables avec des images complètement folles. C’est une sorte de machine à raconter qui se met en marche pour fabriquer ces textes et ces images. Un peu comme Jules Verne : il y a les gravures, et puis une espèce de machine à lire avec des images qui apparaissent comme des zoom, des focalisations sur certaines parties du récit. Verne ne raconte que des expériences avec des machines qui viennent fabriquer quelque chose. Comme si on était dans un musée en plein air et on passait d’une installation à l’autre. Puis, chez Roussel, il y a toutes ces parenthèses, c’est formidable, comme dans un autre monde. À l’époque, j’ai même écrit une pièce intitulée Parenthèses qui est basée là-dessus.
Il vous arrive souvent de commencer une pièce sans savoir où elle va vous amener ?
Oui. Le matériau lui-même amène des surprises, avec ou sans moi. Parfois, je laisse faire la pièce. Sinon, on passe à côté de beaucoup choses intéressantes qui viennent de la pièce elle-même. Au bout d’un certain temps, le matériau de la pièce se met à vivre et il faut l’observer. Il y a de la vie et il faut suivre. Il y a plus de possibilités dans le matériau qu’on ne croit. Cela dépend aussi des juxtapositions dans la syntaxe de la composition. Ce qui vient avant et après peut donner lieu à d’autres possibilités, à des extensions inattendues. Il faut être très attentif à cela, sans être directif. En même temps, si on sent qu’il y a une direction à prendre, il faut y aller. C’est toujours une négociation entre laisser faire et rattraper les choses.
On regardant le programme de Présences, on remarque deux types de titres : ceux, très évocateurs et imagés, comme Wild Romance ou La Nuit en tête, et d’autres parfaitement neutres, comme Études, Concerto, Cinq pièces… Premièrement, pouvez-vous parler un peu de Wild Romance et de La Nuit en tête ?
La Nuit en tête est une sorte de nocturne. Une voix est perdue on ne sait où, mélangée aux instruments. Parfois on a l’impression que ce sont ceux-ci qui chantent. J’imaginais une procession, des gens qui avancent dans la nuit. Des jeux aussi, dans la forêt, à l’extérieur. Par contre, pour Wild Romance, je pensais à une femme qui se raconte des histoires. On ignore si elle les vit ou si elle les invente. Parfois, cela se traduit par des cris. L’ensemble la suit. À la fin, tout s’en va et on ne sait pas ce qui s’est passé. Il y a de petit bouts de texte en anglais, puisque la pièce a été créée par un ensemble américain. C’est pour que le public puisse s’accrocher à quelques mots, mais on n’en sait pas davantage.
Deuxièmement, quel est le rôle des titre neutres ?
Les Études et le Concerto ne racontent rien d’autre que ce que c’est. Ce sont des formes qui se suffisent à elles-mêmes, il n’y a pas de sujet. Dans le cas des Cinq pièces, je ne voulais pas donner d’indications à l’auditeur. C’est à lui de découvrir ce qu’il y a là-dedans.
Les images de La Nuit en tête sont romantiques : la nuit, la rencontre avec la nature.
J’imaginais ces choses-là. Je pensais un peu aux poèmes de Nerval. Mais ce sont surtout les harmonies qui sont importantes. Ça sonne faux. On a l’impression que cela ne va pas. Il y a des quarts de tons et des accords classés. Les deux à la fois ressemblent à des ombres dans la nuit.
À un moment donné, vous vous êtes posé la question du rapport entre le XIXe siècle et la musique contemporaine.
À cette époque-là, je voulais vraiment me débarrasser du XIXe siècle. Il y a de la musique magnifique, mais l’esprit du romantisme, des choses egocentrées, où chacun raconte son histoire, ses problèmes, ses malheurs, ses amours… Je voulais que ce soit beaucoup plus social, plus ouvert au contemporain et aux problèmes sociaux. Je voulais arrêter avec cette vision romantique – que j’aime beaucoup, mais cela a été fait, c’est très bien, commençons autre chose. C’est à ce moment-là que j’ai fondé l’ATEM.
Vous avez écrit des pièces qui évoquent d’une manière directe des enjeux sociétaux et historiques. Je pense notamment à Fidélité, Rires psychologiques ou Die Hamletmaschine. Nous vivons dans une époque où nous avons plus que jamais besoin d’art. Selon vous, quelle est l’importance de festivals comme Présences ?
Malheureusement, il y a des festivals qui ferment. Mais c’est très important, puisque c’est le seul moyen d’entendre de la musique vivante, au-delà des enregistrements et des réseaux sociaux. Les interprètes sont là, avec leur corps, et c’est ainsi que la musique passe du côté du public. Sans ces festivals, je ne verrais pas où le public peut trouver de la musique vivante. Heureusement qu’il y a encore de grands festivals comme Musica, Présences, Avignon ou Aix. Mais il faut aussi encourager les petits festivals en province qui font un travail de passage auprès du public. Même si celui-ci est restreint, cela est très important. Les gens n’ont aucune raison de savoir que cela existe. Malgré tous nos moyens de communication, on parle beaucoup d’autres choses. Il est compliqué de faire en sorte que le public soit au courant. Quand je vais au conservatoire de Paris [CNSMDP] ou aux rencontres de Darmstadt, je me rends compte qu’il y a une nouvelle génération pleine d’espoir et d’idées, qui a besoin de se confronter à de la musique réelle.