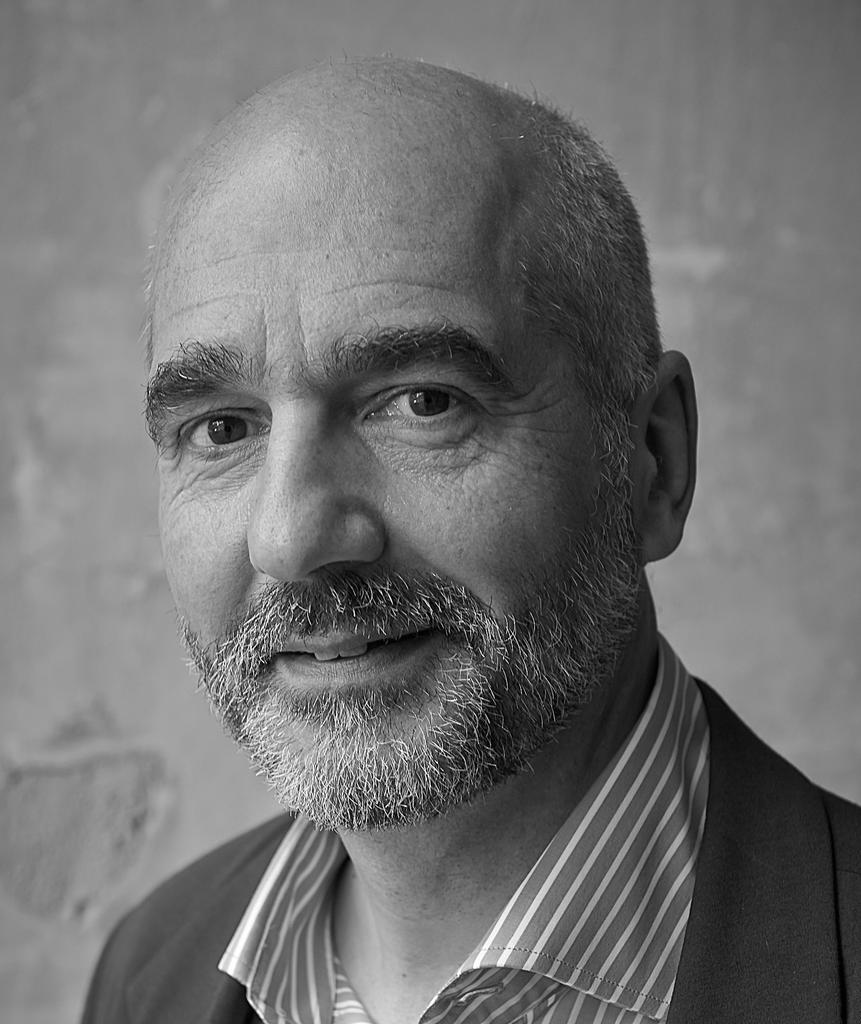Beaucoup d’œuvres du grand répertoire ont connu plusieurs versions, élaborées au gré de leur succès, des reprises successives, des exigences (ou des limites) des chanteurs, des remords de leur compositeur ou des contraintes de modes. Les puristes l’oublient en général, lorsqu’ils s’effraient de ne pas retrouver à la scène la version qu’ils se sont imposée à eux même par la pratique trop assidue d’une version unique au disque. Réjouissons-nous qu’une version largement oubliée de Faust, mais parfaitement légitime, c’est celle de la création de l’œuvre, vienne bousculer un peu nos habitudes d’écoute et apporter une lumière nouvelle sur une œuvre décidément bien riche.
A l’origine de ce travail d’archéologie musicologique figure une étude du Palazzetto Bru-Zane, le centre vénitien, et une publication des éditions Bärenreiter visant à retrouver la version initiale de l’œuvre, telle qu’elle fut créée au Théâtre Lyrique à Paris le 19 mars 1859.
Première surprise, pour qui ne s’est jamais penché sur ces questions, Faust se présente sous la forme d’un opéra-comique, avec des dialogues parlés en lieu et place des récitatifs avec lesquels l’œuvre a connu ensuite la postérité. L’idée un peu figée qu’il existerait deux catégories hermétiques dans le genre opéra, le grand-opéra et l’opéra-comique, l’une un peu moins noble que l’autre, plus proche du théâtre parlé, traitant de sujets plus futiles, se trouve ici remise en cause. On rappellera que le même chemin d’un genre à l’autre fut parcouru aussi par Carmen lorsque l’œuvre fut touchée par une popularité accrue. Sous cette forme, Faust se découpe en un prologue et quatre actes, au lieu de la forme traditionnelle en cinq actes que Gounod adoptera pour lui par la suite.
Certaines parties particulièrement populaires de l’œuvre ne figurent donc pas dans cette version : l’air initial de Valentin « Avant de quitter ces lieux » ajouté plus tard et que Gounod refusa toujours d’intégrer dans la partition finale, ou le célébrissime air du Veau d’or, ajout postérieur également. On n’y retrouve pas non plus le chœur emblématique « Gloire immortelle de nos aïeux », autre page pourtant considérée aujourd’hui comme incontournable. Beaucoup d’autres détails diffèrent également, parfois riches de sens pour qui veut analyser la partition par le menu. Au total, la version présentée ici est particulièrement cohérente, resserrée, pleine d’humour en tout cas dans sa première partie (c’est une autre découverte), dramatiquement très bien construite et aussi délicieusement datée – il faut en prendre son parti.
C’est ce que fait, avec un courage assumé, la mise en scène de Denis Podalydès, en grand amoureux du XIXe siècle, sans chercher à gommer les éléments les plus obsolètes, comme la très grande place de la religion, la position soumise des femmes ou la glorification de la guerre. Abordant le texte sans idée préconçue, il recherche la vérité de l’œuvre – ou plutôt une vérité de l’œuvre – dans l’œuvre elle-même, sans puiser dans l’idéologie d’aujourd’hui pour juger celle d’hier. Cette démarche-là est assez rafraîchissante, instructive, et laisse le spectateur tirer lui-même des faits exposés les conclusions qui lui conviennent, sans se laisser dicter sa pensée. En grands professionnels du théâtre qu’il sont, Denis Podalydès à la mise en scène et Eric Ruff à la scénographie se mettent au service du texte pour en dévoiler un des sens profond, le combat intérieur entre sensualité et spiritualité, cette dernière largement aspergée d’eau bénite et penchant ici dangereusement vers la bondieuserie.
Au fil de la narration, chaque personnage est travaillé, caractérisé au départ des éléments du livret, ce qui aboutit à une très grande lisibilité du parcours dramatique et une forte cohérence du propos.
Le même travail de lisibilité et d’analyse a aussi été mené dans la fosse, où Louis Langrée, entraînant ses troupes avec compétence, rigueur et passion, rend perceptibles les différents plans sonores, souligne les rappels thématiques, déploie la ligne mélodique et révèle ainsi la puissance lyrique de la partition de Gounod et ses immenses qualités orchestrales dont il révèle la limpidité.
Il est aidé par une distribution de grande qualité, et largement dominée par Julien Dran dans le rôle titre. Rarement on aura entendu un Faust aussi énergique, débordant d’ardeur juvénile et de séduction spontanée. La voix est à la fois puissante et souple, parfaitement timbrée, avec des aigus d’une déconcertante facilité et d’une brillance remarquable, emportant tous les suffrages. La diction française est impeccable, on comprend chaque mot, les voyelles ne sont pas dénaturées et le discours chanté semble aussi naturel que les dialogues. Le Méphistophélès de Jérôme Boutillier déborde lui aussi d’énergie et de malice, sans noirceur excessive dans la définition du personnage mais avec beaucoup de caractère dans la voix et une grande aisance scénique. Un peu moins satisfaisante, Vannina Santoni dans le rôle de Margueritte n’était pas au meilleur de sa forme vocale. Telle qu’entendue lundi la voix manque de velouté, le timbre parait un peu métallique et les aigus sont poussés presque jusqu’au cri ; c’est parfois efficace, mais pas toujours agréable.
Privé de son air le plus célèbre, Lionel Lhote livre néanmoins une très belle prestation en Valentin, même si le rôle, dans cette version-ci, semble un peu affadi. Sa voix puissante, idéale pour les chansons à boire ou les fanfaronnades militaires, trouve ici un emploi très adéquat. Son complice Anas Séguin fait une intervention parfaite dans le petit rôle de Wagner. La voix est très chaude, le timbre riche est plein de couleurs et la diction impeccable. Dans le rôle de Siebel, Juliette Mey de démérite pas, la voix est agréable et bien timbrée, mais la prestation manque un peu de caractère et de personnalité – le rôle n’est pas facile à défendre. Enfin Marie Lenormand donne beaucoup de relief au rôle un peu ingrat de Dame Marthe, poussé ici jusqu’à la caricature.
Les chœurs aussi sont excellents, précis et disciplinés, et très bien mis en valeur par la mise en scène, c’est assez rare pour être souligné.
Les spectateurs lors de la première saluèrent de longs applaudissements cette grande réussite à la fois lyrique et théâtrale. Une belle promesse pour l’Opéra-Comique de Paris, où le spectacle sera repris dès le 21 juin prochain.