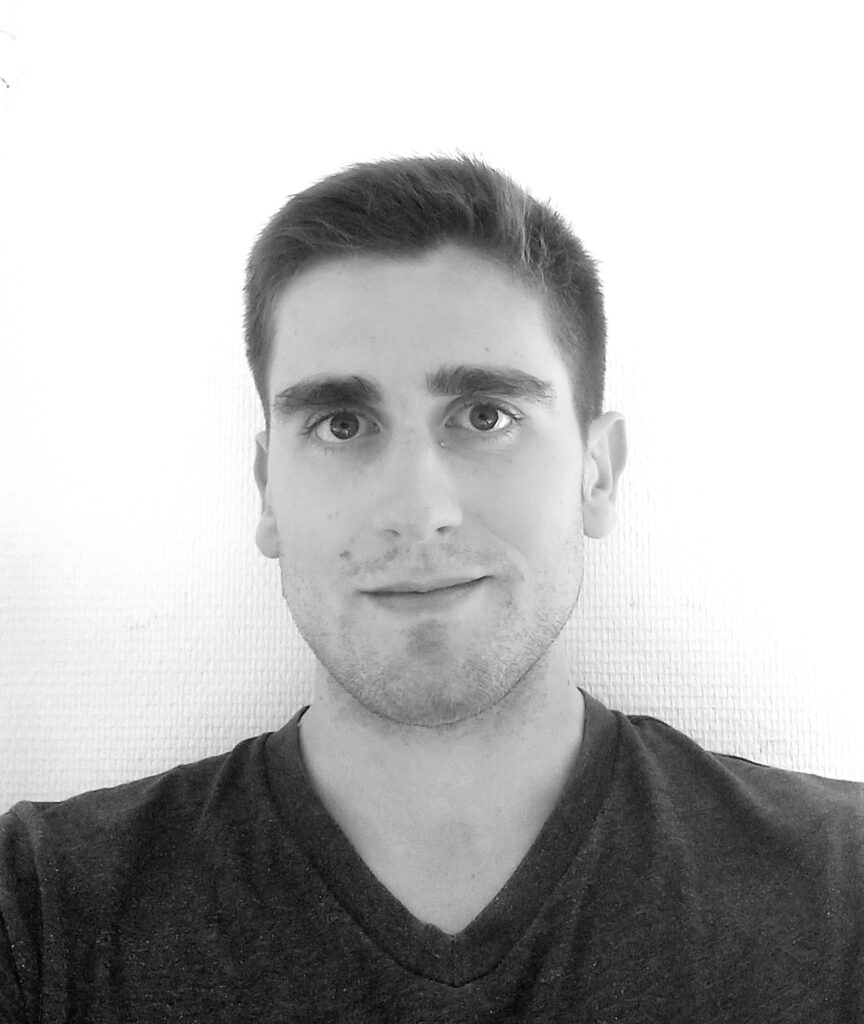Féérie teintée de burlesque et marquée par une centralité toute romantique de la tradition populaire, La Nuit avant Noël, cinquième opéra de Rimski-Korsakov d’après une nouvelle de Gogol, est un pétillant bijou de légèreté et de poésie qui gagnerait à être connu comme un classique de Noël. La nouvelle production du Bayerische Staatsoper, servie par une équipe impeccable à tous les niveaux, séduit sans réserve et nous fait (re)découvrir une pépite revigorante du répertoire.
L’œuvre a pour elle des qualités indéniables. Le livret de Gogol (tiré du conte éponyme dans Les Soirées du hameau) entremêle deux niveaux de narration qui ne se rencontrent que partiellement, celui des villageois ukrainiens et celui des êtres infernaux qui profitent du solstice d’hiver et de l’absence du soleil pour faire proliférer leurs mauvais coups dans le monde des humains. Ce deuxième niveau est, plus profondément, celui du drame solaire païen : on attend, avec un soupçon de doute, le retour de Kolyada, déesse du soleil. Kolyada désigne aussi le folklore qui entoure la fête du solstice et plus particulièrement les chants traditionnels ukrainiens (kolyadki), qui reviennent comme un leitmotiv dans l’opéra. Musicalement, l’œuvre est un concentré de l’art d’orchestrateur, d’humoriste et d’amoureux du folklore de Rimski-Korsakov qui, dans la lignée de Gogol, imagine un conte qui est un hommage à la tradition populaire ukrainienne.
Dans un village ukrainien, le forgeron Vakoula est amoureux de la farouche Oxana mais d’une part cela déplaît à sa mère, la sorcière et comparse du diable Solokha, qui aimerait bien se remarier avec le père d’Oxana et d’autre part la jeune fille entend bien faire tourner en bourrique son amant, et lui demande en dot rien de moins que les escarpins de la tsarine. Le diable veut profiter de la période hivernale où son pouvoir est maximal. Il s’avère pourtant un bien faible tourmenteur : certes, il vole la Lune et les étoiles pour plonger le village dans une nuit complète, mais il est dompté par le crucifix du forgeron et se trouve contraint de l’aider dans sa quête des souliers royaux, rapidement couronnée de succès. Après les retrouvailles amoureuses attendues, l’œuvre s’achève sur un triomphe du chant folklorique entonné par tout le village, avec un clin d’œil à l’apiculteur Panko le Roux – pseudonyme de Gogol dans son recueil.
La mise en scène de Barrie Kosky est une franche réussite. Il a intelligemment privilégié la dimension populaire du conte, qui l’emporte sur ses aspects plus merveilleux sans les effacer, les deux se trouvant subtilement conjugués dans l’univers du cirque, dont l’imaginaire irrigue toute la production. Il évite ainsi de tomber dans le kitsch du conte pour enfant et rend au texte de Gogol sa dimension d’ode au folklore ukrainien. Le décor unique figure une structure sur trois étages, comportant au rez-de-chaussée des gradins en arrondi et deux entrées recouvertes de rideau, comme dans tout cirque digne de ce nom, tandis que les deux niveaux supérieurs, jouant de quelques ouvertures et d’un jeu d’échelles, évoquent plutôt une façade d’habitation. Les costumes rembourrés des villageois et leur jeu clownesque, l’habit de Monsieur Loyal porté par le Diable et l’intervention (magnifique) d’acrobates puisent aussi dans l’univers du cirque. Ainsi, le metteur en scène trouve un langage visuel efficace pour traduire ce qui est au cœur du livret, un sens de la communauté festive, du rire bouffon qui n’exclut pas l’émerveillement et la magie. Des danseurs incarnent d’abord la suite de diablotins qui entoure le Diable et répand à pleines mains la neige sous forme de confettis blancs (très bel effet visuel), puis les courtisans de la Tsarine dans un numéro à la fois beau et comique de bayadères obséquieuses. L’acte qui se déroule à la cour est un sommet de comique, encore plus peut-être que les manœuvres de Solokha pour cacher ses visiteurs lourdauds et libidineux : la tsarine kitschissime descend des cintres adossée à un gigantesque aigle bicéphale tandis que ses escarpins scintillants pendent à de fausses jambes démesurément longues que les serviteurs viennent carrément dévisser pour tendre les souliers au forgeron. Ajoutons une nuit du Sabbat déjantée où les démons se transforment en cuisiniers cannibales, et on obtient une mise en scène parfaitement adaptée à la veine folklorique et comique du conte original.
Côté musical, Vladimir Jurowski démontre des qualités admirables dans sa direction : il installe dès l’ouverture une atmosphère de magie frétillante, étirant légèrement le tempo pour traiter avec soin l’impressionnisme de la musique et la richesse des plans sonores et des interventions solistes fugaces de divers instruments, que l’on doit à un vrai maître de l’orchestration. Sa direction prend au fil de la soirée une ampleur bienvenue, jusqu’à donner parfois le premier rôle à l’orchestre (comme lorsque le chef retient tout le plateau pour laisser passer les magnifiques traits des harpes). Avec l’orchestre du Bayerische Staatsoper, il triomphe avec aisance des ruptures rythmiques qui visent à évoquer le folklore et qui rappellent en quoi Rimski a pu être un maître pour Stravinsky. La lecture de Jurowski fait ressortir les aspects les plus modernes de l’écriture de Rimski, dont quelques audaces harmoniques surprenantes dans les deux scènes d’Oxana, et elle rend à la veine folklorique sa verve sautillante et sa joie communicative. Les chœurs du bayerische Staatsoper livrent une très belle prestation, même si on la trouve parfois trop lyrique et trop homogène pour évoquer pleinement une tradition folklorique slave qui tolère plus d’individualités.
L’opéra est très exigeant pour les chanteurs, jusque dans les plus petits rôles, ce qui explique aussi qu’il soit rarement monté. Elena Tsallagova est une époustouflante Oxana. On avait déjà remarqué à Paris son aisance sur scène, notamment dans le rôle tendre et espiègle de la Renarde de Janáček. Il en va de même ici où elle sautille comme une adolescente, danse, virevolte d’un bout à l’autre de la scène et incarne avec un charisme insolent ce rôle d’amoureuse tyrannique vite repentie. Sa voix souple et puissante, teinté d’un soupçon de rugosité slave s’aventure jusque dans des aigus parfaitement soutenus ; mais c’est surtout la justesse et la puissance de son incarnation qui font mouche, notamment dans la grande scène de lamentation du dernier acte. Le forgeron trompetant de Sergeï Skorokhodov est très efficace mais un peu uniforme alors que son rôle comporte des lignes d’amoureux transi digne du plus pur opéra romantique. Il est aussi moins crédible, moins juvénile dans son incarnation. La voix n’en reste pas moins agréable et solidement émise, avec des aigus puissants. Tansel Akzeybek est un excellent Diable : ténor claironnant au timbre nasillard qui joue du caractère de matamore de son personnage, un diable bien inoffensif qui se dégonfle rapidement. La sorcière Solokha fournit à Ekaterina Semenchuk une occasion de jouer la comédie qui visiblement la ravit. Vocalement irréprochable, avec un timbre au moins aussi opulent que la fausse poitrine qu’elle fait ostensiblement rebondir, la mezzo campe une exubérante veuve joyeuse plus qu’une vraie sorcière. Les plus petits rôles sont tous très bien distribués ; citons notamment la basse sonore et ductile de Dmitri Ulyanov en Tchoub, et la tsarine impeccablement bouffie de supériorité burlesque de Violeta Urmana.