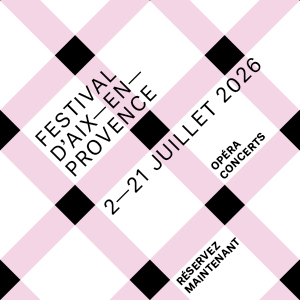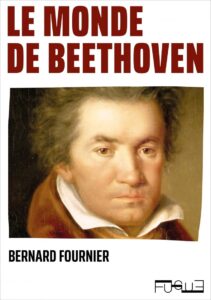Vous l’ignorez sans doute, mais vous avez déjà entendu la musique de Geminiano Giacomelli. « Sposa, son disprezzata », tube baroque longtemps attribué à Vivaldi, c’est de lui. Plus spécifiquement de Merope (Venise, 1734), un de ses grands succès dont provient également le mythique « Quell’usignolo » tant chanté par Farinelli. Le castrat légendaire y affrontait Caffarelli, fabuleuse distribution parmi tant d’autres en cet âge glorieux du théâtre Grimani.
C’est dans ce théâtre justement, le plus fastueux de la Sérénissime, que cette deuxième mouture de Cesare in Egitto est donnée en 1735, là encore avec un cast de haut vol. Giacomelli est en vogue depuis ses débuts à l’opéra, une dizaine d’années auparavant. Sa musique attire les illustres oreilles de Haendel, qui reprend Lucio Papirio dittatore à Londres, et de Vivaldi, dont certaines productions sont pimentées d’emprunts à Giacomelli (Tamerlano, Dorilla in Tempe et sans doute une bonne partie de L’oracolo in Messenia).
Natif de Parme, formé par le maestro Capelli et employé entre sa ville natale et Plaisance, Giacomelli n’appartient ni à la tradition vénitienne, ni à l’école napolitaine qui prend alors le dessus. Il est cependant pleinement de son époque : la lisibilité harmonique, l’agrément des mélodies et la virtuosité vocale le rattachent au nouveau style dit « galant ». Un adjectif qui ne traduit guère l’énergie d’un musique très animée, notamment sur le plan rythmique. C’est particulièrement évident dans Cesare in Egitto, sous-tendu par une vive scansion exaltée par l’Accademia bizantina et Ottavio Dantone, captés au festival d’Innsbruck en 2024. L’agencement des plans de cordes et l’impeccable précision sont mis en valeur par la prise de son, qui met l’orchestre en avant au détriment des solistes.
Ces derniers ne déméritent pas dans des parties taillées pour des vocalistes entrés dans l’histoire du chant. L’enjeu est surtout vocal, car cet épisode historique déjà bien connu sous la plume de Haendel souffre d’un certain déséquilibre. Le livret de l’estimé Domenico Lalli, remanié pour Venise avec l’aide du tout jeune Goldoni, souffre de redondances auxquelles la musique ne supplée guère. César et Cléopâtre y apparaissent en retrait : pas d’entrée glorieuse de l’empereur, qui tergiverse longuement ; pas de scène de séduction ni de duo entre les amants. La bataille qui clôt le II devait faire bel effet, mais César passe encore au second plan, laissant Ptolémée clore l’acte. L’Égyptien se taille une place au premier plan avec cinq airs, au même rang que la veuve de Pompée, Cornélie. Tous les autres personnages sont à égalité, de César et Cléopâtre aux seconds couteaux Lepido et Achilla : ce défaut de hiérarchie explique pourquoi le portrait du couple principal apparaît beaucoup moins élaboré que chez Haendel, qui n’a pas omis de semer sa version d’épanchements et d’airs lents qui font défaut ici.
César était le castrat soprano Salimbeni, élève de Porpora, certes aujourd’hui moins resté dans les mémoires que Farinelli ou Caffarelli, mais révéré sur les plus grandes scènes italiennes, passé au service de l’empereur d’Autriche puis du roi de Prusse. Arianna Vendittelli lui succède avec une jolie voix, suffisamment agile et longue. Son charisme discret ne transcende pas ce héros en retrait.
Cléopâtre donne fort à faire à Emőke Baráth : sa créatrice Margherita Giacomazzi était amatrice de montagnes russes, comme l’attestent les rôles que lui confia Vivaldi juste avant, dont le célébrissime « Agitata da due venti ». Giacomelli cultive donc l’autorité de la reine, plus altière qu’éplorée ou piquante. À elle comme à César manque un vrai moment pathétique pour enrichir la palette, l’amer « Spose tradite » n’ayant pas la force tragique que Giacomelli a pu insuffler à d’autres pages. Avec un certain aplomb, le timbre pulpeux, Baráth est cependant plus à son avantage dans des lignes moins chahutées qui n’entravent pas son élan lyrique.
La vraie primadonna, c’était Vittoria Tesi. Au fil d’une carrière étalée sur près de 40 ans, son contralto profond, sa musicalité et sa présence l’érigèrent en légende vivante. Margherita Maria Sala a indéniablement de la présence et de l’autorité, mais ni les nuances, ni les talents de diseuse, ni les notes graves de sa devancière, dessinant une Cornélie un peu uniforme.
Ptolémée s’arroge cinq airs qui en dressent un portrait plus fouillé que chez Haendel, assez classique du ténor antagoniste de l’opera seria nouvelle manière. Amorevoli en fut le premier interprète, ce qui explique partiellement la place accrue du personnage. Dommage que Valerio Contaldo soit un peu relégué derrière l’orchestre, car il possède le juste centre de gravité pour ce type de rôle, assis dans le médium avec des envolées dans l’aigu, et déclame avec finesse et autorité. Il surprend par une virtuosité aiguisée dans le terrible « Scende rapido spumante » et se fait doux dans « A quelle luci ».
Son complice Achilla jouit d’une partie étendue à quatre airs. La contralto Della Parte, la créatrice, avait été primadonna pour Vivaldi la saison précédente. On apprécie toujours la musicalité et l’engagement de Filippo Mineccia, dont le live expose une voix qui peut paraître ingrate. Lepido fut aussi créé par un artiste repéré par Vivaldi, le castrat Saletti, pour qui il écrivit des écarts délirants dans Griselda. Giacomelli se montre bien plus raisonnable… Amoureux transi de Cornélie, le prince professe son amour et sa combattivité au fil de quatre airs qui servent surtout à étaler sa virtuosité. Le falsettiste Federico Fiorio a une voix claire, fine et aisée qui se raidit quand il s’enhardit, ce qui arrive assez peu.
On voudrait bien croire, comme l’explique la notice, que Cesare in Egitto est le chef-d’œuvre de son auteur, mais il manque quelque chose à cet enchaînement de beaux airs pour nourrir les pleins et déliés d’un drame efficace. Plus inégal musicalement, La Merope nous semble plus réussie sur ce plan. Est-ce pour cela que quelques coupes sont à déplorer (deux airs réduits à la partie A, da capo réduits) ? On est tenté de faire comme Vivaldi, et d’y piocher des airs çà et là : les vigoureuses interventions de Cornélie, le charmant « Bella, tel dica amore », l’impétueux « Scende rapido »…