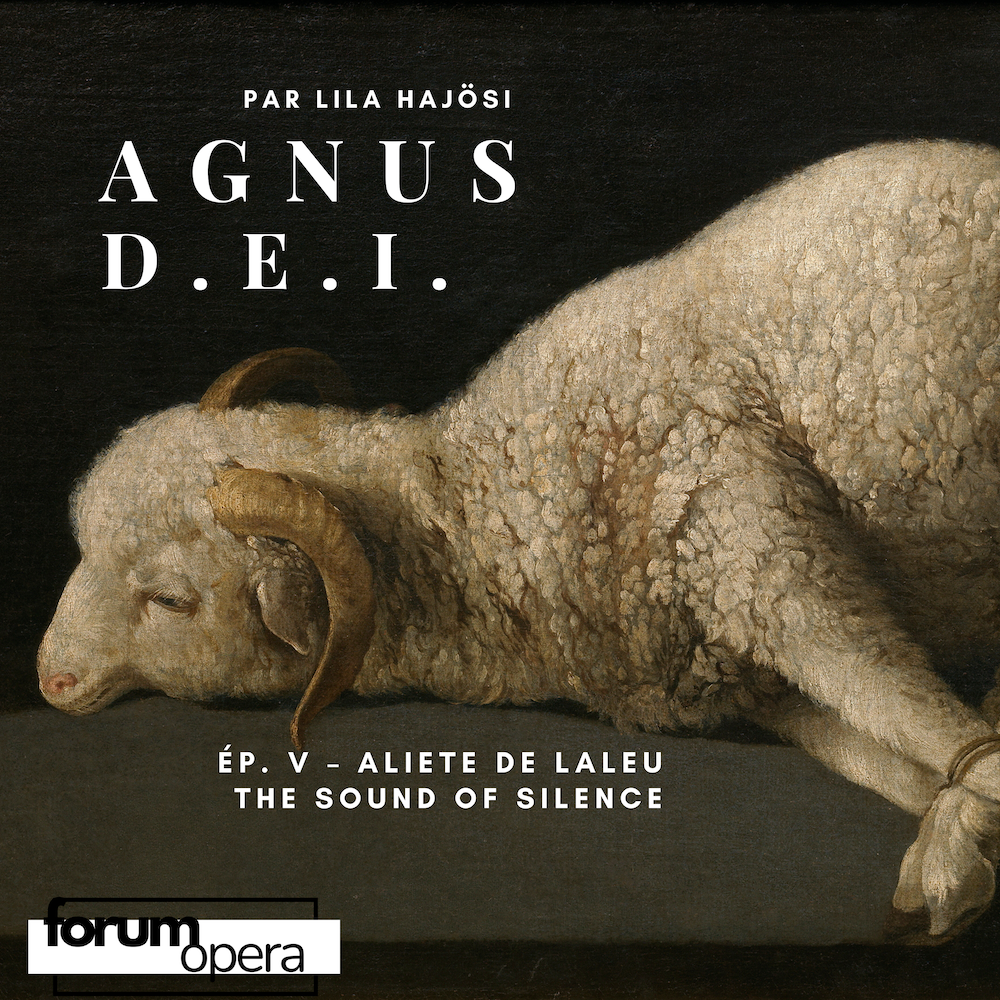Ouverture de la saison 2025-26 au Teatro de la Zarzuela de Madrid avec une nouvelle production de l’opéra Pepita Jiménez d’Isaac Albeniz. Pièce majeure dans le catalogue lyrique du compositeur ibérique, même si elle ne s’est guère imposée dans d’autres pays.
Cette œuvre a connu une genèse complexe : créée en 1896 en italien au Liceu de Barcelone, ce n’est qu’en 1964 qu’elle est interprétée pour la première fois en castillan au Teatro de la Zarzuela de Madrid. Aujourd’hui régulièrement donnée en deux actes (comme pour cette production), l’œuvre a été initialement publiée en un seul acte, sur un livret anglais du collaborateur britannique d’Albéniz, le Baron Francis Money-Coutts, qui s’était basé sur le roman éponyme de Juan Valera. L’opéra a ensuite été revu à plusieurs reprises, d’abord par son compositeur et plus tard par d’autres. Il en existe une version en trois actes.
Pepita Jiménez a certainement connu son apogée au début des années 1960 ; une production de Juan de Prat-Gay datant de 1964 proposait aux spectateurs du Teatro de la Zarzuela de Madrid une version en trois actes défendue par rien moins que Pilar Lorengar dans le rôle-titre et dans celui de Luis, Alfredo Kraus, dont un superbe buste en bronze orne l’un des salons du théâtre.
On a pu reprocher au livret (plus qu’à la pièce originelle dont il semble une bien pâle copie) la minceur de la substance. De fait, l’action d’un opéra qui ne s’étale guère sur plus de 75 minutes peut se résumer très vite.
Pepita, une jeune veuve, est éprise de Luis, jeune séminariste qui se destine à la prêtrise, guidé en cela par le vicaire qui cherche à persuader Pepita de renoncer au jeune homme. Pepita est également courtisé par le Comte de Genazabar, qui veut se battre en duel avec Luis (mais on n’apprendra rien d’autre sur ce duel). Le second acte tourne autour de la rencontre avec Luis qu’Antoñona, la gouvernante de Pepita, va organiser afin que celle-ci séduise le séminariste et le fasse renoncer à ses projets ecclésiastiques. Elle y parviendra au terme d’une (trop) longue scène de séduction qui finira par faire fléchir le jeune homme.
Intrigue maigrelette, et surtout une quasi absence de caractérisation des personnages, chacun étant réduit à la caricature de soi-même.
Dans la mise en scène de Giancarlo del Monaco, à laquelle nous assistons, Pedro de Vargas, le père de Luis, qui, au début de la pièce était amoureux lui aussi de Pepita, jette immédiatement son dévolu sur Antoñona, dès qu’il apprend que Pepita est amoureuse de son fils. Cela donne lieu à une scène un peu sordide de séduction brutale entre Pedro et Antoñona. Luis semble d’une confondante naïveté en promettant à Pepita de l’aimer toujours…comme un frère. Quant à Pepita, elle est tendue vers la réalisation de son rêve, ou plutôt l’assouvissement de ses pulsions spectaculaires. Luis ne pourra pas résister !
© Javier del Real
Mettre Pepita Jiménez en scène n’est pas aisé, concédons-le, car l’action, on le voit, est des plus simplettes, les personnages un rien falots, et la partition, magnifique quant à elle, offre de longues plages orchestrales, qu’il n’est guère aisé d’illustrer sur scène.
Le long intermède au début du II est astucieusement mis à profit par le metteur en scène pour faire tourner le plateau sur lui-même. Le plateau est constitué d’un ensemble de grilles en fer échafaudé sur trois niveaux avec des escaliers les reliant. Les parois grillagées rappellent un lieu d’enfermement (cage ou prison, ou peut-être figurent-elles l’étroitesse des pensées de l’héroïne, que l’on voit longuement arpenter les escaliers de cet ensemble).
Au début du second acte la machinerie va se mettre à tourner sur elle-même, ce qui traduit bien le tourment, la tempête qui agitent les esprits des deux héros. Tous deux sont pris dans un maelström de sentiments et de pulsions, à vous faire tourner la tête. Et c’est un peu ce qui se passe sur scène, car, non contents d’opérer une rotation à 360 degrés, les machinistes vont en proposer quatre ! Quatre tours complets, à vous donner définitivement le tournis.
C’est Leonardo Caimi qui devait chanter Luis pour la première, il est remplacé par Antoni Lliteres, prévu dans le cast B. Le jeune ténor fait fort bonne impression ; le jeu est soigné et crédible. La voix se densifie tout au long de la soirée et ses incursions dans l’aigu forte sont dans l’ensemble réussies. Antoñona est Nodriza de Pepita qui peine en début de soirée à maîtriser le vibrato même si les choses s’arrangent par la suite. Rubén Amoretti est droit dans ses bottes en vicaire jaloux de son pré carré, Rodrigo Esteves figure un père de famille peu au clair avec ses sentiments ; la basse est solide, tout comme celle de Pablo López, le comte éconduit.
Malheureusement ce soir Ángeles Blancas (Pepita) est en petite forme. Sans doute la tension de cette première qui aura eu raison de la justesse de la voix dans bien des occurences.
L’orchesta de la Communidad de Madrid, ainsi que les chœurs, le tout dirigés par Guillermo García Calvo, rendent parfaitement justice à la mélodie souvent envoûtante d’Isaac Albéniz. Des saluts un peu chahutés concluent la soirée tandis que l’apparition subreptice d’un drapeau palestinien en fond de scène en interpelle plus d’un.