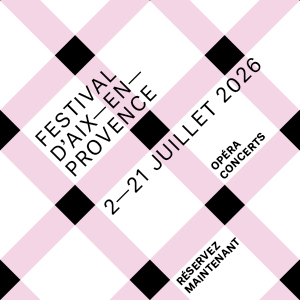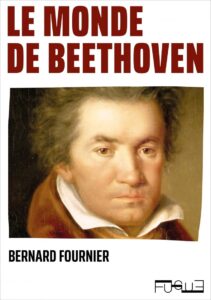Si les Nuits d’été restent les mélodies les plus connues de Berlioz, son catalogue compte en réalité une cinquantaine de pièces pour voix, avec accompagnement de piano ou orchestrées, composées tout au long de sa vie, et toutes d’une grande qualité d’invention. Ce qui conduit à s’interroger sur leur rareté dans les programmes de nos salles comme des enregistrements (*) qui nous sont offerts.
Composé tout au long de sa vie, le riche corpus des mélodies de Berlioz est disparate, puisqu’il va de la romance pour voix et piano (ou guitare, ou harpe) au grand chœur avec orchestre, plus proche de la cantate ou de la scène lyrique. Le Festival 2025 de La Côte Saint-André, en première mondiale, en propose l’intégralité en quatre concerts, à l’église. La réalisation en a été confiée à Thibaut Louppe, qui a succédé à Nicole Corti à la tête du chœur lyonnais Spirito. Mathias Vidal, familier de nos scènes lyriques, du baroque au contemporain, et le pianiste Guillaume Coppola en sont les autres artisans, essentiels. Nous n’aurons écouté que le troisième volet des quatre programmés, et le regrettons d’autant plus. La nef et les bas-côtés sont combles d’un public avide de découvertes, concentré et réceptif. Le programme d’aujourd’hui nous offre cinq mélodies avant les neuf du premier recueil, intitulé « Irlande », ou « Mélodies irlandaises », inspiré par des poèmes de Thomas Moore, traduits en français. Il fera alterner les mélodies pour ténor seul et piano, avec des pièces renouvelant les dispositifs qu’impose le compositeur (chœur mixte, d’hommes, de 3 à 6 voix, avec ou sans ténor solo). Si on oublie le caractère strophique dont use (et abuse ?) Berlioz, qui a pour mérite de rendre la mélodie familière à l’auditeur, nulle lassitude tant l’intérêt se renouvelle au fil des pièces, que l’on n’énumérera pas, si diverses, dans des tonalités éloignées, et des tempi changeants.
Avec bonheur, Mathias Vidal, s’empare à bras le corps de ce répertoire si loin de son tropisme baroque. Sa qualité de diction, exemplaire et son engagement expressif donnent la mesure d’un romantisme vrai, y compris dans ses excès dynamiques. Si chacune de ses interventions est un bonheur, nous retiendrons plus particulièrement Hélène, aux 6 couplets savoureux de la ballade archaïsante, La belle voyageuse, que Berlioz déclina sous de multiples versions, Adieu Betty, pour sa force expressive, et Elégie, enfiévrée, avec un piano superbe et complice.
Le chœur de chambre Spirito est idéal dans ce répertoire, fort de ses vingt chanteurs dont certains tiendront des parties de solistes (Amitié, reprends ton empire). Les hommes, souvent sollicités en formation orphéonique, s’y montrent vigoureux, puissants et d’une unité rare. Le Chant guerrier fait forte impression. La Chanson à boire – si loin de nos traditionnelles chansons bachiques – et le Chant sacré, auquel les six voix confèrent la plénitude, les deux ponctués par les récitatifs du soliste, sont exemplaires. Mais c’est encore le Ballet des Ombres, de 1829, entendu auparavant, qui impressionne le plus, par son caractère fantastique (« la sombre horreur de la nuit »), illustré par ses chromatismes et les inflexions du chœur (Hou !… Ha !…). Bien avant la Nuit de Walpurgis de Mendelssohn, Berlioz trouve l’essence même du romantisme le plus fort.
Aux applaudissements fournis d’un public conquis, répond, en bis, le populaire et bienvenu « Plaisir d’amour », de Jean Paul Egide Martini, harmonisé par Berlioz en 1859.
(*) Comment ne pas évoquer la découverte que constitua le premier enregistrement des chœurs que Bernard Têtu réalisa, à Lyon en 1989 ?