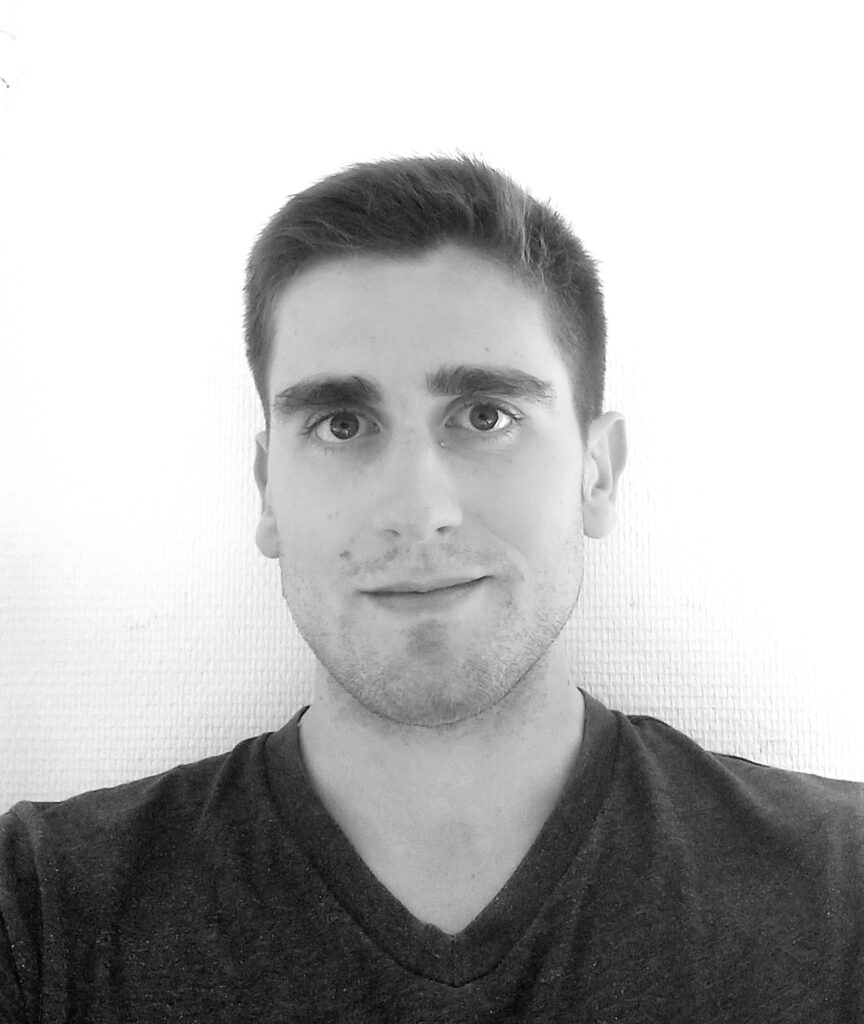Trois ans seulement après la création de son dernier opéra, Il viaggio, Dante, Pascal Dusapin livre une nouvelle partition lyrique, opératorio au sujet antique, comme Penthesilea (2015) et Medeamaterial (1992). Son Antigone est un monolithe dont la musique continument torturée explique moins qu’elle n’accompagne la mécanique macabre enclenchée dans les premières minutes du drame : Antigone, par obéissance aux lois non écrites des dieux, veut offrir à son frère les hommages funéraires, Créon, par obéissance aux lois élémentaires de la cité, non moins puissantes spirituellement, refuse à un ennemi des honneurs indus. La morale grecque héroïque qui a cours dans la tragédie exige que l’on veuille du bien à ses amis et du mal à ses ennemis ; le mythe, alors, pose la question insoluble : que faire lorsqu’une même personne est à la fois ami (frère, neveu) et ennemi (général qui a porté ses armes contre Thèbes) ?
La partition de Pascal Dusapin dégage un expressionnisme d’autant plus frappant que les moyens réellement mis à sa disposition sont plutôt sobres, tout compte fait : le plan sonore paraît rarement complexe, on entend surtout un continuum très horizontal, une longue stase orchestrale plombée dès les premières mesures par une atmosphère angoissante. Ce suspens miroitant de noirceur est parfois perturbé par quelques événements sonores brutaux mais qui n’ont qu’un temps. Les instruments sont utilisés parfois à la limite entre son et bruit, comme ces cuivres laissant échapper de déchirantes déflagrations, une harpe qui fait entendre le métal de ses cordes, même une flûte sonorisée dans l’ouverture de l’œuvre, un parti pris qui augmente la perte des repères sonores du spectateur. Si l’on apprécie beaucoup la force suggestive de cette musique étouffante, on lui trouve un manque de progression, comme face à un monochrome qui vous happerait mais n’en resterait pas moins uniforme. Relevons tout de même quelques percées d’un langage différent, notamment lorsque Hémon évoque son amour pour Antigone, et que s’esquisse à l’orchestre un nuage de douceur, ou à l’inverse dans le premier interlude orchestral, impressionnant de masse soudainement accumulée. L’écriture vocale, quant à elle, navigue volontiers sur la palette du Sprechgesang, tout en réservant quelques grandes lignes saisissantes aux interprètes. La prosodie n’est pas du tout hachée, mais les sauts de registre reviennent régulièrement pour émailler d’intensité les mots du livret.
Ce livret, justement, est composé d’après la traduction allemande, par Hölderlin, de l’Antigone de Sophocle. Dusapin a coupé plusieurs passages dans un souci bien évident d’économie et de concentration. Le principal changement, qui nous paraît constituer un écueil, est la suppression du chœur. Son absence impose d’abord de répartir autrement la parole, puisque dans de nombreux passages les protagonistes dialoguent avec le chœur, qui conseille, commente voire décrit (et donne de précieuses indications scéniques). Ce travail de redistribution est assez bien mené, notamment au moyen de la mise en scène : Créon s’adresse non plus aux vieillards de Thèbes mais à la salle en se positionnant derrière des micros. Mais vers la fin du drame, la présence du chœur est dramatiquement nécessaire pour assurer la cohérence et la continuité scénique : c’est, après le départ de Tirésias, en discutant avec le chœur que Créon décide de revenir sur sa décision et c’est au chœur que le Messager annonce la mort d’Hémon, en l’absence de Créon. Pour s’en sortir, le livret introduit donc un personnage, le Coryphée, dont l’existence serait pleinement pertinente s’il ne surgissait pas sur scène à la fin seulement, tenant ses deux mallettes, sans qu’on sache bien pourquoi il arrive là. Une autre difficulté que crée la suppression du chœur est la perte des parties lyriques qui rythment la tragédie grecque. Entre les épisodes (où les protagonistes parlent) sont normalement intercalés des intermèdes chantés, les stasima, sur des thématiques souvent cosmiques ou religieuses qui mettent en perspective la catastrophe. Le livret de Dusapin réintègre intelligemment quelques vers de ces saisissantes parties chorales dans le monologue d’Antigone.
La mise en scène de Netia Jones est d’une abstraction efficace. Son plateau est occupé pour moitié par six gigantesques colonnes carrées blanches, sur lesquelles sont projetés des rais de lumière ou des taches noires. Une avancée angulaire de la scène accueille un demi-cercle de micros installés comme pour une conférence de presse, tandis qu’un poteau soutient deux écrans. Si on ajoute à cela les costumes sombres, la production est toute de noir et de blanc, ce qu’accentuent les images spectrales diffusées sur les écrans, où l’on voit en différé et au ralenti les protagonistes venus s’exprimer devant les micros.
La distribution ne souffre aucune faiblesse, ce qui, conjugué à la fougue et à la minutie de la direction de Klaus Mäkelä, assure la réussite de la soirée. Grande habituée des opéras de Dusapin, qui lui a écrit cette Antigone sur mesure, Christel Loetzsch est impressionnante d’engagement et de tessiture. L’écriture vocale sollicite très souvent ses graves riches tout en les poussant volontairement dans ses retranchements, où la voix semble forcée, plus crachée que projetée, jusqu’à des sons rauques franchement hurlés. Elle assume avec passion sa dernière scène, monologue gagné par la folie (un peu trop à notre goût du reste, par rapport à l’idée que l’on se fait du personnage). Tómas Tómasson, en Créon, est l’autre pôle dramatique de la soirée. Son cheminement personnel, de l’inflexibilité et de la noblesse outragée au doute puis au désespoir, est parfaitement incarné, au point de devenir le vrai personnage humain face à une Antigone exaltée au point de sembler dangereuse. La ligne soignée et le jeu efficace de Jarrett Ott (un messager) emportent autant l’adhésion que l’Ismène malmenée aux aigus éclatants d’Anna Prohaska ou que le très beau timbre trompetant du ténor Thomas Atkins, qu’on aurait volontiers entendu plus longtemps en Hémon. Mentions spéciales à Edwin Crossley-Mercer, Tirésias à la basse sépulcrale et profonde et à Serge Kakudji (Coryphée), dont la voix de haute-contre est extraordinairement riche en harmoniques.