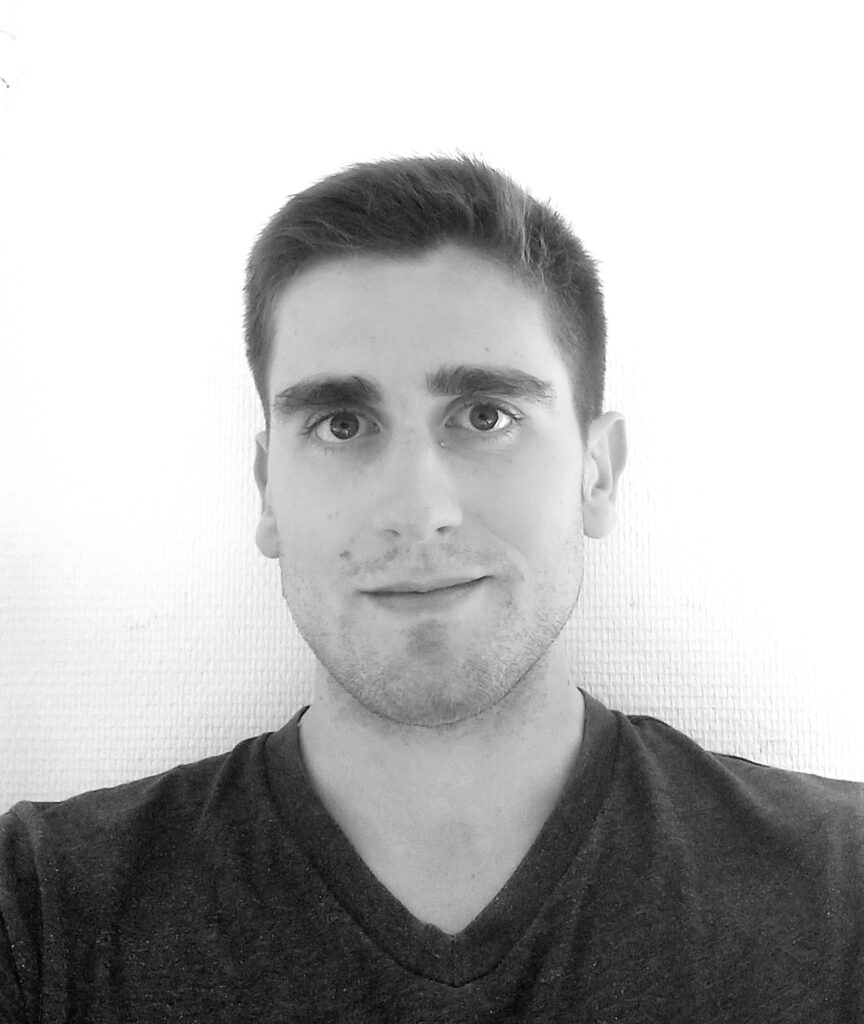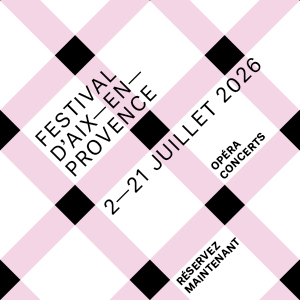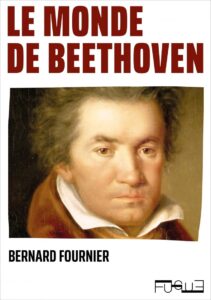L’Aida de Lotte de Beer n’ayant pas survécu à son unique tour de scène en temps de Covid, l’Opéra de Paris accueille la production de la plasticienne Shirin Neshat, créée à Salzbourg en 2022, reprise en coproduction avec le Liceu de Barcelone. La mise en scène statique et bien peu expressive se cherche un propos et croit trouver dans le recours à la photographie et à la vidéo un palliatif qui dessert le drame, laissant un goût d’inachevé à l’issue de la première.
Dans un monde de béton austère et froid, où l’individu n’a physiquement pas sa place puisque tout y est à la mesure du groupe, règne un autoritarisme religieux avide de sang et de conquête qui écrase les liens familiaux et amoureux. Sur le papier, la lecture de Shirin Neshat n’est pas sans pertinence, ni sans (nombreux) précédents. Sa production a été plusieurs fois amendée : la première version de cette Aida remonte à 2017, dans un format sensiblement différent, largement remanié en 2022 pour Salzbourg. C’est peu ou prou cette version que l’on retrouve à Paris, avec quelques ajustements qui visent à atténuer les références à des régimes et religions précis pour proposer un vague Orient qui se réduit à des costumes et à des vidéos figurant un désert. La scénographie a peu de charme : un bloc de béton texturé et creux qui peut se scinder en deux, posé sur l’éternelle tournette. Les lumières accentuent la pâleur sépulcrale de la scénographie en plongeant l’essentiel de l’opéra dans un pénombre dont les chanteurs émergent par des jeux de poursuite lumineuse.
L’introduction d’œuvres de la photographe et cinéaste qu’est avant tout Shirin Neshat ne convainc guère. Certaines de ces œuvres sont antérieures et n’ont simplement rien à voir avec la production, d’autres sont très vaguement reliées à un univers oriental (sables, mer, canot) et tyrannique (lutte entre des hommes armés et de simples citoyens). Ces diversions n’ont qu’un temps et on voit mal l’intérêt, par exemple, de projet la vidéo d’un canot voguant sur la mer au moment de « O terra addio ». Plus gênant peut-être, pendant de longues minutes lors des changements de décor où le public, le chef et l’orchestre patientent, de grands portraits sont projetés sur fond sonore de chuchotements. L’attente est bien longue, et elle est même redoublée, à une occasion, par une procession au pas de figures encapuchonnées, toujours dans le silence. Le public reste perplexe.
Ce qui surtout fait défaut à cette Aida, c’est le théâtre et le sens du drame. La direction d’acteur est pour le moins discrète : les chanteurs sont livrés à des poncifs d’un autre âge, chantant face au public (et même fixant le chef pendant de longues minutes), main sur le cœur ou brandie en l’air, se regardant rarement. Aïda et Amneris n’ont de cesse de se plaquer plus ou moins violemment contre le mur, de dos ou de face, les bras en croix, pour signifier leur malheur et leur trouble. Peut-être parce qu’elle est le personnage le plus dramatiquement complexe de l’opéra, c’est l’Amneris d’Ève-Maud Hubeaux qui pâtit le plus de cette absence de théâtre, et la chanteuse s’agite d’un bord à l’autre de la scène en balançant son immense traîne de gaze tantôt fièrement, tantôt rageusement.
S’il est vrai que le statisme est un mal qui guette toute Aida, la stérilité théâtrale du plateau est particulièrement marquante dans cette production. La scène se résume pendant l’immense majorité de la soirée à un tableau figé, sans autre composition que l’alignement ou l’étagement soigneux des choristes. On excepte une unique scène qui nous a semblé assez bien fonctionner, celle du jugement de Radamès, où la projection inquiétante des immenses silhouettes de pseudo-mollahs vêtus de rouge écrasant Amnéris introduisait enfin une dynamique visuelle.
© Bernd Uhlig
Côté musical, Michele Mariotti demeure une valeur sûre de l’opéra verdien, mais on l’a trouvé moins percutant que lors de l’Aida en streaming de 2021. Il est même possible de se demander à quel point la mise en scène n’anesthésie pas un peu le drame à l’orchestre. Le troisième acte a trouvé le chef plus engagé et plus nerveux, trop peut-être : le finale de l’opéra, un peu pressé et aux accents très marqués, n’avait pas les funestes teintes de crépuscule qu’on aime y trouver. L’orchestre de l’Opéra de Paris semblait lui-même dans une relative méforme, affichant certaines latences de réaction aux mouvements du chef et quelques problèmes d’intonation, notamment du côté des cordes. Ce n’était pas le cas des chœurs, très sollicités, qui affichaient de belles dynamiques et quelques moments de grâce, avec des couleurs intérieures très bien trouvées dans les chœurs alternés de la deuxième scène du premier acte.
Le Ramfis d’Alexander Köpeczi et le Roi de Krzysztof Bączyk avaient des qualités semblables : les deux basses ont un timbre charnu, une belle projection jamais forcée, avec en outre pour Alexander Köpeczi un agréable legato et une intelligence scénique évidente qui lui permettait d’incarner avec brio ce rôle mineur. On aime beaucoup le timbre de Margarita Polonskaya en Sacerdotessa, profond et riche, agile dans les quelques ornements de la ligne qui lui est confiée. Le messager de Manase Latu est musicalement anecdotique et sa projection limitée ne permettait pas de se faire une idée des capacités de sa voix. En Amonasro, Roman Burdenko est un peu brusque mais comme cela n‘est pas sans coller au rôle, on retiendra surtout l’engagement scénique du baryton russe, tout à fait crédible en chef de guerre humilié et obsédé par la vengeance.
C’est dans la grande scène du jugement qu’on prend la mesure de l’Amneris d’Ève-Maud Hubeaux. On trouvait jusque-là que le rôle excédait un peu ses moyens, pourtant exceptionnels, notamment en raison d’un bas-medium étouffé et de graves forcés, ainsi que d’attaques imprécises et souvent tendues dans l’aigu. Mais il faut reconnaître qu’au quatrième acte la voix a chauffé, ne souffre plus d’engorgements dans certains registres et se déploie avec un héroïsme expressif qui emporte l’adhésion.
Saioa Hernández possède toutes les notes du rôle d’Aida, ce qui n’est pas rien. On lui reconnaît une émission assurée, un timbre agréable plutôt métallique sans rien d’excessif et une belle homogénéité sur tous les registres. Mais cette voix puissante ne fait pas entendre d’inflexions et de nuances, et les sons se contentent d’exister pendant la durée prévue par la partition. Le souffle est un peu court, le legato fait défaut et finalement l’émotion nous manque, surtout dans des passages aussi chargés de drame que l’imprécation pitoyable « Numi, pietà » ou la prière nostalgique « O patria mia » (certes assumé jusqu’à son contre-ut redoutable).
Piotr Beczała domine sans aucun doute le plateau vocal. Dès les premières notes, il impose la projection facile et le timbre solaire de son Radamès scéniquement engagé. Il triomphe en détente des difficultés de « Celeste Aida », offrant le luxe d’un très beau crescendo sur le si aigu. Il est martial sans être matador, tient tête dans les duos au soprano affirmé de Saioa Hernández, nous offre un « Sacerdote, io resto a te » crânement tenu, moire les dernières mesures de « O terra addio » de couleurs émouvantes et, de façon générale, insuffle au général égyptien une dose d’émotion et de crédibilité qui lui vaut une juste ovation au moment des saluts.