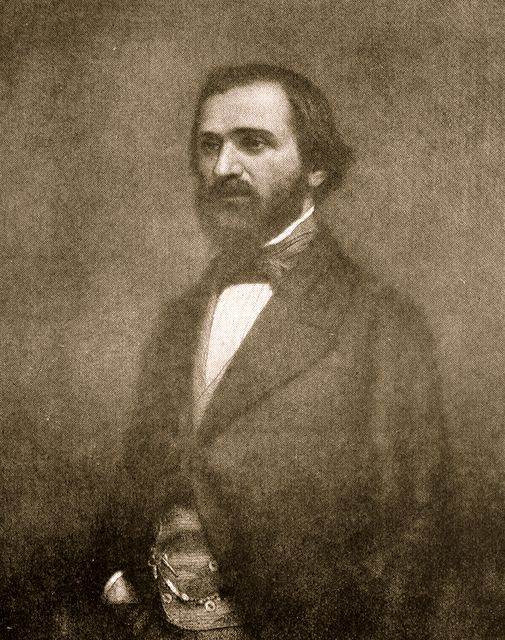Face au succès et au renom grandissant du jeune compositeur trentenaire, c’est tout naturellement que le San Carlo de Naples veut à son tour « son » Verdi, après la Fenice de Venise (Ernani), l’Argentina de Rome (I due Foscari) et la Scala de Milan – qui avait déjà eu 5 des 7 opéras composés par Verdi jusqu’au début de 1845. Le compositeur n’est pas contre, mais il ne saute pas de joie non plus. Il est épuisé et parlera plus tard de cette période comme de ses « années de galère ». Mais peut-il refuser Naples dans son tour triomphal de la péninsule ? Marché conclu au printemps 1845 !
Vincenzo Flaùto, directeur artistique du San Carlo qui a succédé au célèbre Domenico Barbaja pour ce qui concerne la programmation du théâtre napolitain, ne laisse pas vraiment à Verdi le choix du livret, qui sera construit à partir d’Alzire ou les Américains de Voltaire, une pièce de 1736. Verdi ne renâcle pas trop puisqu’il pense que la pièce est assez simple pour être rapidement adaptée, bien qu’il la trouve assez faible dramatiquement. Flaùto ne lui laisse pas davantage le choix du librettiste, et impose le très prestigieux Salvatore Cammarano, fournisseur officiel du San Carlo et auteur de nombreux opéras de Donizetti. Verdi le retrouvera d’ailleurs plus tard (La bataille de Legnano, Luisa Miller et Le Trouvère). Or, si ce dernier pouvait torturer à volonté son cher Piave (qui vient de lui faire deux livrets pour Ernani et I Due Foscari) pour lui imposer de plier ses vers à sa musique, il n’en va pas de même aussi facilement avec Cammarano. Il l’inonde quand même de lettres entre fin mai et début juin, un peu exaltées, qui révèlent pour certaines son espoir de réussir une belle oeuvre. Fin juin, le compositeur est à Naples, qui est une ville qu’il n’aimera guère. Il la trouve bruyante, trop mondaine, sans parler de la censure et de l’administration pesante et très lente du théâtre (« Ici, tout se fait avec un siècle de retard » pestera Verdi dans une lettre). C’est au demeurant pour lui un supplice qu’il ne dénoncera pas qu’à Naples… Voyez ce qu’il disait de l’Opéra de Paris !
Cammarano n’y va pas par quatre chemins et taille à grands coups de ciseaux dans la pièce originale. Exit les messages philosophiques et anticolonialistes qui n’auraient pas nécessairement plu à la Cour et au public très conservateurs de Naples. On en reste à un mélodrame romantique des plus communs pour assurer le succès : amours contrariés du ténor et du soprano à cause du vilain baryton, envahisseur de surcroît, qui épouse de force la jeune princesse inca. Le vaillant ténor se venge et tue le vilain baryton qui pardonne à tous et tout est bien qui finit bien (sauf pour lui).
À Naples, Verdi peut préparer directement son opéra tout en continuant à le composer, puisqu’il est programmé pour la saison d’été du San Carlo. La distribution retenue est de bon niveau telle que voulue par Verdi, qui sera toujours très exigeant en la matière : Eugenia Tadolini pour le rôle-titre, le ténor Gaetano Fraschini en Zamoro et le baryton Filippo Coletti en Gusmano. Verdi compose « come un pazzo » (comme un fou). Il est malade, souffre de laryngite et se plaint du climat. Son épuisement général n’aide pas et pourtant il doit cravacher s’il veut finir à temps. Dès que les morceaux sont prêts, ils sont distribués aux chanteurs. Fin juillet, on commence à répéter et à ajuster certains airs. Pour respecter la volonté locale d’opéras brefs et nerveux, on coupe, on remanie, on refait, durant les premiers jours d’août. Tout le monde est sur les nerfs.
La création de cette Alzira, voici juste 180 ans ce 12 août, est donc sans surprise un demi-échec, même si le public applaudit beaucoup durant la représentation. Verdi ne se faisait pas d’illusions : Naples est réputée pour ses cabales et il semble que l’entourage de Mercadante lui ait savonné la planche. L’oeuvre, en-deçà des précédentes production fait le reste. On la retire assez vite de l’affiche et le compositeur pense à la remanier un peu tranquillement en vue de la création romaine, prévue à l’automne suivant. Mais finalement, contrairement à ce qu’il fera plus tard pour Simon Boccanegra, qu’il aimait particulièrement, Verdi ne cherchera pas à sauver cette œuvre : « Cet opéra me fait mal au ventre ; y toucher ne ferait qu’empirer les choses ».
À Rome, le four est complet. Verdi relègue donc lui-même la partition dans ses placards et on n’en entend plus parler pendant plus d’un siècle. Tout n’est pourtant pas à jeter dans cette oeuvre qui contient quelques pages caractéristiques du style verdien d’alors. La presse s’en fait d’ailleurs l’écho, mais souligne aussi que tout ceci tourne un peu à vide.
C’est un extrait de sa reprise historique à Rome en 1967 que nous proposons ici, dans un son perfectible, avec un orchestre un peu atone, mais qui donne l’occasion plutôt rare, d’entendre dans le rôle titre Virginia Zeani, grande artiste un peu oubliée aujourd’hui mais qu’une réédition de ses récitals par Decca remettait heureusement en lumière voici quelques années.