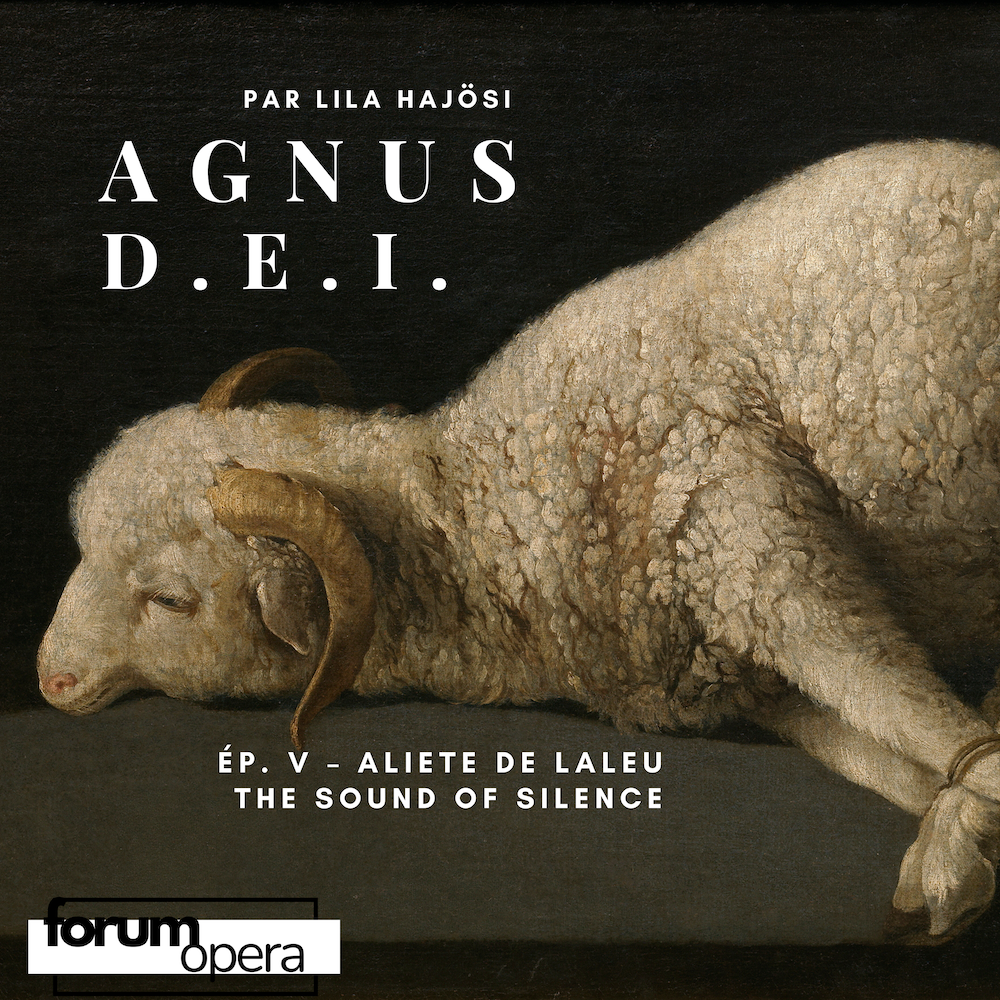Le 27 mars 2019, le rideau tombait définitivement sur la carrière scénique d’Edita Gruberova. Après 45 minutes d’applaudissements, les fans émus rangeaient pour toujours les banderoles et calicots auparavant suspendus aux balcons et clamant leur amour pour « Edita l’unica ! ». Rarement aura-t-on connu un fan-club aussi efficace et dévoué et, avec ces adieux, c’est peut-être la fin d’une époque, celle d’une adulation fusionnelle avec une diva. Quelques années auparavant, Raina Kabaivanska avait son autobus rempli d’admirateurs qui la suivait dans toute l’Italie : les mauvaises langues disait qu’elle payait le plein et fournissait les invitations. On lui doit deux adieux « définitifs » au rôle de Tosca, une fois à Parme, une autre à Lisbonne : l’offre ne suffisait pas à la demande. Depuis, aucune chanteuse n’a eu de tels fidèles et les divas d’aujourd’hui ont choisi généralement la proximité factice des réseaux sociaux administrés par des professionnels.
Le phénomène persiste toutefois pour les ténors, race à part dont l’effet sur la gent féminine n’est plus à démontrer. Symboles de la virilité extravertie, les ténors ont ainsi des admirateurs bien organisés. Si certains fan-clubs se contentent d’échanger des photos, d’annoncer des dates de réservation à l’avance, ou de s’échanger prioritairement entre eux des billets, d’autres sont le siège de batailles internes et de haines féroces pour gagner les premières places dans le coeur de l’idole. « Coucou ! Coucou ! » crie mamie avant de se retourner presque en larmes vers sa petite-fille qu’elle a trainée au spectacle : « Il ne m’a pas reconnue… ». Compatissante, celle-ci la rassure « Mais si mamie, j’ai bien vu qu’il te souriait », et le visage s’éclaire. Parfois, l’après-représentation compte davantage que le spectacle lui-même (le ténor aura de toute façon été exceptionnel : inutile d’épiloguer là dessus, toute opinion déviante serait répétée à l’intéressé par une bonne âme, et le fan finirait ostracisé). C’est alors la ruée des « cheveux bleus » vers les coulisses. Car il faut être en bonne place pour célébrer l’artiste dès sa sortie de scène, mais sans arriver trop tôt, ce qui pourrait laisser supposer que l’on n’a pas applaudi jusqu’au bout. A l’occasion, il peut être utile de réviser le livret : alors que je suis accoudé au balcon de d’une loge du Liceu, ma voisine intriguée me demande ce que j’attends. « Mais… le dernier acte ! ». Rouge de confusion, elle m’explique que sa fille est partie féliciter Plácido Domingo, croyant l’opéra terminé. La jeune femme revient, verte. Aucune d’elles n’avaient entendu parler du sublime « Poveri fiori », sommet de l’acte IV d’Adriana Lecouvreur. Il faut dire qu’il est dévolu au soprano, une certaine Mirella Freni ce soir-là…
Comme on le voit, le métier est rude. C’est peut-être pourquoi certains fous lyriques choisisent de s’attacher aux pas d’artistes moins célèbres, pour lesquels la concurrence post-concert est moindre, voire quasi nulle. C’est un peu comme draguer les moches. On voit ainsi des spectateurs parcourir des milliers de kilomètres, en micheline diesel sur des lignes non électrifiées, pour entendre les pénibles efforts d’une sympathique chanteuse sostranienne, ou tel chef malhabile diriger Le Comte Obligado en patois sudète, dans un petit théâtre à la frontière moravo-silésienne (le titre de cet ouvrage est moins connu que le tube qui en fit sa renommée : La Fille du Bédouin). On se retrouvera après le spectacle pour un bon bortsch, le meilleur moment de la soirée avant un dodo bien mérité dans la caravane.
A cette hystérie collective, nous préférons la folie individuelle. A tout seigneur, tout honneur : on ne peut pas oublier le chouchou de notre collègue Catherine Scholler, l’incroyable Monsieur Armand. Pendant des décennies, il fut la terreur des services de sécurité : en fin de concert, il s’avançait avec un feu d’artifice miniature qu’il déposait aux pieds de ses divas favorites (non sans avoir écrasé sans aucune gêne ceux des spectateurs du premier rang). Les feux de Bengale cachaient en fait une pâtisserie que l’ancien expert-comptable avait lui-même préparée. Malgré ses apparences de doux vieillard fêlé mais sympathique, Monsieur Armand était une véritable teigne, n’hésitant pas à utiliser injures et menaces physiques pour tricher dans la file d’attente des places soldées au dernier moment. On entendait alors des éclats de voix (généralement : « espèce de malade ! »), et on voyait le vieillard sec, dont la haute taille dominait la queue, brandir le poing tandis que son visage affichait un horrible rictus.
Les bagarres dans les files d’attente ne datent pas d’aujourd’hui. Dans les années 80, l’Opéra de Paris proposait, quatorze jours avant la date de sa représentation, quelques dizaines de places pour chaque spectacle. C’était à peu près la seule façon d’obtenir des places économiques quand on n’était pas un abonné. Une curieuse tradition voulait que les quatre premiers titulaires d’une carte d’invalidité passent en alternance devant toute la file d’attente : le premier prioritaire était suivi du premier de la file d’attente et ainsi de suite jusqu’au quatrième. Le cinquième titulaire d’une carte d’invalidité prenait la place correspondant à l’heure de son arrivée, c’est-à-dire bon dernier. Mamie Priorité arrivait toujours la première, un quart d’heure pile avant l’ouverture de la location. On racontait qu’elle avait été la maîtresse de Richard Wagner, et autres plaisanteries du même niveau. Elle n’était que rarement devancée mais, si la chose la contrariait sur le principe, le mal était nul puisqu’elle choisissait systématiquement l’un des deux strapontins en extrémité de première rangée, vendus un peu moins chers. Ces deux places étaient en effet déclassées comme « sans visibilité » car une barre métallique de protection, en U inversé, venait barrer la vue des spectateurs de taille normale. Complètement ratatinée, Mamie Priorité n’éprouvait aucune gène, car sa tête venait intégralement s’encastrer dans le carré formé par le garde-corps de l’amphithéâtre et les trois côtés métalliques. Elle jouissait ainsi du spectacle comme à travers une lucarne ainsi que d’un trajet optimisé vers les toilettes.
L’annonce de la venue de Luciano Pavarotti pour chanter Un Ballo in maschera en 1985, déclencha une demande de places proprement démentielle. C’est à cette occasion qu’apparurent à Paris les premiers revendeurs au marché noir (ceux qu’on appelle « scalpers » à New-York, et contre lesquels l’administration de l’OnP ne fit jamais grand-chose). L’ambiance était particulièrement électrique pour la queue précédant de quatorze jours la première. Cette fois Mamie Priorité fut devancée par des « nouveaux ». Pire, ceux-ci refusèrent la règle. L’un deux, vieillard portant beau, éructait : « Moi, je suis un ancien blessé de guerre ! Je ne suis pas comme ces vieux débris, ces débiles ! C’est à moi de passer en premier ». Il avait pourtant l’air en pleine forme. Joignant le geste à la parole, il entreprit de faire son chemin à coups de canne, déclenchant, dans la queue des priorités, une bagarre générale. Il fallu faire intervenir la sécurité et plus d’un « prioritaire » ne retrouva jamais son dentier. L’épisode est passé à la postérité sous le titre de Guerre des béquilles. Le pire, c’est que Luciano annula sa venue, laissant sa place à l’un des plus exécrable ténors de l’époque. Celui-ci fut même interrompu par une bronca au moment de sa mort, incident déclenché à la suite des cris d’un spectateur qui avait hurlé, à l’attention du baryton, « Achève-le ! ». Mais ceci est une autre histoire.
« Magnifique ! ». L’homme est âgé, peut-être fait-il plus vieux que son âge. Visage gris, cheveu rare, corps sec et élancé, long comme un jour sans pain, mais ses yeux sont brillants, émerveillés comme ceux d’un enfant. Le Magnifique est en admiration complète devant une grande soprano colorature. Il la suit partout, en France du moins, et lui fait livrer des tombereaux de roses. A l’entracte ou à la fin du spectacle, dans les coulisses, ses yeux s’éclairent et il vous salue d’un « Magnifique ! Elle était magnifique ! ». Au vu de la différence d’âge, et de physique (le soprano est dans la plénitude de sa beauté mature), on imagine que le Magnifique n’envisage qu’un amour platonique, même si l’homme est encore très présentable, d’une sobre élégance rehaussée par un noeud papillon plein de fantaisie. Il m’avouera un jour, un peu exaspéré, qu’il aurait bien aimé être payé en retour, et avec autre chose que des paroles aimables, que les « merci pour les roses », ça allait cinq minutes, et que la dame faisait fausse route en s’amourachant de ses metteurs en scène pour des aventures sans lendemain. Ce fut une révélation. Le Magnifique a d’autres grands projets. Par exemple, celui de convaincre plusieurs chaînes de télévision de diffuser simultanément le même opéra, en direct, chacune avec un plan fixe. En zappant, le spectateur pourra construire sa propre exploration vidéo, sans être soumis aux choix arbitraires du réalisateur télévisuel. L’idée est géniale, mais le Magnifique ne reçoit que des refus polis. Une autre de ses marottes consiste en la création d’un fonds unifié d’archives audio, vidéo, photographiques, du spectacle vivant. On y rendrait accessible toutes les captations officielles, mais aussi les enregistrements « pirates », les photos prises en répétition ou par des spectateurs, pour offrir, pour une production donnée, l’ensemble des documents disponibles. Le Magnifique vous montre avec jubilation les lettres de soutien reçus de personnalités du monde du spectacle, de politiciens décédés, d’académiciens liquides, des courriers du ministère l’informant de l’intérêt de son projet… Les années passent, mais rien n’avance, ou mal. « J’ai montré mon projet à Untel. Depuis plus de nouvelles. Maintenant j’apprends qu’il veut faire une médiathèque adossé à son festival et qu’il cherche à récupérer des subventions en utilisant mes parrainages ! Je vais protester auprès du ministère ». Le Magnifique est un rêveur sublime.
Monsieur Armand disait avoir accumulé 10.000 programmes et photos dédicacées. A New-York, Lois en aurait dix à vingt fois plus. Il faut dire que cette habituée des coulisses du Metropolitan Opera fait signer à peu près n’importe quoi : des programmes, des pochettes de disques, mais aussi des publicités pour les chaussures Mephisto (à Samuel Ramey), pour les cigarettes Merit (Chris Merritt) ou Philip Morris (James Morris) ! En attendant que le pauvre chanteur ait fini de signer une vingtaine de documents plus farfelus les uns que les autres, Lois s’étend sur la prestation du jour. Et ce n’est pas nécessairement aimable. Avec une absolue candeur, elle distribue bons et mauvais points, ce qui lui vaudra d’être interdite de coulisses par le Metropolitan Opera pendant 10 ans. Au chapitre des interdictions au Met, citons aussi celle-ci. Pendant des années, les spectacles les plus remarquables étaient accueillis par un lancer de confetti devant le rideau. Il s’agissait en fait de bandes de papier, découpées dans des magazines, qui tombaient du dernier balcon dans un tourbillon du plus bel effet. Ces lancers, initialement exceptionnels, se généralisèrent un peu trop, et le Met en eut assez de passer l’aspirateur tous les soirs. Ils furent donc interdits (à Bastille, le problème a été traité à la racine : il n’existe aucun endroit d’où on puisse lancer des fleurs ou des tomates sur les artistes et c’est toujours ça de moins à nettoyer). A la faveur d’une soirée vraiment unique toutefois, on pourra avoir la surprise de revivre cette ancienne tradition new-yorkaise.
Le Met est sans doute l’endroit où l’on rencontrait le plus de gens bizarres. Helen Quinn eut droit à sa notice nécrologique dans le New-York Times. Pendant plus de trente ans, de 1966 à sa mort stupide en 2000 (une intoxication alimentaire), elle administra chaque weekend la file d’attente pour les places debout. Fille de militaire, elle avait réussi à imposer un système efficace à base de numéros d’ordre et d’appels réguliers, indépendant de l’institution, mais tacitement accepté. Grâce à elle, on pouvait se rendre chaque samedi matin devant le Met pour acheter sans trop de stress les « standing room » pour la semaine à venir. Helen se voulait ferme, mais juste ! La loi et l’ordre. Pour le gala du centenaire, la file avait commencé la veille dans l’après-midi. Sur présentation de nos billets, nous avions pu être dispensés d’un appel nocturne afin d’assister à une représentation de La Bohème le soir même. A minuit, devant l’affluence, une seconde queue se mit en place, espérant devancer la file officielle. Solide comme un vieux capitaine à travers la tempête, Helen demanda à voir la direction et, malgré l’heure tardive, obtint son soutien. Ses troupes purent même passer la nuit dans le parking et le matin, le Met distribua thés et cafés. Ce fut vraiment son heure de gloire et le destin l’aura emportée avant que le « progrès » ne la rende inutile : les « standing room » sont désormais vendus par Internet, et seul un carré de fidèles perpétue la tradition de la file d’attente.
A l’heure où quasiment tous les spectacles sont retransmis via Internet, les anciens « pirateurs » ont laissé la place à une nouvelle espèce. Autrefois, ceux-ci enregistraient discrètement les représentations sur de petits appareils posés sur leurs genoux. La crainte du voisin dénonciateur, ou du son qui sature à cause des coups de feu du peloton d’exécution de Mario, rythmaient leurs soirées. Les rares échanges ne se faisaient qu’entre gens de confiance, et plus d’une collection est partie à la poubelle après le décès de son propriétaire. On racontait qu’un collectionneur new-yorkais était mort de chagrin après avoir vu ses enregistrements confisqués par la police et détruits sur plainte d’une chanteuse. Il ne causait pourtant pas grand mal, et on s’étonne de ces deux poids, deux mesures quand les multinationales du disque en font aujourd’hui tout autant, mais certes pas bénévolement. Quelque part dorment ainsi des trésors que nous n’entendrons jamais, d’autres sont définitivement perdus : le Magnifique avait raison. Les smartphones et Internet ont tout changé : on filme en pleine représentation, au mépris de l’inconfort des voisins, et le lendemain, c’est posté sur YouTube, parfois avec la bénédiction de l’artiste s’il était en pleine forme. Sinon, la vidéo est retirée, puis revient, puis disparait complètement : avec la génération zapping, il n’y a plus grand monde pour s’intéresser à une représentation vieille d’un an.
Pour revenir un instant aux ténors, évoquons la sulfureuse Lucienne Goldfarb, récemment disparue, plus connue sous son nom de guerre de Katia la Rouquine, qui tenait un bordel dans le XVIIe arrondissement et servait d’indicateur à la police française (et selon certains, à la police allemande…). Le nom même de l’établissement était une profession de foi : il était baptisé le Del Monaco, en hommage au grand chanteur italien. L’opéra et les ténors furent la passion de Lucienne. On pouvait encore la croiser, rabougrie et décrépite, mais avec toujours le même feu dans le regard, aux représentations de Cyrano de Bergerac au Châtelet : Plácido Domingo fut son dernier grand amour.
Membre de l’Académie Française de Médecine, le Professeur Pessac ne se rendait jamais en Allemagne ou en Autriche : la raison précise m’en fut connue un mois avant une mort qu’il s’était choisie. Il faudra un jour raconter son histoire. On était sûr en revanche de le croiser à New-York où il avait son rond de serviette, mais où il ne prenait jamais de billets à l’avance. Dix à vingt fois dans l’année, au hasard de ses voyages professionnels, on le retrouvait au guichet attendant un retour pour un spectacle complet depuis des mois. Je ne l’ai jamais vu rester à la porte.
Il faut dire que les guichetiers du Met savaient reconnaitre les vrais amateurs. Fan de Pavarotti, ma mère rêvait de l’entendre dans Turandot, un ouvrage qu’il n’avait chanté qu’une fois auparavant. Nous partons pour un long weekend, sans sésame pour la précieuse représentation. Au guichet, nous attendons de retirer nos places pour les autres soirs : une Carmen avec Graves et Domingo, Ariadne auf Naxos avec Voigt et Dessay, Manon avec Fleming et Giordani (heureuse époque). Nous entendons les amateurs pleurer pour un billet. Sans succès. Quand notre tour vient, nous posons la même question. Le guichetier s’en va, discute un peu derrière le comptoir, puis revient en sifflotant la Marseillaise. Il nous propose deux tickets sublimes… et peu chers. Alors que nous nous confondons en remerciements, il nous coupe : « pour les gens comme vous, il y aura toujours des places… ». Mais pourra-t-on saluer le ténorissimo à l’issue de la représentation (le fan en veut toujours plus) ? A l’époque, il était assez facile d’aller dans les loges. On laissait un mot au gardien expliquant qu’on souhaitait féliciter tel artiste, et à fin du spectacle, vous aviez votre nom sur la liste. Hélas, 300 personnes ont déjà été acceptées : impossible d’en accueillir davantage pour des raisons de sécurité. On le devine, la mama est bien triste, mais je la rassure : 300 personnes, 45 secondes par fan… on reviendra trois heures après la fin du spectacle, et on guettera Luciano à la sortie du parking (le spectacle était donné en matinée). Un ténor, qui plus est un ténor italien, ne laissera jamais une femme sur le bord de la route , même à soixante-dix ans passés. La représentation commence. Luciano chante Calaf divinement. Sa souffrance physique est visible, mais pas audible : il vient d’être opéré des genoux, et de puissants figurants le soutiennent dès qu’il doit parcourir la scène. Trois heures après le baisser du rideau jaune de l’opéra, c’est le rideau de fer du parking du Met qui se lève. En sort une immense limousine à l’interminable capot digne des dessins animés de Tex Avery : le chauffeur met le clignotant, prêt à ramener chez lui le chanteur. Mais, à travers la vitre fumée, on voit la grosse patte de Pavarotti qui fait un signe. La voiture s’arrête. Luciano baisse la vitre et ouvre la portière. Tout d’un coup son immense sourire éclaire l’avenue déserte et le ciel n’est plus gris. Bonhomme malgré la fatigue, il signe un dernier programme avant de repartir en saluant de la main. C’est ce qui s’appelle le don de soi.
Les fous sont parfois bénis des dieux.