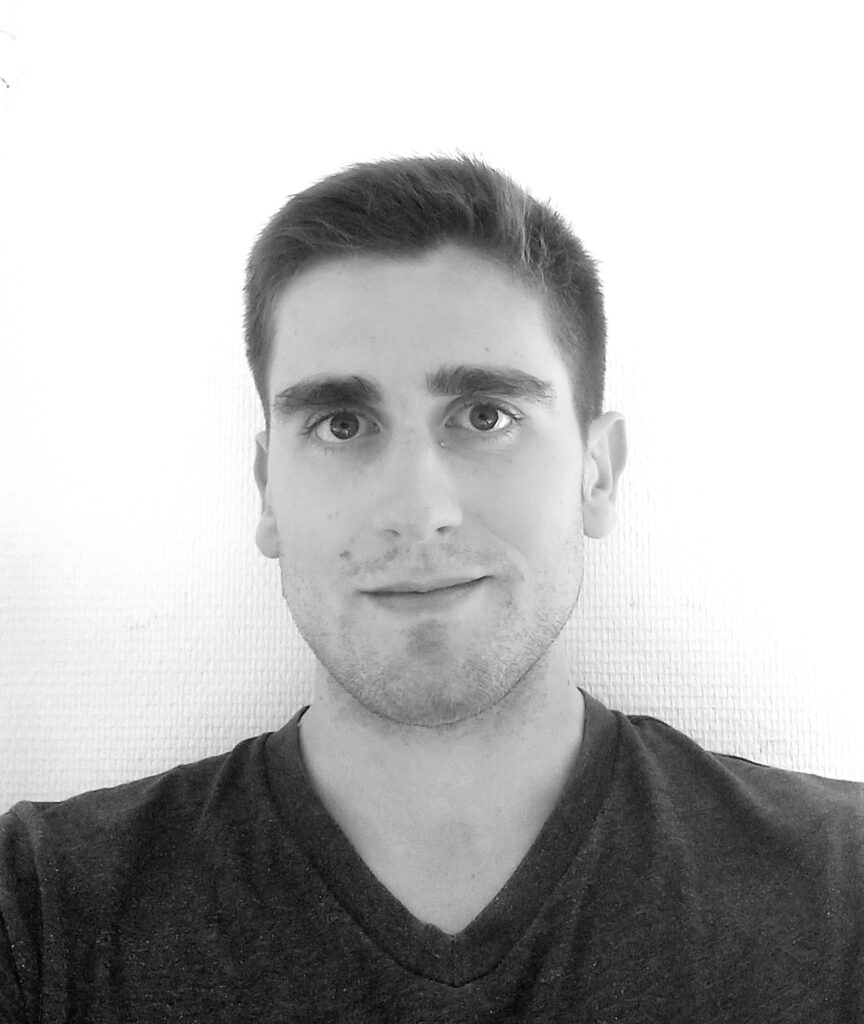L’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns ouvrait ce jeudi 4 décembre les festivités de Noël au Théâtre des Champs-Élysées, qui arborait pour l’occasion ses plus belles décorations. Cet oratorio, trop rarement donné, est l’œuvre d’un compositeur de 23 ans qui occupe depuis un an le prestigieux poste d’organiste de l’église de la Madeleine à Paris. L’esprit de jeunesse qui a présidé à la création de l’œuvre flottait encore sur la salle de l’avenue Montaigne, puisque les cinq solistes étaient des chanteurs de l’Académie de l’Opéra national de Paris, tandis que les chœurs étaient confiés à des lycéens de Paris et de Fontainebleau. L’exécution proposée, à défaut d’être irréprochable, était portée par une bonne dose d’enthousiasme et, surtout, par la baguette d’un chef inspiré.
La première partie du concert était consacrée à une œuvre presque contemporaine de l’Oratorio de Noël, la première symphonie en ré majeur de Charles Gounod, maître de Saint-Saëns. Thomas Hengelbrock dirige de mémoire, avec une élégance joueuse qui fait ressortir toute la brillante simplicité de cette œuvre dont les mélodies jaillissent avec une forme de nonchalance particulièrement rafraichissante, jusqu’à une cavalcade teintée d’humour dans le finale.
Place ensuite à l’oratorio de Saint-Saëns. Le magnifique orchestre de chambre de Paris, visiblement en pleine osmose avec son chef, propose un prélude très habité, qui fait ressortir une puissance d’émotion, voire un romantisme qu’on n’avait jamais encore remarqué dans ces quelques mesures, sans rien trahir de l’horizon pastoral qui place d’emblée l’œuvre sous le signe de la nativité. Le frémissement joyeux de la bonne nouvelle à venir est toutefois quelque peu coupé par l’étonnant son qui remplace l’entrée de l’orgue. Car les splendides tuyaux d’orgue que l’on voit au-dessus de la scène du théâtre ne sont pas factices mais ils sont, hélas, hors d’usage. L’instrument trouvé en remplacement, une sorte d’harmonium, produit un son nasillard et peu puissant, ce qui est un comble quand on sait que Saint-Saëns était l’organiste le plus réputé de son temps et qu’il jouait à la Madeleine sur un Cavaillé-Coll de première classe. Il était dommage, dès lors, que l’orgue soit quasiment inaudible dans toutes les parties où il ne jouait pas seul.
Puis les voix rentrent et un autre détail nous titille d’emblée : le choix de la prononciation gallicane du latin (c’est-à-dire à la française). Bien sûr, on nous fera remarquer qu’à l’époque de Saint-Saëns il est hors de doute qu’on ne prononçait pas le latin à l’italienne. Oui mais voilà : une interprétation est une actualisation, et cette mise à jour n’est pas un compromis ou un pis-aller, elle est prévue par le fait même de jouer dans le présent des œuvres écrites dans le passé. Saint-Saëns, à son époque, faisait chanter ce qui semblait normal et compréhensible à ses contemporains, pourquoi ne pas faire de même aujourd’hui ? C’est un détail qui a son importance, d’abord parce qu’on est si peu habitué à entendre le latin prononcé ainsi qu’on ne comprend quasiment rien de ce qui est chanté, ensuite parce que l’effet produit est souvent comique pour des oreilles modernes (« les tentures ces lits » pour « laetentur caeli »…). Surtout, quoi qu’on pense de ce choix, la cohérence s’impose, or on entend à de nombreuses reprises chez les solistes des retours de la prononciation italienne (par exemple des [u] prononcés [ou]) et on remarque que la prononciation d’un même mot n’est pas totalement homogène entre les chanteurs.
Les chanteurs en résidence à l’Académie de l’Opéra de Paris forment un quintette agréable, recelant de belles qualités musicales, qui aurait néanmoins pu témoigner un peu plus de la joie pétillante qui anime l’orchestre et qui convient à l’esprit de l’œuvre.
Bergsvein Toverud est un ténor claironnant au timbre cuivré, qui dispose de graves sonores et d’une élégance indéniable, capable de quelques piani bien émis dans les ensembles. Sa prononciation laisse cependant à désirer (on n’entend, curieusement, ni ses [t] ni ses [d]). Le baryton Clemens Frank est ce soir un peu en retrait, notamment en raison d’une projection limitée et d’une émission intérieure comme émoussée. Le trio féminin est très réussi, notamment car les trois couleurs vocales sont parfaitement définies et accordées entre elles, produisant le meilleur effet dans le quintette. Amandine Portelli dispose d’un instrument prometteur qui capte tout de suite l’intérêt de l’auditeur en raison de son authentique couleur d’alto : la voix est ample, riche et profonde. On croit deviner une petite instabilité du souffle qui dérègle légèrement l’intonation dans les valeurs longues, mais cela n’efface en rien le pouvoir de séduction de sa voix. La mezzo Sofia Anisimova convainc dans son air « Expectans expectavi Dominum » par la densité de son timbre lumineux. Le soprano angélique et superbement projeté d’Isobel Anthony est assurément l’un des points forts de la soirée. Elle marque notamment par sa couleur très française, bienvenue dans ce répertoire. Elle sert sa partie avec agilité, netteté et émotion et témoigne d’une qualité d’écoute de ses confrères qui permet de beaux moments d’équilibre dans les ensembles, comme dans le trio « Tecum principium » (malgré la discrétion du baryton).
On ne peut qu’encourager les initiatives de diffusion de la culture musicale, surtout quand des lycéens se voient donner l’opportunité de travailler avec un chef comme Hengelbrock – opportunité dont les classes des lycées François Ier (Fontainebleau), La Fontaine et Lamartine (Paris) se sont saisis avec un enthousiasme communicatif. On passera donc sur les faiblesses intrinsèques d’un tel chœur (notamment les voix masculines grossies dans les graves, émises avec plus de force que de musicalité et un « Quare fremuerunt gentes » qui perd forcément un peu de son caractère grandiose) pour saluer leur degré de préparation évident.