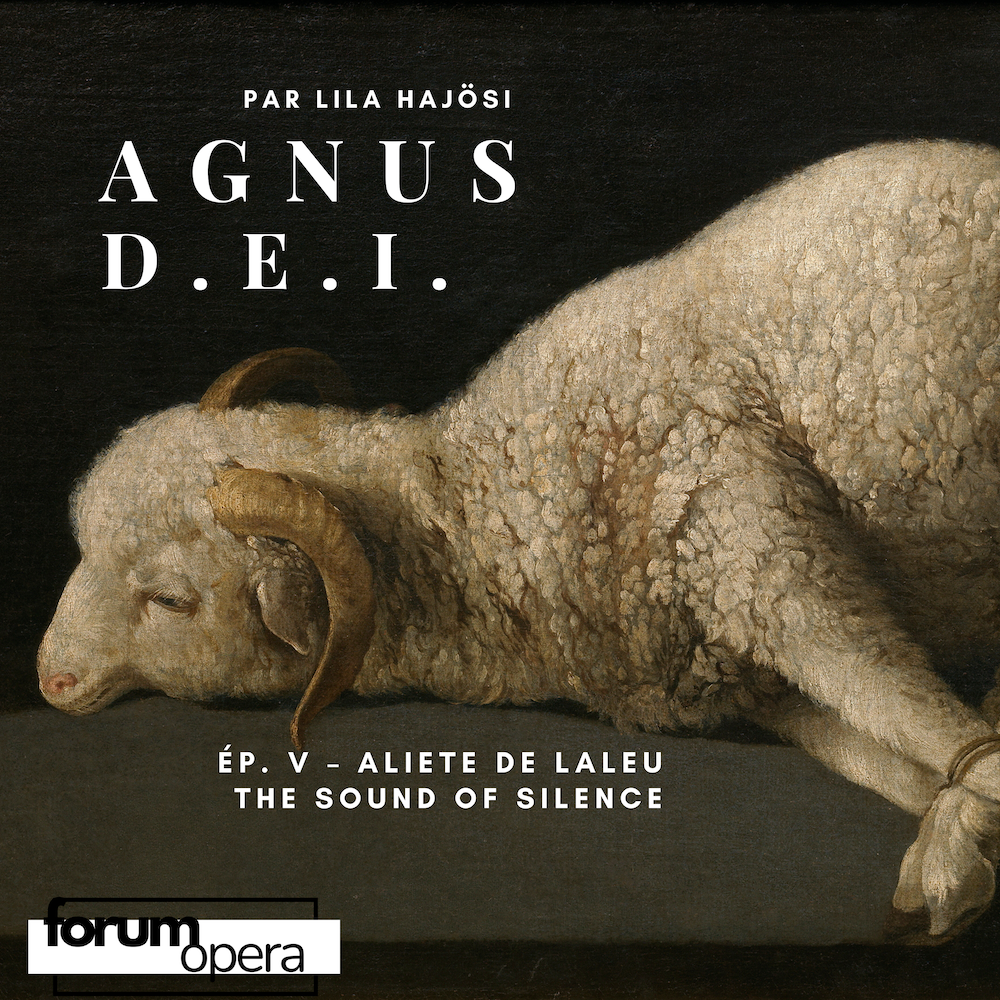Créé en 1892 au Mariinski au cours d’une soirée qui comprenait Casse-Noisette en deuxième partie, Iolanta est, par la force des choses, le testament lyrique de Tchaïkovski. Cette œuvre courte (1h30 environ) est souvent donnée en diptyque avec un autre opéra en un acte – ou plus exceptionnellement avec Casse-Noisette, comme à Paris en 2016. L’équipe artistique réunie pour cette nouvelle production bordelaise fait le choix judicieux de laisser l’œuvre se suffire à elle-même, pour en révéler toute la singularité et la beauté.
Stéphane Braunschweig, qui a déjà fréquenté un autre opéra de Tchaïkovski il y a quelques années avec moins de réussite, choisit d’épouser complètement la dimension symbolique du livret, écrit dans les mêmes années que le Pelléas et Mélisande de Maeterlinck. Sous son regard, Iolanta devient un drame symboliste qui parle de connaissance de soi et de connaissance du monde. Protégée dans l’hortus conclusus où son père la retient, Iolanta ignore que les autres humains possèdent une faculté qu’elle n’a pas : pouvoir voir la lumière du jour et la couleur des fleurs. Ses compagnes, tout comme elle et l’époux de sa nourrice, sont revêtus de costumes d’inspiration médiévale, d’un vert omnipotent (dessinés par Thibault Vancraenenbroeck), comme si son père lui avait également caché que le temps avait passé et que les hommes portaient aujourd’hui des costumes trois pièces gris et noirs (c’est le cas de son père, de son écuyer, du médecin et des deux chevaliers).
La jeune fille, recluse dans l’espace rassurant du conte – un monde clos et immuable où le danger de la vérité est retenu par une simple inscription projetée sur les murs – va voir son existence renversée par l’arrivée de deux hommes, qui entrent dans son « jardin » par la salle de spectacle, en traversant la fosse d’orchestre sur une passerelle. Vaudémont, épris de sa beauté, va lui révéler malgré lui qu’elle est aveugle, en lui demandant de cueillir une rose rouge. Ne parvenant à saisir que des roses blanches et ne comprenant pas ce que « rouge » signifie, Iolanta va se rendre compte que quelque chose lui échappe : les yeux ne servent pas qu’à verser des larmes. La condition étrange posée par le médecin de son père pour que la « guérison » de Iolanta soit réussie est qu’elle souhaite activement guérir (comme un prêtre exige qu’on ait la foi pour qu’un miracle puisse avoir lieu). La condamnation à mort de Vaudémont, si le traitement échoue, va résoudre Iolanta à désirer cette « guérison ». Elle réapparait finalement après son traitement, voyante, tandis que le salle s’éclaire et que les solistes brisent le quatrième mur en se plaçant au bord du plateau. Les choristes chantent depuis les côtés du parterre, englobant les spectateurs dans ce nouvel espace unifié : l’espace clos de Iolanta s’est ouvert et la jeune fille embrasse du regard le monde entier.
Ce passage de l’ombre à la lumière, de l’enfermement du moi à l’ouverture au monde, est bien rendu par le metteur en scène, qui multiplie les écrans et les parois pour « surcadrer », comme au cinéma, le lieu dans lequel Iolanta est enfermée. Le visage de la jeune fille, projeté en grand pendant l’air du roi René, rappelle aussi combien la tentative paternelle de protection est une forme de fixation. Le travail de la lumière est particulièrement soigné, ménageant des moments scéniques clairement différenciés pendant les différents airs. En outre, le soudain assombrissement du plateau au moment où Iolanta prend conscience de sa cécité est un bel effet, quoique facile. On regrettera seulement une direction d’acteur un peu sèche, qui enferme parfois les personnages dans des poses figées, où la passion peine à affoler les corps. Cependant, tout le cheminement méta-théâtral, jusqu’à l’union finale entre le plateau et la salle ainsi qu’entre les artistes et le public a un effet thérapeutique certain : on se prend à rêver, porté par la musique hymnique de Tchaïkovski, qu’il suffirait de désirer que la lumière triomphe pour qu’elle triomphe effectivement.
S’il est courant d’émettre des réserves sur une proposition scénique, force est d’admettre qu’on a rarement l’occasion d’entendre une distribution aussi équilibrée et juste que celle réunie par l’Opéra de Bordeaux pour cette Iolanta. La jeune soprano française Claire Antoine est idéale de musicalité et de tempérament dans le rôle de l’héroïne. La voix est ductile, ample, d’une rondeur homogène, avec ce qu’il faut de frémissement pour restituer la juvénilité du personnage et éclairer ses failles. À ses côtés, le Vaudémont de Julien Henric impressionne par sa vigueur et sa sensibilité. On se demande presque quel rôle l’interprète pourrait ne pas chanter, tant la tessiture est contrôlée et saine sur toute son étendue. Il se permet des aigus en voix mixte d’une beauté renversante à la fin de sa romance, tandis que son duo avec Iolanta, un des sommets de la partition, fait éclater toute la puissance de feu d’une voix lyrique aux accents cuivrés et dramatiques.
Le roi René d’Ain Anger s’impose par un charisme et une autorité naturelle qui donne immédiatement au personnage sa crédibilité : un homme puissant, mais doux et sensible au sort de sa fille et de Vaudémont. À part quelques fragilités d’intonation dans le grave, la voix claque avec autorité et il fend l’armure dans son arioso, poignant de bout en bout. Dans le rôle du médecin, le baryton mongol Ariunbaatar Ganbaatar impressionne tout autant. La voix est tour à tour mordante et moelleuse, conduite avec une dextérité qui force l’admiration. Par ailleurs, les aigus de son arioso sont assurés avec une assurance implacable, au terme d’un crescendo vocal parfaitement mené. L’autre grand rôle de clé de fa se trouve être le compagnon de Vaudémont, Robert, ici incarné par le jeune baryton russe Vladislav Chizhov. Par sa morgue, sa vivacité scénique et sa classe vocale, il fait du personnage un lointain cousin d’Onéguine, séduisant bad boy, certain de ce qu’il désire.
Tous les seconds rôles sont tenus avec probité et élégance par des chanteurs français, qui servent avec bonheur la musique de Tchaïkovski. Abel Zamora continue en Albéric de confirmer tous les espoirs qu’on a pu placer en lui : le timbre est doux, la ligne soignée et la voix passe l’orchestre avec aisance. Dans le rôle de Martha, Lauriane Tregan-Marcuz nous fait parfois penser aux contraltos russes des vieux enregistrements : la voix est très dense et sombre, sans perdre sa dimension incisive. Son mari est incarné par Ugo Rabec, qui conduit avec soin sa voix de basse pleine de noblesse. Enfin, les deux suivantes de Iolanta, Brigitte et Laura, sont interprétées respectivement par Franciana Nogues et Astrid Dupuis. La première charme par la lumière de son timbre et la seconde apporte des teintes plus sombres à l’ensemble.
Seule véritable ombre au tableau : la direction un peu frustre de Pierre Dumoussaud. Impossible d’accuser les instrumentistes de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine de jouer trop fort ou de négliger le fondu des timbres ; c’est au chef de veiller à l’équilibre de la masse orchestrale et à ce qu’elle ne couvre pas les voix. Comme les chanteurs disposent ici de moyens solides et n’ont aucune difficulté à passer l’orchestre, le volume orchestral crée surtout un déséquilibre sonore, donnant l’impression que l’orchestre se dresse devant les voix au lieu de les porter. On est également surpris d’entendre certains instruments se détacher de façon excessive, presque au point de laisser croire (fait impensable !) que Tchaïkovski aurait mal orchestré son œuvre. Le déploiement dramatique n’en demeure pas moins assuré : Dumoussaud maintient une tension constante et reste pleinement engagé d’un bout à l’autre de la représentation.
Le chœur, surtout les pupitres féminins, n’appelle que des éloges et contribue à la réussite de ce très beau spectacle, capté le soir où nous y étions. Tout le monde peut l’apprécier en ligne sur la chaîne YouTube d’Opéra Vision.