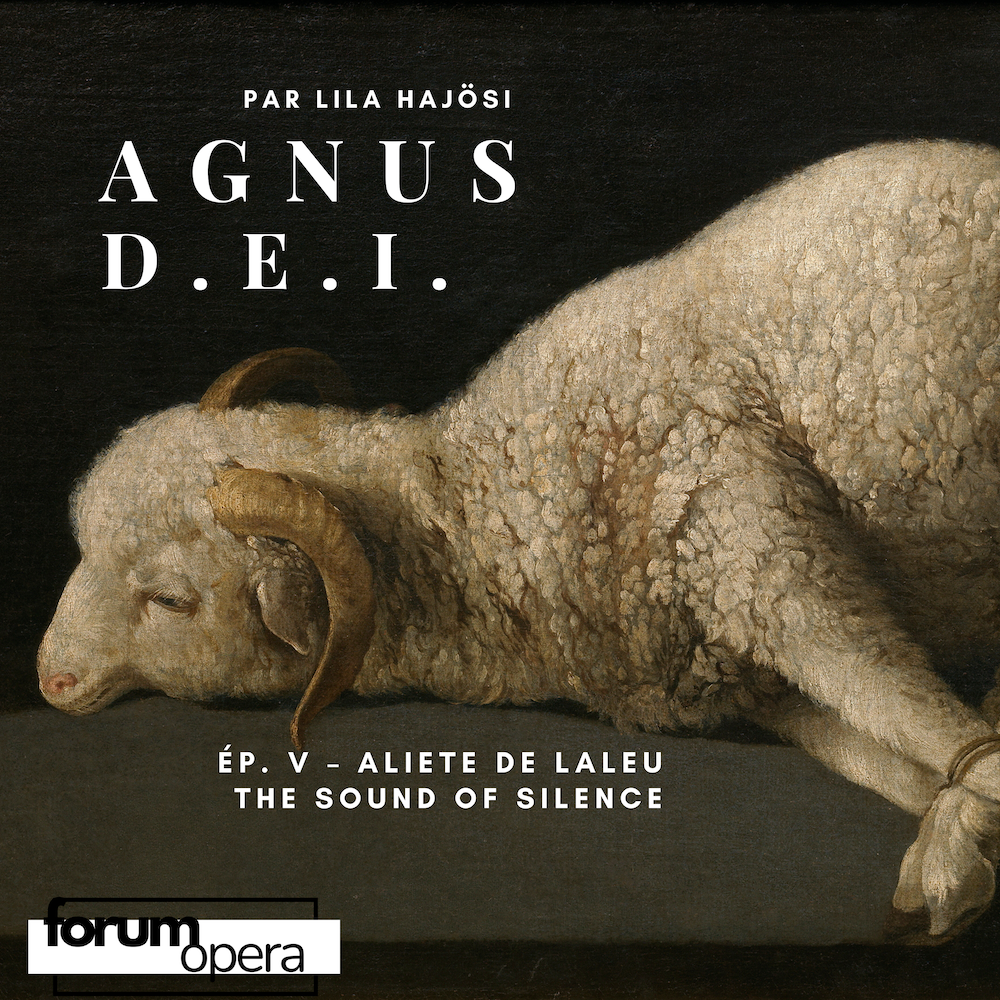« La musique de plein air n’existe pas » disait Berlioz. Il est vrai que maints spectacles donnés à l’air libre se sont révélés être des naufrages sonores, l’auteur de ces lignes peut en témoigner à foison. Mais Båstad est la terre natale de Birgit Nilsson, et lorsque la fondation qui porte son nom décide de monter Aida en plein air, elle sait comment faire les choses. Il y aura une sonorisation, pour qu’aucun détail vocal ou orchestral n’échappe aux spectateurs, et cette amplification sera réalisée avec goût et discrétion. Ensuite, la musique sera jouée en version de concert, pour éviter les inconvénients de déplacements trop nombreux de la part des chanteurs. On se contentera de quelques entrées et sorties, et les élèves des écoles de danse de la région assureront les trois ballets, dans des costumes sombres et sobres. Enfin, la concentration du public (3.000 personnes !) et la qualité de son silence permettront de recevoir l’œuvre dans des conditions proches de l’idéal. Et la tombée de la nuit scandinave est d’une poésie qui, pour être différente de celle du livret, n’en est pas moins poignante de beauté et pleinement en accord avec une partition qui se dépouille au fur et à mesure de son déroulement. Le duo final, dans une obscurité presque complète, est bouleversant.
Commençons par la seule vraie déception de la soirée : le Radamès de Martin Muehle. La voix du ténor devait être de premier ordre il y a quelques années. Mais aujourd’hui, elle sonne fatiguée, le vibrato est envahissant et l’effort audible. On apprécie l’engagement de l’artiste, et le fait qu’il continue à donner la réplique à Aïda avec aplomb juste après avoir complètement loupé un aigu dans leur duo de l’acte III. Le vrai professionnel est toujours là, mais l’écart avec le reste de la distribution est trop criant. De même, les chœurs, constitués d’amateurs, se prennent quelque fois les pieds dans les polyphonies très complexes du triomphe, mais ils font preuve de tant d’enthousiasme, de joie de chanter que les détails techniques finissent par ne plus avoir beaucoup d’importance. Après tout, c’est sans doute comme ça que crie une vraie foule sur le passage de son vainqueur.
Appelé en dernière minute pour remplacer Elizabeth DeShong, Sofija Petrović assure : son Amnéris façon princesse outrée a le physique du rôle et toutes les notes de la tessiture. Son ton très assuré confirme qu’elle est bien le personnage central de l’opéra. Tout au plus pourra-t-on regretter une imprécation finale qui manque un tout petit peu de mordant, mais on tire son chapeau à une interprète capable de chanter à un tel niveau au pied levé. L’Amonasro de Fredrik Zetterström fait regretter que son rôle soit si court. Il parvient à alterner avec bonheur les récits hachés, les murmures de conspirateurs et les longues phrases comme comme « Pensi che un popolo », le tout dans un style châtié et dans un goût parfait.
Les deux basses sont irréprochables. Le Ramfis de Krysztof Baczyk ne se sent pas obligé de traduire son pouvoir maléfique en éructations, et l’autorité est ici pleine d’onction et de majesté. Son idée d’allonger à chaque fois la longueur des « Radamès ! Radamès ! Radamès ! » à l’acte IV est sans doute absente de la partition, mais diablement efficace. Le Roi de Henning Von Schulman est chanté avec conviction, dans un style très proche de celui de Ramfis, ce qui a du sens : ils sont tous les deux les facettes d’un même pouvoir.
Christina Nilsson a l’inconscience de la jeunesse. Alors qu’elle devrait se concentrer sur sa prise de rôle en Eva à Bayreuth, elle accepte de faire un aller-retour vers la Suède pour chanter une partie extrêment difficile. Aucune nervosité dans son jeu ni dans son chant, la voix est éclatante de santé, melliflue, projetée avec aplomb. Elle ne semble même pas s’apercevoir que Verdi a parsemé son chemin d’embûches avec notamment des intervalles qui ont crucifié des artistes du calibre de Katia Riciarelli ou Aprile Milo. Elle fonce à travers tout cela avec candeur, et … cela marche. Pas seulement au niveau technique d’ailleurs : la princesse éthiopienne, vibrante d’amour et ployant sous les coups du sort, est portraiturée avec beaucoup de réalisme. Minuscule réserve : la « parola scenica » voule par le compositeur n’est pas encore tout à fait là, l’articulation manquant par moment de netteté, mais c’est là un défaut assez simple à corriger.
Après des débuts un peu hésitants, l’orchestre symphonique d’Helsingborg et Pier Giorgio Morandi trouvent leurs marques et le rythme du drame. Ils jouent sec, serré, rhétorique, avec ce rebond du discours qui est vital dans l’opéra. Ils livrent un ballabile d’anthologie, où tous les pupitres se couvrent successivement de gloire. Et les trompettes égyptiennes placées de part et d’autre de la scène valent leur pesant d’or. Rendez-vous est déjà pris pour Le Vaisseau fantôme l’année prochaine, dont on espère qu’il sera tout aussi décoiffant que cette Aïda de 2025.