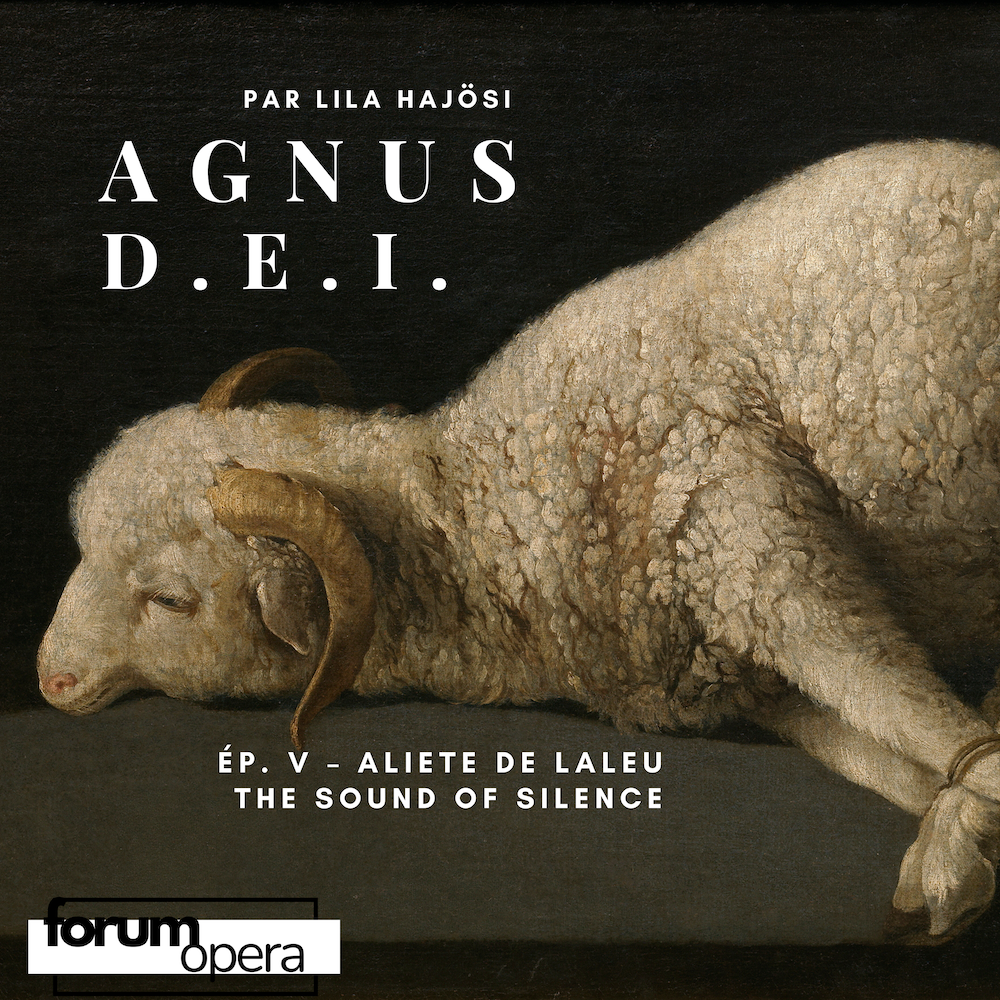« Après avoir inventé l’orchestre invisible, je voudrais avoir inventé le théâtre invisible. » Répété ad nauseam, le bon mot de Wagner est l’expression de sa déception face à la pauvreté des réalisations scéniques de son époque. Il n’est pas certain que, 150 ans plus tard, nous soyons parvenus à mieux mettre en scène les opéras les plus fantastiques du répertoire, avec leur myriades d’événements surnaturels, leurs créatures imaginaires, leurs cataclysmes. Le Vaisseau fantôme n’échappe pas à la règle, et l’auteur de ces lignes se souvient d’avoir vu quelques tempêtes ratées, et quelques transfigurations de Senta où le grand guignol gâchait l’émotion pure qui doit sourdre de ces pages. Il faut donc saluer l’initiative du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles de présenter l’œuvre en version de concert. Grâce à une mise en espace minimaliste et à un surtitrage efficace, rien ne se perd de l’action, et l’attention du public ne faiblit pas deux heures durant, puisque la version choisie est celle qui ne compte pas d’entracte. Le drame de la rédemption par l’amour continue à toucher les cœurs, et la sortie des spectateurs aura permis de saisir au vol quelques conversations animées.
Même si les chanteurs ont des mérites détaillés plus bas, l’âme de la soirée est incontestablement le chef Tarmo Peltokoski. A 25 ans, sa maîtrise technique est stupéfiante : précision, conduite des phrases musicales, conception claire du drame. Et, contrairement à certains de ses jeunes confrères qui se croient obligés de gesticuler en tous sens sur le podium, son attitude en scène est économe. Les quelques moments où il lâche la bride (chœur des fileuses, débuts de l’acte III) existent parce qu’il sait que l’orchestre peut à ce moment presque jouer sans lui, tant la confiance et l’écoute sont réciproques. Dans une pièce aussi puissante que Le Vaisseau fantôme, et avec un orchestre sorti de la fosse, le chef doit en outre trouver un équilibre délicat avec ses solistes. Le risque est grand de les couvrir. Mais Peltokoski évite parfaitement l’écueil, dose ses effets, et maintient tout du long un équilibre idéal, notamment dans les interventions de Daland. On comprend que l’Orchestre du Capitole de Toulouse et le Hong Kong Philharmonic aient déjà mis la main sur ce jeune prodige.
L’orchestre philharmonique du Luxembourg ne cache pas sa joie. Des cuivres rutllants, des bois euphoriques, des cordes qui savent à la fois détailler leurs traits et se dresser fièrement face aux vents : on sent que les instrumentistes sont séduits par la conception du chef, et qu’ils ont à cœur de tout donner ce soir. Et ils savent tenir dans la longueur : l’acte III les trouve aussi dispos que l’ouverture, et pas une seule fois au cours de l’opéra la tension ni la cohésion ne fléchissent. Les chœurs de la Radio polonaise et de Katowice ont uni leur force pour donner vie aux larges fresques dont Wagner gratifie la masse chorale. L’élan, l’enthousiasme, la jubilation sont au rendez-vous, et les houles de l’acte III produisent leur effet.
La barre étant mise très haut, le plateau vocal doit assurer. Le compte y est globalement, même si l’on peut déplorer l’une ou l’autre faiblesse. En Daland, Albert Dohmen est plus une silhouette qu’une présence. La puissance de sa voix n’est plus qu’un souvenir, mais le timbre reste toujours aussi fascinant de noirceur. Et la musicalité est intacte. De plus, le chef connait parfaitement son plateau, et il sait qu’il doit alléger son accompagnement lors de chaque intervention de Daland, pour lui permetre de passer le mur de l’orchestre. Le subterfuge fonctionne parfaitement, le public a l’impression d’entendre une basse en pleine possession de ses moyens, et fait un triomphe à l’interprète au moment des saluts. A l’inverse, Tuomas Katajala a pour lui sa jeunesse de timbre, sa fougue, son chant impeccablement discipliné et comme dopé aux hormones, et il campe un Erik qui sort de la catégorie des éternels loosers pour dessiner le portrait d’un jeune amoureux qui fait vraiment fléchir Senta à plusieurs moments, et dont le Hollandais a raison d’être jaloux. Dans la même veine, le pilote de David Fischer est réjouissant d’entrain et de projection. Il ne craint pas de se placer derrière les cors, certain que son ténor clair parviendra bien jusque dans les moindres recoins de la grande salle Henry Le Boeuf. Flanquée d’impayables lunettes d’écaille, la Mary de Catriona Morison est presque trop pulpeuse vocalement dans ce rôle si court.
Reste à parler des deux protagonistes principaux. On avouera une légère déception en ce qui concerne la Senta de Gabriela Scherer. Certes, toutes les notes du rôle sont assurées crânement, et l’artiste est engagée avec naturel et dramatisme. Mais on sent plus d’une fois la tension dans les aigus. Et le timbre, qui n’est déjà pas des plus séduisants au départ, en pâtit. Surtout, la voix est un peu générique, et ne marque pas durablement. D’autant qu’elle a en face d’elle un Hollandais hors format avec Brian Mulligan. Dès le « Frist ist um » de l’acte I, la salle est comme magnétisée par les mots du chanteur, par sa projection, par sa stature. Cet homme semble réellement porter sur lui l’accablement d’une malédiction. La voix est d’airain mais comme marquée par la douleur. Une légère fêlure sur ce bronze, comme pour en faire ressortir encore davantage la pureté. Le duo du II le montre encore plus concentré, plus intense, les mots « Mein Heil hab’ich gefunden » sont vraiment l’expression d’une rédemption, comme un rayon de soleil au travers des nuages. Derrière les angoisses du Hollandais percent déjà Wotan, voire Amfortas. Du tout grand art, auquel la salle offre une légitime standing ovation.