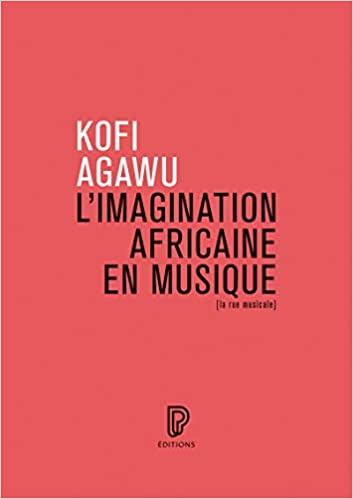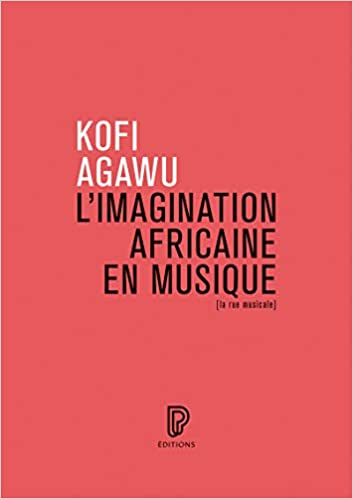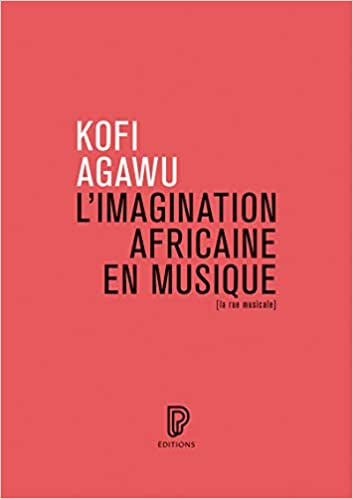The African Imagination in Music paru aux Etats-Unis en 2016 a été écrit par Kofi Agawu, éminent musicologue originaire du Ghana, professeur au Graduate Center de New York. Les Editions de la Philharmonie de Paris viennent de l’éditer, en 2020, dans une remarquable traduction.
A priori cette recherche érudite sur la musique africaine semble s’adresser à des ethnomusicologues ou à des africanistes. En réalité, elle peut passionner tous les mélomanes car, par son universalité, elle nous ouvre des horizons inattendus qui nous permettent d’avoir une approche plus riche de nos propres musiques.
L’essence de la musique traditionnelle africaine rejoint en effet celle de nombreuses musiques traditionnelles à travers le monde, que ce soit « la répétition ou la pulsation rythmique à la finitude hypnotique, qui exigent toutes deux la participation des auditeurs ».
Et, par-dessus tout, le chant. On a trop souvent associé, précise l’auteur, « la musique africaine aux tambours. On a oublié que cette musique était, et est, avant tout, vocale. Mélodie et Langue sont ainsi prises dans une dialectique profonde et agissante. Comme pour le verbe parler on pourrait dire qu’au commencement (ou presque,) était là-bas la mélodie. » Agawu propose alors au lecteur de ressentir vraiment la musique dans son corps, en récitant de la poésie ou en lisant des textes à haute voix. « Les syllabes sont, en Afrique, la base de l’articulation du chant. On ne peut jamais séparer la langue de la musique ».
On songe alors, sous nos latitudes, à la déclamation lyrique enseignée en Europe dans de nombreux conservatoires, notamment en Italie et aux grands maîtres du bel canto et du « recitar cantando » de Peri et Caccini. Ce n’est pas pour rien que la fameuse « recita » a donné son nom, là-bas, à la représentation d’opéra.
Et puis il y a des constats étonnants. « On sera peut-être surpris d’apprendre que dans beaucoup de langues africaines indigènes le mot musique n’existe pas, pas plus que le mot chef d’orchestre. Ce n’est que vers 1840 que les missionnaires chrétiens ont intégré aux traditions africaines les chœurs d’église, avec un chef désigné qu’on a appelé le àtidalá « celui qui agite la baguette » !
L’apparition de la musique populaire africaine urbaine, qu’on écoute en concert, sans y participer, est apparue en Afrique au début du XXème siècle, peu après des tentatives de musique dite savante très marquée par les influences européennes. Dans ce domaine, on trouve des sonates, des symphonies ou des cantates jusqu’à l’opéra, Chaka composé en 1999 par Akin Euba, très influencé par Bartòk.
Plus étonnante encore est l’utilisation dans la musique populaire de l’hétérophonie due au déplacement rythmique des lignes mélodiques se déployant simultanément dans le chant traditionnel accompagné par le violon à une corde. Il se trouve, précise Agawu, que « le philosophe et musicologue allemand Adorno a relevé un effet semblable dans le Chant de la Terre, de Gustav Mahler et l’a baptisé « unisson imprécis », « unscharfe Unisono… qui naît de ce décalage perpétuel entre les notes du violon et celle chantée par la voix, malgré une volonté manifeste de jouer à l’unisson ».
IL fait référence aussi aux compositeurs contemporains séduits par les sons spécifiques de certains instruments africains comme la cloche d’Afrique de l’Ouest dans « Clapping Music » de Steve Reich. Il cite enfin l’album « African Rythms » du pianiste français Pierre-Laurent Aimard, « où l’on trouve le minimalisme de Reich, les polyphonies stratifiées de Ligeti, et les simultanéités des Pygmées Aka fondus dans une parfaite continuité ».
Voilà de quoi nous faire rêver et méditer d’autant que ce livre est agrémenté de très belles photos !