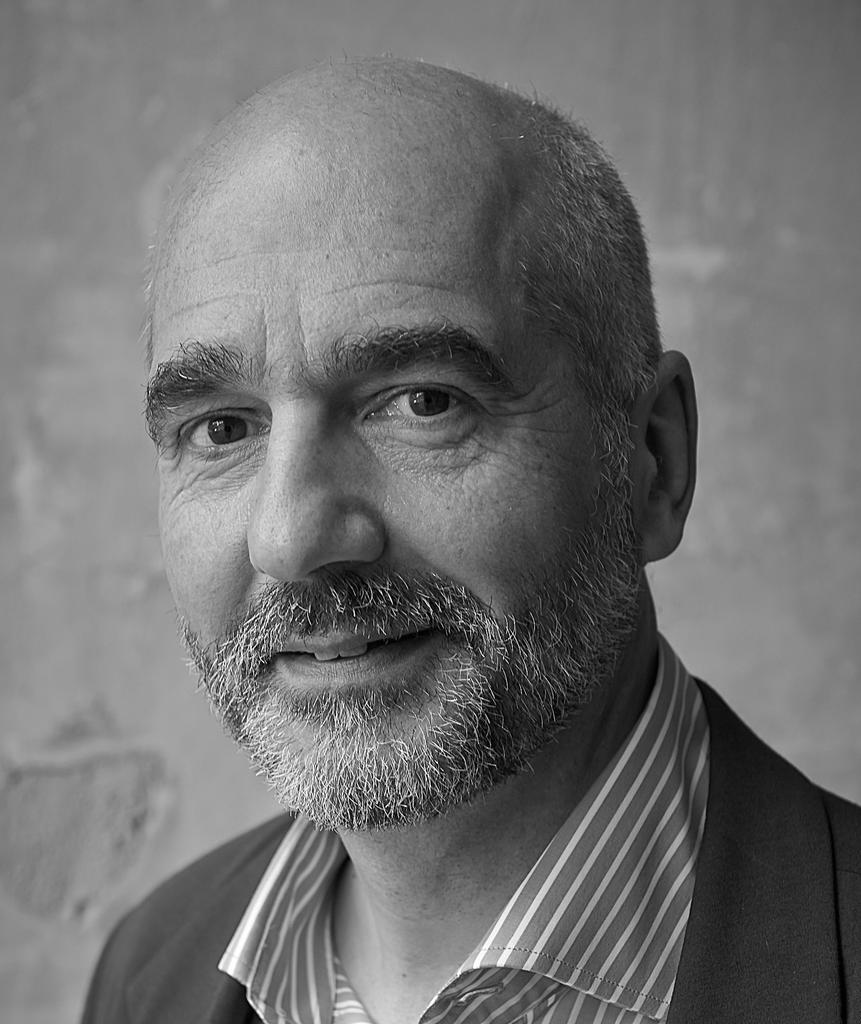Quelques roulement de timbale et le rideau s’ouvre sur un décor minimaliste et dépouillé, constitué de deux plateaux tournants, inclinés par rapport au sol, et qui pourraient représenter deux roues de la fortune, l’une anglaise et l’autre écossaise, dont les destins vont se nouer ici. Un troisième cercle, disposé au-dessus des deux autres comme le couvercle d’une huitre, servira en effet en fin de programme à enfermer la reine d’Ecosse dans son tragique destin. C’est grandiose, ça rempli l’énorme plateau du Grosses Festspielhaus, ce qui est déjà un gageure en soi, et ça permet des mouvements subtils, comme de marcher sans jamais avancer, ou de reculer sans faire un pas, mais la première émotion passée, que reste-t-il ? Les choix esthétiques du metteur en scène Ulrich Rasche sont d’une radicalité intransigeante, tout en noir et blanc (enfin surtout en noir…) loin de toute représentation qui pourrait évoquer la richesse de la cour élisabéthaine ou la grandeur austère de la prison de Fotheringhay. Cette vision toute conceptuelle et dépouillée, peine à apporter de la profondeur à l’intrigue, les images proposées, au lieu de plonger dans l’intimité des personnages, les figent dans une suite de tableaux à la froideur clinique, laissant rapidement une impression d’ennui désincarné. Dieu sait pourtant que cette intrigue, où se mêlent rivalité politique et rivalité amoureuse entre deux femmes d’une égale détermination est propice à l’exacerbation des sentiments. Et c’est bien ce qu’a cherché Donizetti, en plein Romantisme, en allant puiser chez Schiller un tel sujet.
Le décor étant posé, qu’en est-il de la direction d’acteurs ? Elle semble parfois hésitante à incarner la passion et la rivalité qui animent les deux héroïnes. Marie et Élisabeth, dans cette production, apparaissent plutôt comme des archétypes que comme les figures complexes imaginées par Schiller. Les hésitations d’Elisabeth, jouet de ses différents conseillers, sont peu perceptibles, et les duels vocaux, qui devraient être des moments de tension dramatique, deviennent de redoutables joutes vocales, brillantes, certes, mais surtout techniques. L’émotion, pourtant au cœur de l’œuvre, semble mise de côté au profit d’une virtuosité froide. Les confrontations entre les deux reines manquent de feu, et toute la dernière partie qui conduira Marie vers une mort acceptée et préparée, manque d’intensité.
Sur le plan musical, l’orchestre, montre peu de relief ou d’audace. L’œuvre qui dans ses meilleures versions est un cheminement progressif vers une sorte de fin hallucinée, est vue ici de façon un peu sage, certes brillamment défendue par un orchestre attentif, mais guère enclin à prendre des risques.

C’est donc du côté de la distribution qu’il faut aller chercher les principales qualité de cette production, et là, on n’est pas déçu ! Lisette Oropesa brille de mille feux dans le rôle-titre. La voix est somptueusement belle dans tous les registres, le timbre riche et clair, la virtuosité sans faille. Tout au plus pourrait-on souhaiter un engagement dramatique plus complet, ce que la mise en scène ne favorise pas. Toute la fin de l’œuvre, sorte de montée du calvaire, propre à faire frémir le spectateur et musicalement construite pour aboutir au climax de l’exécution, est ici accompagnée d’un ballet de 18 danseurs au trois quarts nus, tenue aussi inattendue qu’inadaptée dans un château anglais, une chorégraphie esthétisante, une touche sensuelle complètement décalée, comme sortie du temps et hélas bien loin de renforcer le drame qui se noue autour du destin de la malheureuse reine d’Ecosse.
Quant à Kate Lindsey, la soprano qui chante Élisabeth, elle possède elle aussi un splendide instrument vocal, et une magnifique technique, mais son interprétation manque un peu de variété dans les nuances émotionnelles. Engagée, dès qu’on a dépassé l’épisode du mariage français, dans le registre de la colère et de la vengeance – qui conviennent parfaitement à sa voix parfois une peu dure –, elle ne parvient pas à créer la tension palpable qui devrait exister entre les deux rivales, par manque de confrontation directe, c’est semble-t-il un parti pris de la mise en scène qui les situe toutes deux sur des plateaux différents. Elles s’observent mais ne se rencontrent pas.
Révélation de la soirée, le jeune ténor venu d’Ouzbékistan Bekhzod Davronov, second prix du concours Operalia en 2021, faisait ses débuts dans le rôle de Leicester. Voix magnifique, parfaitement homogène et d’une grande solidité, grande taille et physique de latin lover très engageant, ce jeune homme semble avoir tout ce qu’il faut pour mener une belle carrière. Déjà repéré par l’opéra de Dallas, puis plus près de chez nous par celui de Dresde, il participait à Salzbourg ce printemps à un concert de gala donné en l’honneur de Placido Domingo. C’est une prise de rôle parfaitement réussie, une performance vocale et scénique qui inspire le respect et l’admiration ; nul doute qu’il fera encore beaucoup parler de lui.
Les trois autres rôles, la basse russe Aleksei Kulagin (Talbot), le solide baryton américain Thomas Lehman (Cecil) et la délicieuse soprano géorgienne Nino Gotoshia (Anna Kennedy) sont tous trois d’excellents choix et complètent heureusement la distribution.
Les chœurs, quant à eux, sont impeccables sur le plan vocal, mais peu intégrés dans l’action scénique de sorte que leur prestation semble déconnectée d’une intrigue qui pourrait les impliquer plus directement.
En somme, bien qu’elle présente des moments de beauté grandiose et des interprètes de talent, cette mise en scène peine un peu à rendre hommage à la richesse dramatique de l’œuvre. L’ambition de moderniser la pièce – ou de la rendre intemporelle par le biais d’une abstraction formelle et d’une distanciation esthétisante – laisse le spectateur sur sa faim. L’émotion, qui devait être au cœur de cette tragédie, se trouve souvent étouffée par des choix esthétiques et une direction d’acteurs trop rigide. Le public de Salzbourg, très attaché à la performance des chanteurs, a dès lors très généreusement salué leurs prestations par de longs applaudissements.