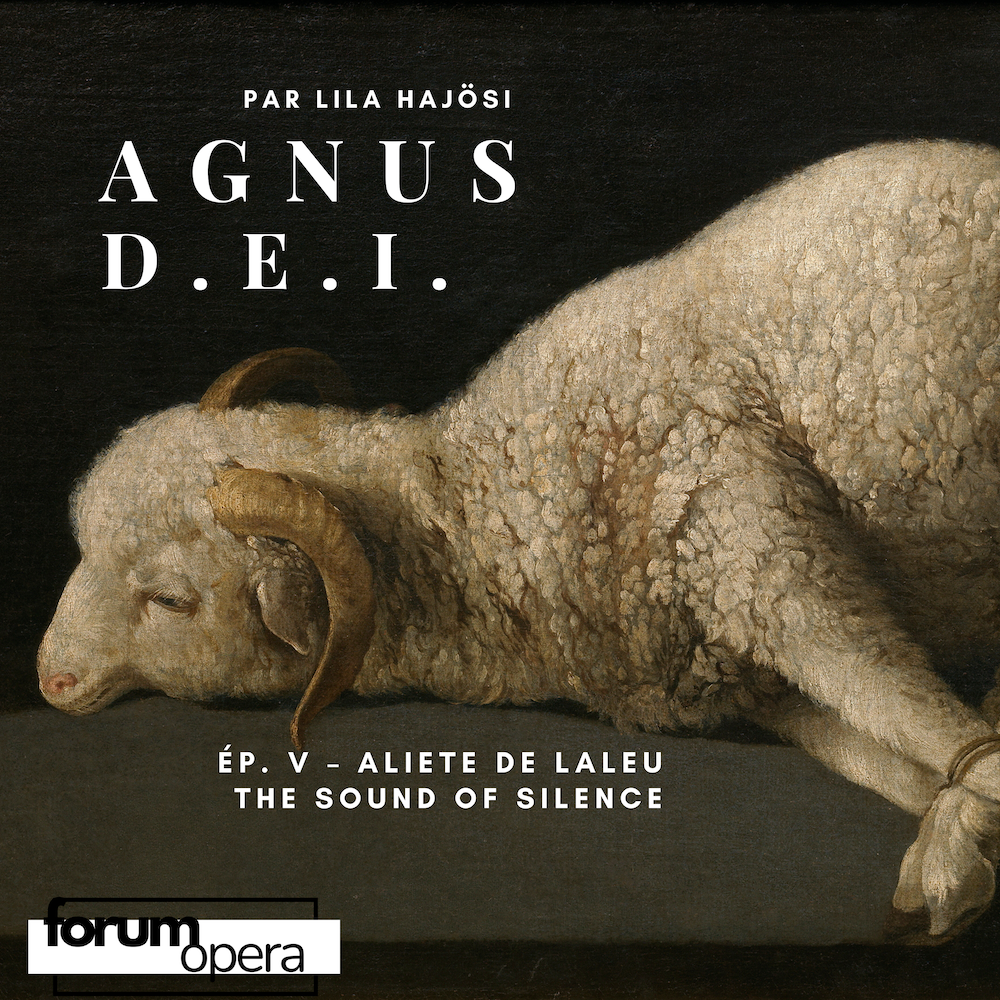Déjà présentée à Montpellier et chroniquée par Thierry Verger le mois passé, la production de Cavalleria Rusticana/Pagliacci arrive à Dijon où elle est donnée dans le vaste Auditorium à l’acoustique remarquable, avec une distribution tout à fait différente, mais qui reprend en partie celle de la création du spectacle au cours de l’été 2024 à Toulon, salué à l’époque par Yvan Beuvard.
La mise en scène de Silvia Paoli, dont nous avions déjà pu admirer le remarquable travail sur Tosca à Nantes ou sur la Traviata à Angers par le passé, est passionnante, quand bien même on se prend à avoir peur en découvrant le décor glauquissime et les costumes très ultra Fast Fashion. Tout cela ne cadre pas avec les festivités pascales de Cavalleria et pas davantage avec la fête de l’Assomption de Pagliacci. Il va sans dire qu’on est très loin de la version hyper-naturaliste et tournée sur les lieux siciliens de l’action par Zeffirelli pour Cavalleria, notamment. Qu’à cela ne tienne, la metteuse en scène italienne connaît son affaire et a transposé l’action dans la rue, d’un type qu’on pourrait reconnaître dans n’importe quelle métropole transalpine. Décor et mise en scène permettent de rendre très cohérents l’association des deux opéras, qu’on apparie en général pour leur durée respective, mais qui sont placées ici comme en écho, avec des accessoires du premier volet qu’on laisse traîner dans le second, ou des personnages qui réapparaissent fugacement, par exemple. Les deux assassinats dus à la jalousie se perpétuent sous le regard des mêmes spectateurs, sur les marches de ce qui pourrait être un amphithéâtre antique en ruines tout comme l’accès à un centre commercial contemporain, jonché de détritus et hanté par une vieille dame SDF qui aurait été membre du chœur dans une tragédie antique ou sorcière dans une œuvre classique. Le cadre ultracontemporain sert un propos universel, on l’aura aisément compris. Plus on avance dans la soirée, plus le procédé devient évident, ce qui encore souligné par la superbe chorégraphie des six danseurs, magnifiques de naturel, transcendant et anoblissant sans cesse le moindre geste de mornes gamins des rues ou de victimes expiatoires qui forment une sublime pietà, les fresques de l’église étant remplacés par des graffitis signifiants côtoyant des taches de couleurs qui pourraient tout aussi bien être des immondices côtoyant une reproduction de l’un des plus beaux Christs morts de la peinture, celui d’Antonello da Messina. Toute l’humanité est ici suggérée, dans ce qu’elle a de plus sale et vulgaire jusque dans ses créations les plus nobles. Il va sans dire que la proposition de Silvia Paoli est d’une vive intelligence, d’une très grande justesse et d’un intérêt qui offre du grain à moudre pour tout spectateur, tant les citations et les questionnements abondent, sans même parler de la puissance empathique qui se dégage de travail de la lumière, de la force des couleurs et du jeu millimétré des protagonistes, Silvia Paoli, elle-même comédienne, étant une remarquable directrice d’acteurs.
© Mirco Magliocca
La distribution vocale est à l’avenant. Anaïk Morel parvient à incarner une Santuzza particulièrement émouvante, y compris lorsqu’elle se laisse aller à trahir son amant. La scène finale est déchirante. Le timbre est beau, chaud et les moyens vocaux plus que solides. Les tatouages, la clope au bec pour une femme en cloque jusqu’aux dents, les collants résille et le short vulgaire n’entament en rien sa dignité, c’est dire. Face à elle, Svetlana Lifar nous propose une mamma sicilienne dont l’authenticité ne fait aucun doute et dont la ligne vocale très pure laisse toutefois généreusement entrevoir les sous-entendus inquiets voire paniqués de la mère qui comprend tant de choses. Tadeusz Szlenkier est un Turridu tout en séductions, moins intégralement viril et d’une seule pièce que d’ordinaire. Ses colères et ses peurs sont projetées dans des aigus spectaculaires et délicats, laissant la place à une subtilité qui fait plaisir à entendre. Il en va de même pour son interprétation de Canio illuminée par un « Vesti la giubba » poignant. Un ténor à suivre, assurément. Galina Cheplakova est une superbe Nedda. La voix est splendide, la technique éprouvée, ce qui permet de donner à son personnage une étoffe solide. Le féminicide qu’elle va subir et qu’elle devine nous touche profondément et l’on gage que Silvia Paoli a dû aimer la diriger en mettant parfaitement en valeur les rapports de force entre les sexes. Les autres comprimari sont impeccables et achèvent de garantir la qualité globale de ce spectacle d’exception, magistralement magnifié par des chœurs excellents.
À la tête de l’Orchestre Dijon Bourgogne, Débora Waldman réussit à imprimer une très forte personnalité à une partition particulièrement haute en couleur qui ne lui pose aucun problème, avec un naturel confondant. L’orchestre, en bonne forme, répond efficacement à sa battue énergique et nous gratifie ainsi d’une soirée mémorable, d’une très grande cohésion générale.