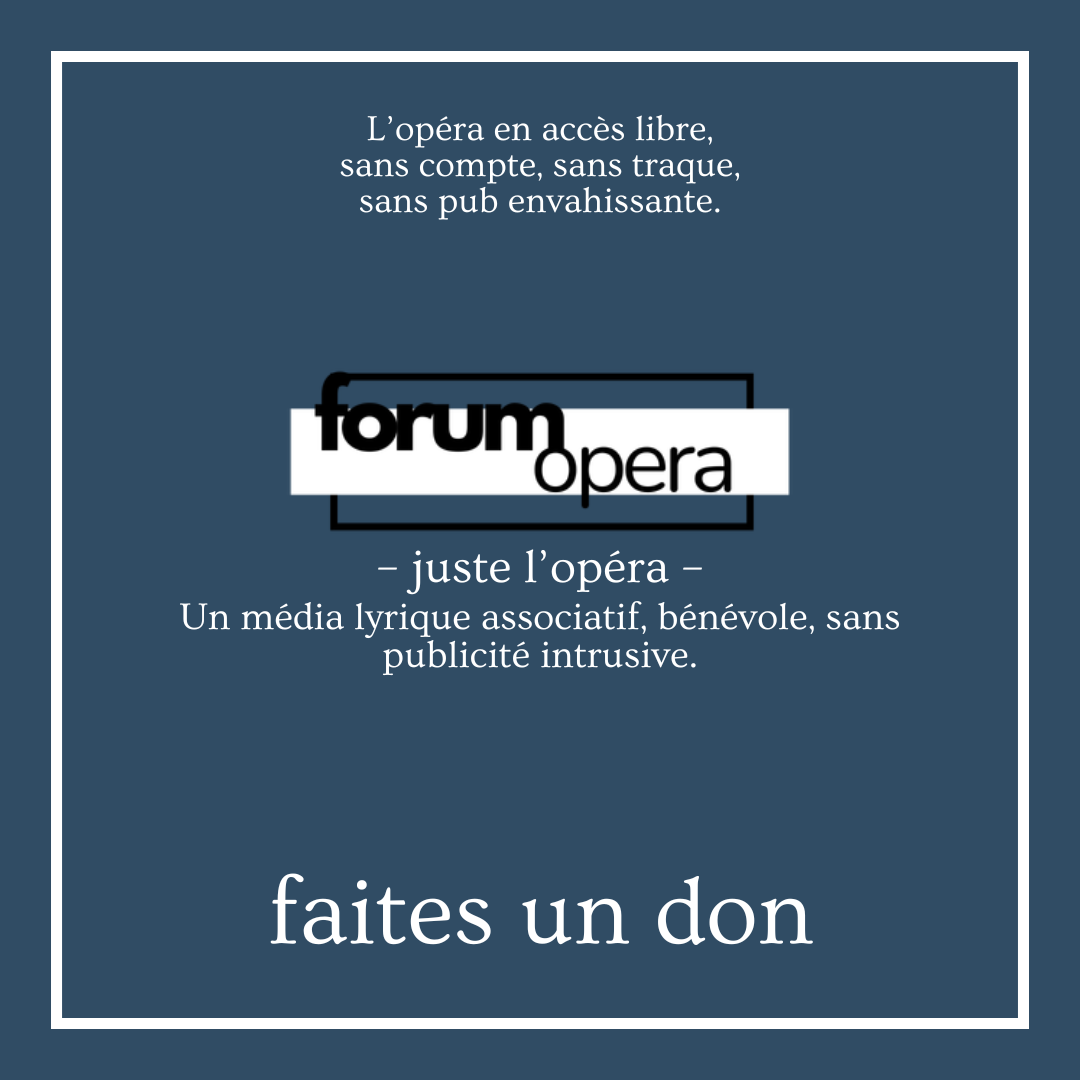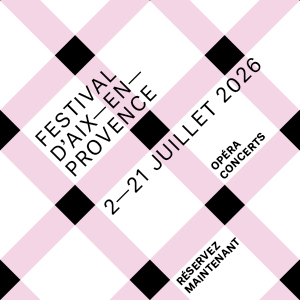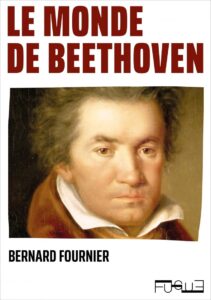Vedette internationale des scènes lyriques depuis 2009, la mezzo Anita Rachvelishvili est apparue dans nos colonnes, avec notamment Carmen à Vérone en 2012, Aida à Milan en 2015, et un récital de mélodies à Paris en 2015. Elle y devient quasiment omniprésente entre 2016 et 2022, que ce soit à Paris ou un peu partout dans le monde, avec toujours des appréciations très élogieuses. Dans les dernières années, des problèmes vocaux l’ont quelque peu éloignée des scènes où elle brillait. C’est dire avec quel plaisir on la retrouve ce soir, invitée par Jonas Kauffmann, directeur du Festival d’Erl, avec qui elle entretient des liens d’amitié depuis le célèbre Carmen qu’elle chanta avec lui lors de la soirée d’ouverture de La Scala de Milan le 7 décembre 2009.
Le choix de mélodies, dans son ensemble, ne présente guère d’originalité par rapport aux précédents récitals de la cantatrice, et peut-être ce programme n’était-il pas vraiment adapté au public germanophone, qui l’a quelque peu boudé. La première partie, russe et géorgienne, ne pose pas de problème à la cantatrice, ni en termes de langue, ni en termes de style : elle est dans son élément. Quant aux thèmes développés, tristesse, nostalgie, sentimentalité, souffrance et fuite du bonheur, certainement la cantatrice trouve-t-elle là aussi des éléments de sa vie professionnelle.
Les trois mélodies de Tchaïkovski, « Seul celui qui connaît la nostalgie sait ce que je souffre », « La nuit » (Daniil Rathaus) et « Réconciliation » (Nikolai Chtcherbina) font partie de ces « romances » où le compositeur traduisait ses états d’âme torturés. Souffrance, chagrin et tristesse, éloignement de l’âme aimée, bonheurs passés, incertitudes d’avenir, bref, on est dans un brouillard existentiel que la cantatrice choisit de rendre d’une voix forte et d’attitudes volontaristes, comme si elle voulait apporter un démenti aux incertitudes développées dans ces mélodies.
Avec Rachmaninov, la part belle est plus encore donnée au clavier, et l’excellent pianiste et accompagnateur Vincenzo Scalera en profite pour imprimer là plus nettement sa marque. Mais on reste dans les mêmes tonalités avec « Tu es comme une fleur », où le poète fait naître la nostalgie de la peur de la perte de la pureté, de la beauté et de la douceur de la bienaimée. « Je me suis enflammé pour mon chagrin » dépeint la triste vie de la femme seule dont le mari est soldat, toujours absent. C’est, à l’époque où Rachmaninov s’est beaucoup intéressé à la musique populaire russe, qu’il s’est inspiré d’une mélodie populaire géorgienne, et bien évidemment, on sent dans l’interprétation d’Anita Rachvelishvili à quel point ce texte puise dans ses racines culturelles, alors que l’accompagnement au piano est lui tout à fait typique du compositeur. « C’est beau ici » a plus un caractère élégiaque : ici règne le calme, il n’y a que Dieu et moi, des fleurs, et toi, mon rêve… Et puis, avec « Oh chante, belle, ne me chante pas… » revient la nostalgie des chants mélancoliques de Géorgie. Enfin, « Oh, ne sois pas triste pour moi » exprime l’empathie de celui qui partage la douleur d’autrui.
Plus calme et reposante, la mélodie géorgienne d’Otar Taktakishvili « Soleil de juin » nous replonge à nouveau dans les racines de la mezzo, qui développe sur ce thème une belle ligne mélodique, et termine la première partie de ce récital.

Après l’entracte, on change complètement de paysage, puisque l’on passe du russe à l’italien, où la cantatrice est également tout à fait à l’aise. Mais l’art de Francesco Paolo Tosti se fondait lui aussi sur la mélancolie, tout en s’adaptant avec un rare bonheur à la voix humaine. Ses compositions vocales, considérées parmi les plus achevées de tout le domaine de la mélodie internationale, permettent à l’interprète de briller tout particulièrement, et il faut dire qu’Anita Rachvelishvili s’en donne à cœur joie, comme si la tristesse de la première partie s’était évanouie. Et c’est presque avec humour qu’elle détaille « Je ne t’aime plus », ou coup de foudre, amour et désamour s’enchaînent implacablement. Suit avec « Ideal » un rêve sensuel, et avec « Tristesse » encore une infinie mélancolie, qu’il faut rapprocher de la vidéo que la cantatrice a réalisée en playback devant un verre de vin…
Dernier volet, cette fois en espagnol, avec Manuel de Falla et ses 7 chansons populaires espagnoles, qui correspond également parfaitement au tempérament d’Anita Rachvelishvili, qui les interprète avec beaucoup d’humour, au point qu’on la voit enfin sourire, ce qui est quand même rare, et lui va si bien ! C’est donc encore une fois une nostalgie, celle du pays éloigné, qui a inspiré au compositeur ces pièces variées illustrant diverses régions. On ne peut pas bien sûr ne pas penser ici à la Carmen de Bizet, un des rôles fétiches de la cantatrice, dont elle va nous offrir en bis la habanera, après le grand air de Dalila « Mon cœur s’ouvre à ta voix », un autre de ses chevaux de bataille. Après un programme de mélodies au demeurant un peu court pour l’appétit des spectateurs, ces deux airs rappellent l’autre volet – et peut-être le plus abouti – de l’art de la cantatrice.
L’interprétation vocale d’Anita Rachvelishvili est globalement assez monolithique. Elle joue en effet toujours un peu de la même manière de sa voix somptueuse, d’une force contenue et aux nuances subtiles. Les aigus sont tous éclatants de santé vocale retrouvée, et l’on perçoit le bonheur que la cantatrice a à chanter un répertoire qui lui tient à cœur, comme elle a plaisir visiblement à offrir en bis deux airs d’opéra qui font partie de son répertoire de base et ont entraîné ses plus grands succès. On remarque néanmoins parfois d’étranges basculements gutturaux dans le grave, que l’on avait déjà notés à Vérone en 2012, et que visiblement elle n’arrive toujours pas à contrôler.