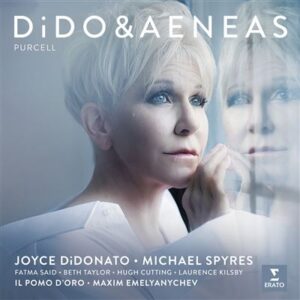Le 74e Festival de Música y Danza de Grenade s’est terminé le dimanche 13 juillet, avec La Traviata comme un des temps forts de l’édition 2025.
En version de concert abrégée et accueillie au magnifique palais de Charles Quint dans l’Alhambra, il s’agit d’une production du Teatro Real de Madrid qui, au mois de juin, avait repris une mise en scène désormais classique de 2005 signée Willy Decker. À l’époque, cette version rompait pourtant avec les conventions en proposant une scénographie stylisée et sobre dans un seul espace scénique minimaliste. Des gestes expressifs et parfois exagérés étaient le seul moyen visuel auquel recourraient les chanteurs. La presse espagnole constate que « sans doute, Decker voulait donner une dimension tragique et intemporelle à Violetta ».
À Grenade, cette dernière – interprétée par Nadine Sierra – conserve cet aspect démonstratif, luttant littéralement contre le destin. Sierra maîtrise une large gamme d’expressions et confie des couleurs parfois insoupçonnées aux différents registres de sa voix, notamment dans l’aigu. Toutefois, on pourrait lui reprocher de s’en servir d’une manière assez aléatoire et sans retenue. Son jeu manque de précision, et de nombreux sanglots et soupirs, qui se veulent véristes, se faufilent jusque dans les lignes vocales, alors que la courtisane Violetta Valéry devient plus naturelle et simple au fur et à mesure qu’elle succombe à la maladie.
Alfredo, en revanche, s’adonne à l’amour avec beaucoup de fermeté, ébloui jusqu’à la folie. Le timbre du ténor Xabier Anduaga est cristallin, clair et puissant ; sa prestation est limpide et ne manque jamais de direction ; la manière dont il se projette dans les différentes situations est toujours réussie. Dans cette ronde des paradoxes, Giorgio Germont, le père d’Alfredo, essaie de couper court à la liaison entre son fils et cette femme de mœurs légères, avant de l’encourager. Doté d’une voix souple et riche, le baryton Artur Rucinski – qui laisse entrevoir d’autres vestiges de la direction d’acteur de Decker – met la même conviction et la même bonne foi peu vilaine dans les deux facettes de Germont.
Parmi les autres personnages se distinguent la Flora Bervoix de Karina Demurova, au profil vocal rythmique et prononcé, ainsi que le Docteur Grenvil dont la basse profonde et texturée s’intègre parfaitement à l’interprétation juste et mesurée de Giacomo Prestia. Tout cela sous la baguette de Henrik Nánási – connu du public français pour ses passages à l’Opéra national de Paris –, qui crée un son orchestral très transparent. La moindre voix secondaire reste perceptible dans une image sonore pourtant claire et unifiée.

Entre le départ de l’ancien directeur Antonio Moral et l’arrivée de Paolo Pinamonti, 2025 est une édition transitoire du festival. Toutefois, celui-ci est toujours à la hauteur de ce qui a été réalisé à merveille ces dernières années : une rencontre d’œuvres et de productions internationales, et de couleurs locales. Ainsi, un concert de solistes de l’orchestre de Grenade (OCG), dirigés par Nacho de Paz et associés à la mezzo-soprano allemande Annette Schönmüller, réunit la France, l’Italie et l’Andalousie, soulignant quelques aspects ibériques dans la musique de plusieurs compositeurs. Trois d’entre eux, dont nous célébrons l’anniversaire ces jours-ci (Maurice Ravel, Pierre Boulez, Luciano Berio), accompagnés d’Igor Stravinsky, dialoguent avec deux représentants de l’École de Grenade que l’on gagnerait à découvrir en dehors de l’Espagne : José García Román (1945-) et Francisco Guerrero Marín (1951-1997). Si l’écriture de ce dernier se caractérise habituellement par une polyphonie dense et compacte, son Concierto de cámara fait partie des pages les plus lumineuses du compositeur, du fait de l’hétérogénéité de l’effectif. Román, quant à lui, présente Camino Blanco y sin término (Un chemin blanc et sans fin), une création percussive, brillante et narrative, inspirée de poèmes de Léon Felipe.

Enfin, deux concerts de l’Orchestre symphonique de la SWR et du pianiste français Alexandre Kantorow, consacrés à Johannes Brahms, marquent le finale du festival. Une fois de plus, les deux concertos pour piano ainsi que les symphonies n° 1 et n° 2 s’invitent sur le site merveilleux de l’Alhambra. Une sorte de complicité s’établit entre le jeu resplendissant et élégant de Kantorow et l’orchestre, qui semble adopter le timbre étonnamment léger du piano. De même, le chef d’orchestre Pablo Heras-Casado met en valeur les rares moments de calme et de fragilité des deux symphonies. Le bis du premier concert, Liebestod dans un arrangement pour piano de Franz Liszt, est espiègle, Brahms étant généralement perçu aux antipodes de Wagner et Liszt.
L’année prochaine, le festival soufflera ses soixante-quinze bougies et le programme est déjà attendu avec impatience.