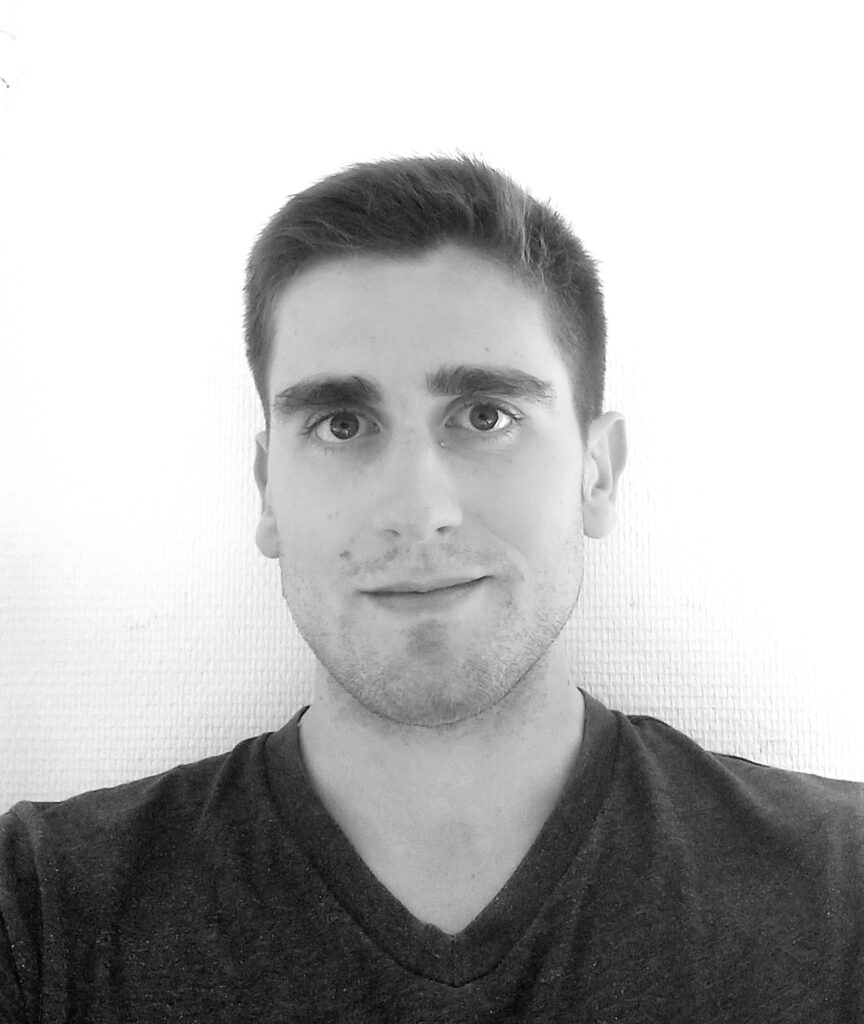Après un prologue et une première journée du Ring qui n’ont pas exactement remporté tous les suffrages, Calixto Bieito semble avoir été plus inspiré par l’atmosphère de conte de fées dans laquelle baigne Siegfried. La deuxième journée de la tétralogie retrouve en effet plus d’un motif du Conte de celui qui s’en alla pour apprendre la peur des frères Grimm, où l’initiation semée d’embûches du jeune héros le conduit à découvrir l’amour et à alterner exploits et déconvenues dues à sa naïveté. Les décors immenses de Rebecca Ringst plongent le spectateur dans une forêt post-apocalyptique : entendez par là que les arbres y poussent à l’envers et à l’horizontale. L’effet est réussi : les frondaisons des arbres vont servir de toile, tout au long de l’opéra, à des projections de Sarah Derendinger qui, sans avoir un sens bien clair, animent avec puissance la scène. Les lumières de Michael Bauer, éclairant alternativement les différents plans et angles de la forêt, créent efficacement des atmosphères tantôt lugubres et tantôt idylliques. Le tout remplit ingénieusement le plateau de Bastille, recouvert de gazon.
Cet esprit de conte de fées se retrouve, mélangé à des influences pop culture, dans les costumes qu’Ingo Krügler imagine pour Fafner (voir notre post à ce sujet) et pour l’Oiseau (post-it jaune canari et perruque rutilante). La scène du dragon est magistralement servie par un gigantesque masque noir transpercé de faisceaux lumineux aveuglants qui déchirent le navire parisien. L’abondant emploi de fumée est souvent judicieux, favorisant des brumes mystérieuses et renforçant l’efficacité des lumières.
Alors quelle déception quand la dernière scène nous ramène dans le monde des constructions métalliques posthumaines ! Brünnhilde est congelée façon Nicholson à la fin de Shining, dans une salle rectangulaire dont le quatrième mur est une pellicule plastique que Siegfried transperce de son épée (pour ceux qui n’auraient pas compris qu’il s’agit d’une scène d’initiation sexuelle). La lumière est d’une blancheur extrêmement froide et la direction d’acteur manque totalement sa cible dans le duo d’amour. Heureusement qu’à ce stade l’orchestre de l’Opéra de Paris s’était réveillé, car la musique doit faire beaucoup pour racheter la laideur du plateau.
Réveillé, dit-on, car l’orchestre placé sous la baguette de Pablo Heras-Casado nous avait donné des frayeurs dans le premier acte : tout en mollesse, sans netteté ni mouvement, jusque dans un chant de la forge poussif et rythmiquement fragile qui faisait craindre le pire. Le chef espagnol a repris la main sur sa phalange au cours du deuxième acte pour proposer un beau troisième acte, tendu de désir et pas avare en décibels – malgré les approximations régulières des cuivres, qu’on retrouve jusque dans l’appel du cor au II. Les pages d’idylle avec Brünnhilde sont magnifiquement caressées par la ligne expressive que Heras-Casado insuffle à l’orchestre et la soirée s’achève ainsi sur un moment musical réussi.
Ce Siegfried se signale, dans la continuité de la Walkyrie, par son plateau vocal de très bonne tenue et, plus que dans la journée précédente, par des incarnations abouties. Ilanah Lobel-Torres est un Oiseau moins colorature qu’on ne le conçoit habituellement, mais cela importe peu tant elle affiche une juvénilité irradiante qui fait merveille des quelques phrases de son rôle. Le charisme de Marie-Nicole Lemieux sert une Erda qui perd la raison et qui est plus maternelle qu’à l’accoutumée : Bieito la fait assister au duo Siegfried-Wotan, ce qui permet ensuite une scène assez forte, où elle contemple la lente arrivée de la prison de plastique de sa fille, avec une douleur touchante. Vocalement, la brièveté du rôle ne lui laisse pas le temps d’asseoir sa projection, même si on admire toujours ses couleurs somptueuses. Tamara Wilson confirme la très bonne impression qu’avait laissée sa Brünnhilde dans la première journée : si le timbre n’a pas les dernières séductions, la voix est dotée d’une ampleur parfaitement contrôlée, qui permet un bouleversant « Ewig war ich, ewig bin ich » chanté à mi-voix, peut-être le sommet d’émotion de la soirée.
Le versant masculin de la distribution, bien plus sollicité par l’œuvre, est presque irréprochable. Fafner caverneux et sonore alors même qu’il n’est pas amplifié, Mika Kares force l’admiration. L’Alberich de Brian Mulligan est parfaitement abouti, jouant juste ce qu’il faut d’une certaine dose de Sprechgesang, se montrant parfait diseur des allitérations de Wagner et traînant sur le plateau sa joie mauvaise après l’assassinat de son frère. Mime justement, trouve en Gerhard Siegel un interprète de premier plan : la proposition est moins pittoresque que ce à quoi d’anciennes versions ont pu habituer, mais on gagne en ligne de chant et en subtilité du jeu ce qu’on perd en nasalité et en glissandi. Son art d’acteur éclate dans la scène où il dévoile contre son gré son plan d’empoisonner Siegfried, ainsi que dans la dispute entre les deux nains, franchement réussie. Derek Welton possède de Wotan la stature, la noblesse de chant et l’émission autoritaire qui feraient de lui un interprète quasi idéal, mais manquant un peu de projection : le premier acte le trouve ainsi à court de son contre l’orchestre. Comme dans la Walkyrie où il dansait de joie pendant ses adieux, ce Wotan est en proie à des accès d’hystérie surprenants, comme lorsqu’il mord Alberich ou violente Erda. Andreas Schager, enfin, est assurément l’un des meilleurs tenants actuels du rôle de Siegfried, dont il a la vaillance, l’éclat, la projection insolente et le caractère impulsif. La direction d’acteur semble l’avoir poussé vers une incarnation plus héroïque que touchante, et il n’est du reste pas un Siegfried franchement juvénile, ni physiquement, ni vocalement, mais on tient là un interprète au charisme efficace et aux moyens démesurés – auxquels, notons-le, Gerhard Siegel tient tête dans le duo de l’acte I, ce qui n’est pas une mince affaire.
Bieito s’emploie scrupuleusement à montrer qu’il n’est pas esclave des indications du livret : ainsi Siegfried ne forge rien pendant la chanson du forgeron ni ne brise aucune enclume. Plus grave, la lance de Wotan, que ce dernier rafistole au premier acte (puisque Fricka l’a réduite en morceaux dans la Walkyrie), n’est pas brisée par Notung au dernier acte. Siegfried ne brandit même pas son épée (que, curieusement, il tient par la lame et non par la poignée tout au long de la soirée) : il se contente de saisir la lance de son grand-père, qui s’en va tout penaud pour sa dernière apparition…
La cohérence du projet de Bieito à l’échelle du Ring a encore du mal à se dégager à ce stade, malgré quelques clins d’œil aux soirées précédentes (les humanoïdes d’Alberich, le fauteuil rouge de Wotan, la robe de Sieglinde revêtue par Siegfried). Si l’on ressort de Siegfried avec plus d’images marquantes que des deux premiers volets, on a l’impression d’un intermède verdoyant et merveilleux qui se referme brusquement dans la dernière scène, en laissant songeur sur ce que Le Crépuscule des dieux pourrait apporter comme synthèse de tout cela.