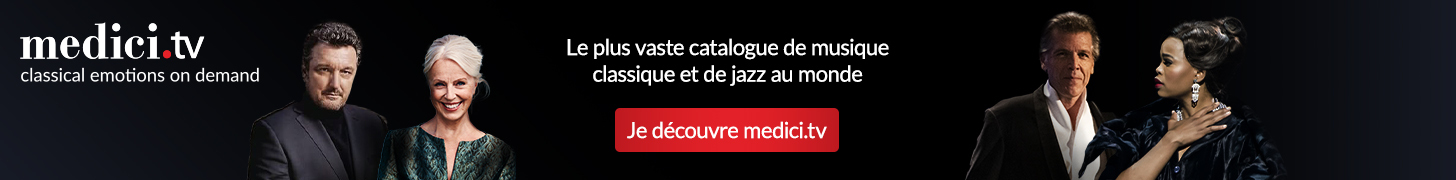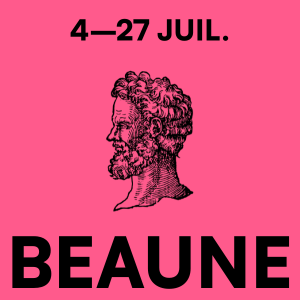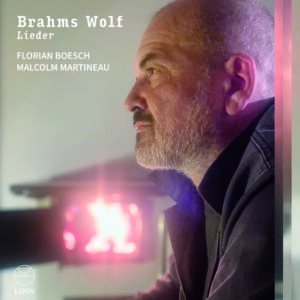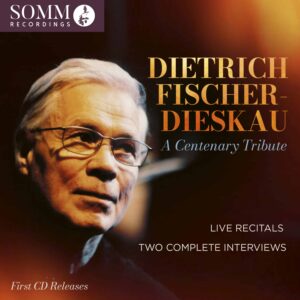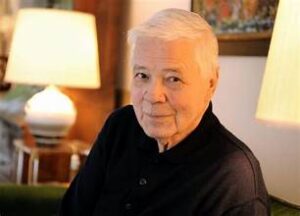Depuis Sophocle, les recréations de l’histoire d’Œdipe sont innombrables, selon chaque époque, en passant par Jean Cocteau, Alfred Hitchcock, Pier Paolo Pasolini ou Steven Spielberg. Le mythe est revisité à l’aune d’acteurs prestigieux, parmi lesquels Jean Mounet-Sully occupe une place particulière, puisque Enesco raconte que c’est après l’avoir vu en 1906 dans le rôle à la Comédie-Française qu’il eut l’idée de faire de ce sujet un opéra. À l’instar de Sarah Bernhardt, dont il avait le style déclamatoire et la gestuelle, il est possible de voir des images animées (1) et d’écouter la voix de Mounet-Sully, un des acteurs français majeurs des années 1880 à 1910. Mais il s’agissait là d’un acteur du siècle précédent, dont le nom était certes encore vivace dans les années 1930, mais dont le jeu était déjà totalement démodé. Le texte du livret d’Edmond Fleg est de même aujourd’hui pour le moins dépassé.
La mezzo finlandaise Lilli Paasikivi, ancienne directrice de l’Opéra national d’Helsinki et nouvelle intendante du festival de Bregenz, promet de continuer à présenter à l’avenir des relectures d’opéras peu connus, à l’instar de cet Œdipe. Mais pour le cas présent, soyons bien clairs : certes, Œdipe tue son père et épouse sa mère, mais en fait il ne connaissait en rien l’identité des gens qu’il rencontrait. Œdipe constitue bien une espèce de quintessence de la tragédie, entre destin, libre arbitre et volonté des dieux, car aveuglé au sens figuré, il devient véritablement aveugle par choix, après s’être crevé les yeux.

Tout cela est intéressant d’un point de vue sociologique, historique et pourquoi pas psychanalytique, mais paraît aujourd’hui bien éloigné des préoccupations de la jeune génération, qui n’a pas été nourrie aux textes classiques. Cela peut expliquer que le metteur en scène Andreas Kriegenburg n’ait pas voulu s’embarrasser des complexes traditionnels, et ait préféré laisser son décorateur Harald B. Thor proposer une esthétique un peu simpliste entre péplum italien de série B et imagerie saint-sulpicienne. Non que cela soit désagréable, car il y a quand même des moments forts, dont le combat dans un brouillard bleu clair évoluant vers le mauve foncé, ainsi que des scènes de foules entre joie et désespoir, toujours bien rendues par les excellents chœurs de Prague.
Afin de clarifier le propos – si tant est qu’il en était besoin – les quatre actes sont rebaptisés de façon un peu primaire « le feu, l’eau, la cendre et le bois ». Les beaux décors monumentaux d’Harald B. Thor se succèdent en illustrant ce parti-pris, sans vraiment soulever d’enthousiasme. Mais c’est dans le domaine musical et vocal que le drame éclate véritablement, servi par une équipe de très haut niveau. À commencer par la fosse, où le chef Hannu Lintu insuffle au bel orchestre des Wiener Symphoniker, habitués de Bregenz, un élan et une souplesse soulignés par une harmonie soignée des pupitres, et un équilibre parfait entre la fosse et le plateau.
On ne saurait trop se féliciter que ce soit un chanteur français qui assure le rôle-titre. Paul Gay, de sa haute stature et d’une voix à la fois puissante, musicale, sans faiblesse et d’une grande expressivité, impose un personnage torturé, dont l’évolution psychologique suit parfaitement celle des évènements. Très à l’écoute de ses partenaires, il est la cheville ouvrière de tout le spectacle, notamment dans les scènes où il est confronté à d’autres fortes personnalités, qu’il s’agisse du Tirésias d’Ante Jerkunica, du Créon de Tuomas Pursio, du berger de Mihails Čulpajevs ou du grand prêtre de Nika Guliashvili. Tous sont excellents, aussi bien dans le jeu, dans la projection sonore, que dans la prononciation du français, et contribuent largement à soutenir l’intérêt pour un texte parfois un peu ennuyeux, d’autant que le compositeur a donné la prééminence aux voix de barytons ou de basses (seules deux voix de ténors défendent deux rôles secondaires).
Les trois rôles féminins principaux ont également des voix proches dans la tessiture mezzo. On retrouve avec plaisir Marina Prudenskaya (Jocaste), dont on avait beaucoup aimé l’Amnéris de 2008 lorsqu’elle était en troupe à Stuttgart. Elle joue parfaitement le rôle torturé de la reine malheureuse à tous points de vue, d’une voix qui tire plus vers le grand soprano lyrique, quasi falcon. La sphinge, plus admirable esthétiquement que véritablement inquiétante, est défendue très honorablement par Anna Danik, ainsi que la Mérope très expressive de Tone Kummervold. Tous les autres rôles secondaires sont parfaitement assurés, faisant de cette belle production, certes peu révolutionnaire, un spectacle de bonne tenue.
Prochaines représentations 20 et l28 juillet 2025.
(1) Films Œdipe-Roi d’André Calmettes pour Film d’Art en 1908, et de Gaston Roudès pour les films Éclipse en 1912, avec Mounet-Sully dans le rôle d’Œdipe.