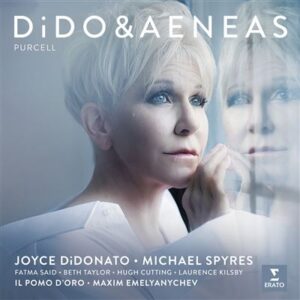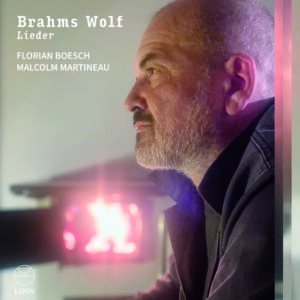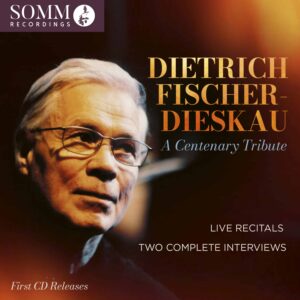S’il est un endroit où l’opéra peut encore se targuer d’être populaire, c’est Vérone. Dès les premières mesures de Carmen, le public frappe dans ses mains pour marquer le rythme ; les applaudissements fusent après chaque numéro. Le chef-d’œuvre de Bizet a fait son entrée au répertoire des Arènes en 1914, pour reproduire le succès de l’Aida lors de l’inauguration du festival l’année précédente. Il reste aujourd’hui le deuxième opéra le plus joué de son histoire.
Dans cette production, datée de 1995, Séville est une fête. Franco Zeffirelli n’a ménagé ni les décors – reproduction des lieux de l’action à la rondelle de chorizo près –, ni les costumes – plusieurs tenues pour chacun des protagonistes, à l’exception de Micaëla, condamnée à sa sempiternelle natte blonde et robe bleue –, ni les danseurs, ni les figurants. C’est qu’il faut occuper un plateau équivalent à environ un tiers d’un terrain de football. Tout ce petit monde s’égaye en un mouvement incessant qui ne doit rien au hasard. Derrière la manière dont chacun des protagonistes se détache de la foule sans qu’on ait à le chercher du regard, se devine la main experte du metteur en scène. Éventail, castagnettes, sombreros cordobés, traje de flamenca, habits de lumière : tout participe à la représentation d’une Espagne d’Epinal – et plus largement à une version stéréotypée de Carmen : l’opéra de Bizet en mondiovision, tel que figé dans la mémoire collective, avec le choix des récitatifs mis en musique par Guiraud, des profils vocaux conformes à la norme établie – grande voix de mezzo-soprano pour Carmen –, une approche standardisée que des interprétations récentes ont montré possible de renouveler – comment ne pas penser à Béatrice Uria-Monzon, trop tôt disparue cet été.
© Fondazione Arena di Verona
Aigul Akhmetshina ne cherche d’ailleurs pas à emprunter des chemins alternatifs ; au contraire, elle s’inscrit dans la tradition qui veut la gitane altière, bras en l’air, poing sur la hanche et jupe relevée sur le genou. La proposition est recevable car elle s’appuie sur d’authentique moyens vocaux : un timbre titrant à plus de 15 degrés : capiteux, rond, fruité ; une ligne longue tracée d’un geste souple, une projection confortable emplissant sans mal l’espace – pourtant vaste – des Arènes. La tragédienne virevoltant sur scène avec une aisance dépourvue de vulgarité n’a rien à envier à la chanteuse. Comment alors ne pas s’étonner qu’en dépit de son jeune âge – moins de 30 ans –, la mezzo-soprano russe figure parmi les titulaires incontournables du rôle sur les plus grandes scènes, New York en tête. Que fait Paris ? La question se pose avec encore plus de pertinence si on examine l’intégralité de la distribution (ainsi que celle des autres ouvrages à l’affiche des Arènes cet été). Vérone accueille les meilleurs chanteurs de la planète, la plupart peu – pour ne pas dire pas – invité en France. C’est vrai d’Erwin Schrott, une des plus belles voix de baryton du circuit international, irrésistible de sex-appeal dans Escamillo, même si toujours enclin au cabotinage avec des notes saillantes tenues au-delà du raisonnable, et quelques ricanements glissés çà et là au gré de sa désinvolte fantaisie. C’est vrai de Marieangela Sicilia, révélée dans La Juive à Turin en 2023. La soprano italienne éperonne la trop sage Micaëla d’aigus acérés dont la précision, n’entame ni l’aplomb, ni la pureté d’émission. C’est vrai dans une moindre mesure de Francesco Meli. Les éclats de Don José s’avèrent obstacles difficiles à franchir pour un ténor d’essence lyrique – l’affrontement avec Escamillo et les exhortations adressées à Carmen au troisième acte manquent de flamme. Mais le chanteur s’épanouit dans la demi-teinte, lors du duo avec Micaela puis dans une « fleur que tu m’avais jetée » tout en nuances. Son expérience du rôle, la conscience de ses moyens et la gestion de ses ressources lui permettent aussi de surmonter les tensions de la scène finale. Autre avantage à porter à son crédit – comme à celui des trois autres protagonistes –, une prononciation française plus que correcte pour des interprètes d’origine étrangère.
Ce n’est malheureusement pas le cas des seconds rôles dont aucun ne se détache véritablement. Le chœur s’exprime aussi dans un espéranto peu compatible avec la langue de Meilhac et Halèvy. Quelques décalages nuisent à la scène de liesse du quatrième acte. La direction de Francesco Ivan Ciampa se conforme à cette vision traditionnelle de l’opéra de Bizet – de bon niveau mais sans surprise.