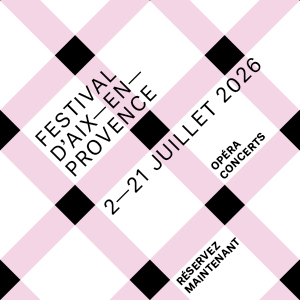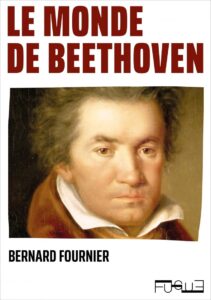Difficile de dire à quand remonte la fonction de directeur musical, d’autant que le sens que le terme revêt a varié au fil des siècles et que les diverses fonctions liées à l’activité lyrique se confondent. Du XVII au XIXe siècle, et en particulier en Italie, l’impresario achète la concession d’un théâtre à son propriétaire. Il est alors responsable de tous les aspects de la production : il commande les nouvelles œuvres aux compositeurs, engage les chanteurs et le chef et les musiciens de l’orchestre. Domenico Barbaja est l’un des plus célèbres d’entre eux et on lui doit d’avoir produit nombres d’œuvres de Donizetti, Bellini ou Rossini. Parfois l’impresario fait faillite ou part avec la caisse, et la chose semble assez commune pour que l’on s’en amuse, par exemple dans l’excellent (et exigeant) Opera seria de Florian Leopold Gassmann.
C’est un peu le cas de l’Abbé Perrin, premier administrateur de l’Académie d’opéra (ancêtre de notre actuel Opéra National de Paris) qui a obtenu de Louis XIV le privilège de monter des ouvrages lyriques le Il est assisté du premier directeur musical de l’institution, le compositeur Robert Cambert. Par « privilège », il faut entendre ici « exclusivité », dans le cas présent pour 12 années : tout compétiteur serait d’ailleurs passible d’une amende de 10 000 livres (plus de 200 000 euros actuels), de la confiscation des machines, du théâtre et des costumes. En France, on n’a jamais vraiment aimé la concurrence.
À la suite de malversations dont il n’est pas responsable, Perrin est emprisonné pour dettes. Jean-Baptiste Lully récupère le privilège et collabore avec deux directeurs musicaux, les compositeurs Jean-François de Lallouette et Pascal Collasse. Pendant tout le XVIIIe siècle, il n’y aura plus de directeur musical à l’Opéra de Paris et il faudra attendre le XIXe pour voir la fonction à nouveau remplie (et encore, pas longtemps : de 1824 à 1826) par Rodolphe Kreutzer (l’homme de la sonate). Par ailleurs, dans plusieurs pays, les fonctions de compositeurs et de directeur musical se confondent : le « Maître de chapelle » (« Maestro di capella » chez les italiens, ou « Kapellmeister » en pays germaniques) est ainsi responsable de la musique religieuse ou événementielle du souverain, musique qu’il compose et dirige (nous simplifions ici ce sujet complexe). Tous ces directeurs musicaux dirigent essentiellement la musique de leur temps (Colasse dirige la création de la Médée de Marc-Antoine Charpentier), voire la leur, et officient dans leurs pays d’origine. Il y a bien quelques exceptions, comme par exemple Gaspare Spontini, qui est nommé Kapellmeister en chef à Berlin en 1820 (le sens de « Kappellmeister » a dérivé au fil des temps vers celui de chef d’orchestre).
La transition vers le directeur musical au sens moderne est progressive comme on peut le voir à travers de l’exemple d’Arturo Toscanini. Déjà célèbre, il est nommé directeur musical du Teatro Regio de Turin en 1895 (à 28 ans), constituant pour l’occasion un nouvel orchestre. Il dirige la première de La Bohème (1896) tout en se consacrant à la musique symphonique. Les réformes du chef italien à la tête de la Scala, dont il est nommé directeur musical en 1898 sont connues : présence obligatoire des artistes aux répétitions, interdiction des bis et des chapeaux des dames, respect des indications de la partition (en particulier pour les chanteurs), suppression des coupures de complaisance, modification du rideau de scène, extension de la fosse (lors de son second mandat)… Toscanini se consacre aussi au répertoire, redonnant une nouvelle vitalité à Falstaff (moyennement accueilli à sa création) ou déterrant Don Pasquale dont il fait un triomphe malgré le scepticisme général.

Finalement, le directeur musical tel que nous le connaissons aujourd’hui n’apparaîtra vraiment qu’au tournant des XIX et XXe siècle, avec la facilité due aux transports modernes, la puissance naissante des États-Unis d’Amérique (bien décidés à attirer dans le Nouveau Monde tout ce que l’ancien comptait de meilleur), les exils consécutifs aux guerres mondiales et la (relative) mort de la musique classique en tant que production de son temps. Progressivement, le centre de gravité se déplace en effet : on ne s’intéresse de moins en moins aux nouvelles œuvres, et de plus en plus à la façon dont on peut renouveler la lecture des anciennes. C’est une tendance qui explosera d’ailleurs plus tard avec la multiplication de formations spécialisées dans le répertoire baroque et/ou sur instruments anciens, chacune ayant ses fans prêts à excommunier les formations rivales. La nomination d’un directeur musical va devenir la norme pour le symphonique. L’Orchestre de la Suisse romande est créé en 1918 et son fondateur, Ernest Ansermet, le dirige jusqu’en 1967. Eugene Ormandy dirigera le Philadelphia Orchestra pendant 44 ans (1936 – 1980). Ievgueni Mravinski dirige l’Orchestre philharmonique de Leningrad de 1938 à 1988 ! Succédant à Erich Leinsdorf en 1946, Georg Szell sera à la tête du Cleveland Orchestra jusqu’à sa mort en 1970, soit pendant 25 ans.

© Raftermen (ça ne s’invente pas)
À quoi sert ce directeur musical ? Tout dépend de la maturité de l’orchestre mais globalement, et avec des dosages variables, voici ce qu’on pourrait dire en simplifiant beaucoup. C’est un bâtisseur : il est là pour construire un nouvel orchestre, ou l’améliorer, ou le faire évoluer, ou à l’inverse lui conserver sa spécificité. Dans son brillant panorama des directeurs musicaux pour France Musique, Christian Merlin rapporte ces propos de Christoph von Dohnányi, qui avait succédé à Georg Szell, à l’issue d’un concert de l’Orchestre de Cleveland : « Nous faisons un beau concert, et Georg Szell a de bonnes critiques » (« We give a great concert, and George Szell gets a great reviews » ). Contrairement à un chef invité, le directeur musical a le temps pour lui : il peut travailler sur la sonorité, le style, mettre en valeur les spécificités, faire en sorte que la formation soit remarquable par son identité propre. On n’attend pas d’un directeur musical qu’il donne chaque soir une représentation exceptionnelle mais que son orchestre évolue dans une direction bien précise. Il y a bien sûr des cas particuliers, notamment pour les formations d’excellence : Herbert von Karajan fut ainsi directeur musical à vie de l’Orchestre philharmonique de Berlin. Le directeur musical est un manager au sens noble du terme, ce qui implique des responsabilités pas toujours agréables : recruter de nouveaux talents, mettre en valeur un instrumentiste, mais aussi gérer des artistes dont le travail ne correspond plus aux attentes de la formation. C’est aussi un professionnel qui s’adresse à d’autres professionnels, et de haut niveau. Il doit donc les convaincre et les entrainer avec lui. Il doit être un leader dont la vision est partagée par l’orchestre.
Les directeurs musicaux d’aujourd’hui restent généralement moins longtemps en poste et beaucoup cumulent plusieurs formations, mixant parfois le symphonique et le lyrique. Ils n’ont souvent plus les méthodes généralement autoritaires des pionniers des générations précédentes (quoique…), mais on leur demande en revanche de cultiver une image « cool » qui permettra de séduire des sponsors de plus en plus rares et de plus en plus indispensables : un tatouage sur l’épaule sera ainsi plus dans l’air du temps qu’une redingote exagérément amidonnée (1). Grâce à Gustavo Dudamel, le Los Angeles Philharmonic dispose par exemple d’un niveau de sponsoring exceptionnel (de l’ordre de 60 millions de dollars annuels : à titre de comparaison, l’AROP contribue pour une vingtaine de millions d’euros au financement de l’ONP). Enfin, le directeur musical est aussi un businessman qui doit capitaliser sur son talent, son image ou encore sa communication pour remplir les salles et vendre des enregistrements. Rappelons enfin que la fonction est largement occupée par des directeurs masculins.
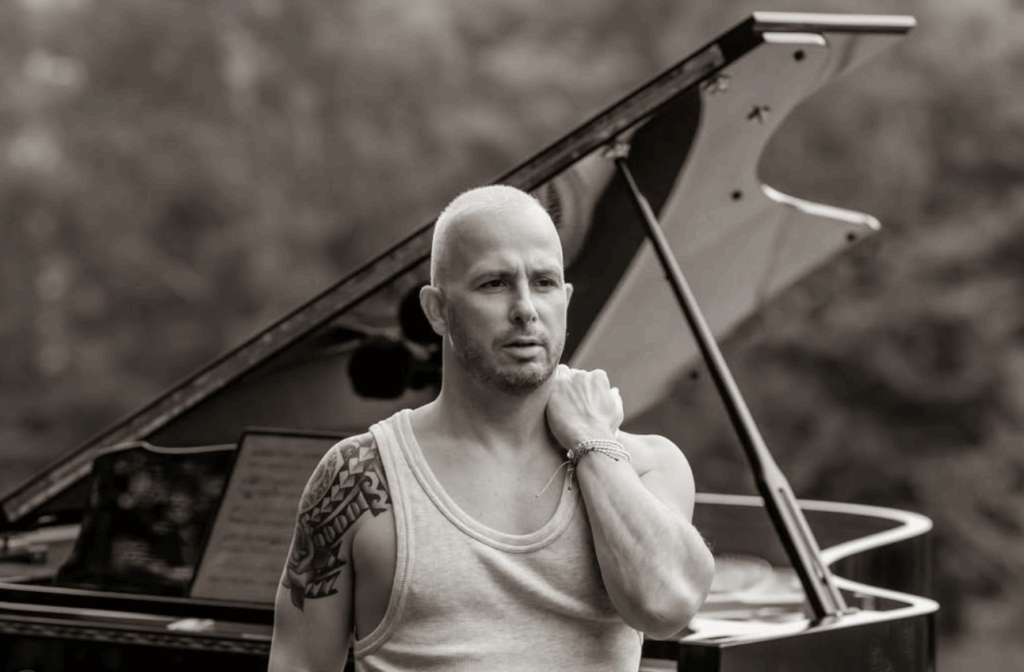
À l’opéra, les directeurs musicaux sont moins systématiques. La Scala en compte toutefois une dizaine depuis 1871, le poste étant régulièrement occupé. On ne s’attardera pas sur l’Opéra de Vienne sinon pour dire que ça ne devait pas être rose tous les jours : depuis 1867, une trentaine de noms se disputent les postes de directeur général et/ou de directeur musical, les fonctions étant tantôt cumulées, tantôt partagées, tantôt occultées (seuls six chefs ne seront « que » directeurs musicaux). Rappelons par ailleurs que la Philharmonie de Vienne, largement dédiée à la musique symphonique (mais qui se produit dans le lyrique au Festival de Salzbourg), et émanation de l’orchestre de l’opéra, n’a pas de directeur musical attitré. À Munich, le Bayerisches Staatsorchester est plus régulier avec une vingtaine de directeurs musicaux dont une demi douzaine officiant plus de 10 ans. En ce qui concerne le Staatsoper Unter den Linden à Berlin, une moitié des 20 administrateurs que comptent l’institution depuis 1743 sont de purs chef d’orchestre (les autres sont surtout compositeurs). De création plus récente (1954), le Lyric Opera de Chicago n’en compte lui que trois : Bruno Bartoletti, Andrew Davis et aujourd’hui Enrique Mazzola. Le Metropolitan Opera est encore un cas particulier : Auguste Vianesi, est le directeur musical de la seule saison inaugurale (1883 – 1884) et il faudra attendre 1973 pour voir nommé Rafael Kubelík comme successeur… pour une saison ! Choisi à 31 ans seulement, en 1975, James Levine va régner sur l’institution pendant 45 ans, hissant l’orchestre à des sommets, mais restant sans doute également trop longtemps en place. Nommé en 2002 à la tête de l’orchestre du Royal Opera, Antonio Pappano, en 22 ans de labeur, a considérablement élevé le niveau d’un formation initialement très moyenne (la concurrence avec les autres formations londoniennes est rude). Cas particulier, Christian Thielemann sera le premier et dernier directeur musical du Festival de Bayreuth (2015 – 2020) : il déclarera que, compte tenu de ses responsabilités réelles, un assistant chef d’orchestre ferait tout autant l’affaire. En France, on pourra citer Michel Plasson, resté 30 ans à la tête de l’Orchestre du Capitole de Toulouse et auquel on doit également une longue liste d’enregistrements mémorables dans le répertoire français. On n’aura pas le temps de s’arrêter sur l’incroyable richesse des orchestres baroques (Wikipedia en recense une centaine pour la Belgique et la France, ce qui semble autant, voire plus, que tout le reste du monde réuni). Enfin, il faudrait citer des ensembles atypiques comme Le Balcon où Maxime Pascal (à qui il est également arrivé de diriger brillamment le répertoire à l’Opéra-Bastille) parvient à fédérer, avec succès, public et instrumentistes autour d’œuvres réputées ardues comme celles de Karlheinz Stockhausen.
La nomination d’un directeur musical d’une maison lyrique pose aussi la question du répertoire. La tentation est forte pour le chef de privilégier les ouvrages qui le mettent en valeur lui et son orchestre, ou ceux qui constitueront sa carte de visite pour son prochain poste (surtout s’il vise une formation symphonique). Or, de ce point de vue, il est plus intéressant de programmer certains ouvrages en particulier (toujours les mêmes), plutôt que des opéras qui, par exemple, mettraient d’abord en avant les voix. On applaudira le chef qui réussit Fidelio, La Dame de Pique, Falstaff, Pelléas et Mélisande, etc. (on parle d’ailleurs parfois à cette occasion « d’œuvres de chef ») tandis qu’on citera d’abord les chanteurs pour Bellini, Donizetti ou le premier Verdi, voire pour l’opéra français, en oubliant qui dirige (ce qui est malheureusement une erreur : ce répertoire à lui aussi besoin de chefs de qualité). On a ainsi vu des directeurs musicaux modifier l’ADN d’une institution en infléchissant un renouvellement progressif du répertoire de celle-ci.

Et l’Opéra de Paris dans tout ça ? Après Kreutzer, l’institution n’aura plus de directeur musical pendant près de 125 ans. Désigné en 1986 par le nouvel administrateur, Jean-Louis Martinoty, Lothar Zagrosek ne restera pas plus longtemps en poste que celui-ci (1989). Nommé directeur artistique et musical du tout nouvel Opéra-Bastille, et candidat évident, Daniel Barenboim est limogé par Pierre Bergé avant même l’inauguration du bâtiment. On lui reprochera entre autres d’avoir voulu modifier la sonorité de l’orchestre en n’ayant plus affaire à des luthiers français (le chef aurait voulu lui donner une sonorité plus générique, donc sans surprise pour les chefs invités). Cela sentait un peu la cabale, et il s’agissait plus vraisemblablement d’enjeux de pouvoirs, ceux-ci étant bien plus importants dans une maison d’opéra que pour une formation purement symphonique. Myung-Whun Chung fut certainement plus souple puisqu’il tiendra les rênes de 1989 à 1994, avec de beaux résultats (il dirigera 15 opéras de 12 compositeurs et une soirée de ballets). James Conlon sera, de fait, le premier directeur musical « durable » de l’institution, construisant le répertoire de la maison de 1995 à 2004 (en 10 ans, 32 ouvrages de 17 compositeurs, auxquels on pourrait ajouter 5 titres dirigés avant sa nomination). De 2002 à 2020, Philippe Jordan va diriger, en 19 ans, 35 titres lyriques de 14 compositeurs seulement. Le répertoire n’est guère aventureux mais le chef est apprécié du public, et on lui devra le premier Ring complet de l’institution. Gustavo Dudamel n’a dirigé qu’une série de Bohème quand il est choisi en 2021 pour un mandat de six ans. Ce n’est pas un chef de fosse, mais un chef symphonique, ce qui aura des conséquences. Il bénéficie d’un agenda allégé qui lui permet de tenir ses engagements auprès du Los Angeles Philharmonic (et peut-être même de limiter la pression fiscale, qui sait). Reconnaissons qu’il n’a pas vraiment été chouchouté pour ses débuts, avec trois reprises aux distributions peu inspirées. Seuls Nixon in China et, dans une moindre mesure, The Dante Project, spectacle non lyrique, firent véritablement figure d’événement. Cerise avariée sur le gâteau, les projets de tournée furent annulés. Cinq opéras plus tard, le chef vénézuélien démissionne. Sur le papier, le choix était pourtant excellent : Dudamel avait une image jeune et dynamique propre à séduire les mécènes, il était apprécié de l’orchestre, et on aurait pu même rêver qu’il se rapproche du jeune public populaire (à l’image de ce qu’il fit au Vénézuela) pour casser l’image élitiste de l’opéra. Il n’en fut rien. Dudamel invoquera des raisons personnelles et la nécessité d’être près de sa famille, désormais basée à Madrid (« I have no plans other than to be with my loved ones, to whom I am deeply grateful for helping me to continue to be strong in my resolve to grow and remain challenged, both personally and artistically, each and every day »). Sur ce, il s’empressera de signer… avec le New York Philharmonic ! Le nouveau salaire n’a pas été communiqué mais on rappellera que les émoluments de Dudamel à Los Angeles s’élevaient à plus de deux millions et demi de dollars. On promit de s’écrire. Depuis ce départ, la perspective des fermetures prochaines de Bastille et Garnier pour travaux faisant fort justement s’interroger sur le besoin de se presser pour combler le poste.

Alors un directeur musical à l’ONP, pourquoi pas, mais surtout pour quoi ? Les responsabilités administratives peuvent être assurées par un personnel dédié et s’appuyer sur des décisions collégiales (pour le recrutement par exemple). Changer la couleur de l’orchestre serait un choix discutable, un son « français » étant un atout. Diriger beaucoup de représentations n’est pas un but artistique en soi, surtout s’il s’agit de ronronner gentiment, même si la solution peut s’avérer économique pour la maison (c’est généralement le rôle d’un chef principal invité). Il ne s’agit d’ailleurs pas tant ici d’améliorer l’orchestre que de le sublimer. Force est de constater que l’on ne voit plus depuis longtemps des spectacles affichant complet et des foules quémandant un billet devant le théâtre. Certes, les causes ne se limitent pas à la nomination d’un directeur musical et l’analyse de Sylvain Fort reste d’une douloureuse actualité. Mais un directeur musical peut contribuer à infléchir ce nouvel élan nécessaire. La perle rare saurait susciter la passion (comme un Claudio Abbado autrefois à la Scala), et la transmettre autant à l’orchestre qu’aux chanteurs (comme James Levine au Met), et bien sûr au public. L’ambition et les défis réussis pourraient permettre de construire alors un lien de confiance avec ce dernier : ces dernières saisons, on a l’impression que les titres connus n’attirent plus autant car on les a trop vus (voir la billetterie de La Bohème de rentrée au moment où nous écrivons ces lignes), tandis que les ouvrages un peu plus originaux ont désormais du mal à trouver leur public (intelligemment, la reprise de l’excellente production de Rusalka bénéficie d’emblée d’un tarif promotionnel). Par ailleurs, un directeur musical doté d’un certain charisme et de visibilité médiatique apporterait à l’institution l’incarnation dont elle manque cruellement. Le public culturel a bien du mal à mettre un visage sur l’Opéra de Paris et ce n’est pas le job de son patron, Alexander Neef. La relation n’est pas non plus à sens unique. De son côté, le directeur musical est en droit d’espérer une rémunération convenable (c’est-à-dire élevée, pour dire les choses crûment, ce qui est en contradiction avec les injonctions de Bercy), une voix décisive dans les choix de la maison (orchestre, chanteurs, répertoire, voire metteurs en scène, sans parler des problèmes de cuisine comme l’acoustique et ou la gestion au jour le jour), une visibilité renforcée (tournées, premières en direct (et non des diffusions tardives une fois l’effervescence passée), enregistrements, actions éducatives via les réseaux sociaux…). À mains égards, la situation de l’ONP ressemble à celle du Met en 1970 : l’institution new-yorkaise avait alors fait le pari de la jeunesse et de l’enthousiasme. Si ces conditions ne sont pas réunies (et le seront-elles avant la fin des travaux de Garnier et Bastille ?), l’Opéra de Paris peut toutefois continuer à offrir des spectacles de qualité, avec les hauts et les bas qu’il aura connu ces 350 dernières années, mais sans ce supplément d’âme qui lui manque aujourd’hui et qui lui permettrait de séduire un public élargi. L’ère des maestros à la Stanislas Lefort est en tout cas révolue !
1 Spontini se fait faire un costume chez un tailleur.
– Monsieur Spontini, voulez-vous que la redingote descende jusqu’aux genoux ?
– Plus bas
– Bien. Jusqu’au mollet ?
– Plus bas.
– Alors, jusqu’à la cheville ?
– Plus bas, plus bas, vous dis-je.
– Plus bas, mais c’est impossible monsieur, cela vous gênerait pour marcher.
– Marcher ! Est-ce que je marche … ?
À lire également : Dix propositions pour remplacer Dudamel à l’Opéra de Paris
Bonus : Vladimir Horowitz sans filtre sur les grands orchestres