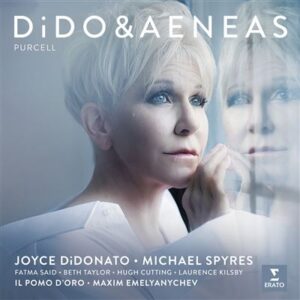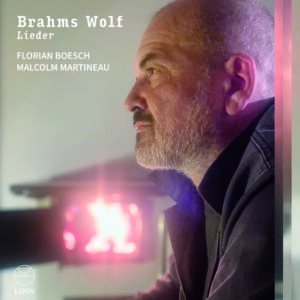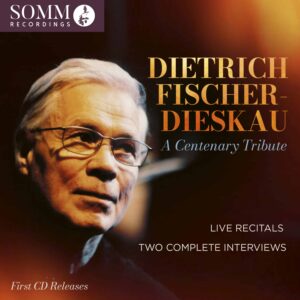Pourquoi cet opéra au programme du Festival Rossini de Bad Wildbad ? Parce que, outre l’intérêt que l’Orchestre Philharmonique de Cracovie, partenaire du Festival, porte à la promotion d’un compositeur au nom illustre en Pologne, les liens entre ce musicien et Rossini ont été nombreux et constants pendant près de trente ans. On en trouve trace par exemple en 1838, dans une lettre relative à une soirée chez Metternich pour entendre Giuditta Pasta, où Rossini donne du « cher confrère » à son cadet et le vouvoie avant de passer au « tu », ce qui indique une familiarité réelle et assoit la position de ce dernier dans la musique comme compositeur. En 1843 Rossini dirigera Poniatowski, qui est aussi un ténor professionnel, dans Otello. En 1850 ils seront voisins à Florence. Et si en 1860 Rossini n’ira pas à la première de Pierre de Médicis à l’Opéra, il a assisté à la générale, car alors Poniatowski et lui sont tous deux Parisiens et ont maintes occasions de se fréquenter.
L’intrigue de Pierre de Médicis est d’une simplicité exemplaire. Julien de Médicis, gouverneur de Pise, aime Laura Salviati, qui le lui rend bien. Mais son frère Pierre, duc de Toscane, convoite la jeune fille et est prêt à tout pour l’évincer. Il est secondé par le tuteur de Laura, le Grand Inquisiteur, qui espère, en aidant Pierre à assouvir son caprice, recueillir son appui pour être élu Pape. Il menace sa pupille, si elle refuse, de l’enfermer dans un couvent, et il le fait, car elle résiste, pour l’empêcher de fuir avec Julien. Mais Pierre étant un mauvais gouverneur ses exactions suscitent un mouvement de révolte armée dont Julien acceptera de prendre la tête. Au dernier acte Pierre, blessé, se repent : il veut atteindre le couvent avant que Laura ait prononcé les vœux qui rendront impossible son union avec Julien. Il arrivera trop tard et mourra tandis que les portes du cloître se referment sur Laura, laissant Julien dans l’affliction, une fin abrupte qui, sans mise en scène, a semblé déconcerter l’auditoire, avant qu’il ne libère son enthousiasme.
Mais qui était l’auteur, ce Poniatowski tantôt prénommé Giuseppe ou Joseph ? Petit-neveu du dernier roi de Pologne, il aurait pu se prénommer Józef, mais né à Rome où son père s’était exilé, de la liaison de celui-ci avec une Italienne plus jeune que lui de vingt ans et déjà mariée, il fut baptisé Giuseppe en 1814, et sera Joseph lorsqu’en 1854 il deviendra Français. Ces détails biographiques pourront sembler superflus, pourtant nous croyons qu’ils éclairent la personnalité qui s’exprime dans sa musique. Le milieu privilégié dans lequel il a grandi aurait pu faire de lui un riche oisif amateur, entre autres plaisirs, de musique. Mais il semble avoir été un homme qui ne faisait rien à moitié : il sera tour à tour ou simultanément chanteur, compositeur, administrateur d’institutions musicales, officier, diplomate international, sénateur du Second Empire, et compagnon d’exil de Napoléon III après 1870.
La musique de Pierre de Médicis est à l’image de son auteur. Nous y percevons une vitalité qui n’exclut pas la délicatesse mais qui ne lésine pas sur le « grand ». L’œuvre se veut « grand opéra » et elle en a tous les caractères, du sujet pseudo-historique à l’ampleur des masses, dont on peut connaître le détail dans le livret publié par Gallica. En 1860 le ministre des Beaux-Arts de Napoléon III, Polonais par sa mère la comtesse Waleska et fils de Napoléon Bonaparte n’avait rien à refuser à un Poniatowski. Le compositeur brosse alors une fresque grandiose conforme aux règles du genre sans renoncer à être lui-même. Oui, il connaît tous les ingrédients obligés, et il ne manque aucun chœur, aucun duo, aucun ensemble, mais son orchestration, telle qu’on nous la donne à entendre, reflète une verve irrésistible que certains auditeurs ont trouvé outrancière quand nous y avons ressenti la projection du riche tempérament d’un homme multiple qui tout en maîtrisant les codes refuse de s’enfermer dans le « bon goût ». Et cette démesure, cette luxuriance, sont aux dimensions d’un opéra qui se voulait grand et dont la représentation a dû être fastueuse. Il est certain que ce dynamisme José-Miguel Pérez-Sierra met toute son énergie à le faire sonner, mais s’il souligne les contrastes il n’en caresse pas moins les courbes mélodiques, et l’ampleur sonore, si elle est fréquente, n’engloutit pas les finesses. Le plaisir qu’il éprouve à diriger cette musique est perceptible et communicatif, comme pourrait l’être celui d’ un enfant découvrant une caverne de trésors, et l’auditeur n’a de cesse de les découvrir avec lui, tout ébahi que la querelle de buveurs devienne une fugue, ravi par la subtilité des chœurs d’inspiration religieuse ou subjugué par la splendeur du ballet du deuxième acte, dont la chorégraphie était réglée à la création par Marius Petipa.
En fait, peut-être Giuseppe ou Joseph Poniatowski, comme on voudra, est-il le dernier romantique ? Il y a dans l’ampleur de l’opéra le souffle d’un Hugo et c’est la musique qui le lui donne. Oui, dira-t-on, cette histoire de frères rivaux pour l’amour d’une femme, elle vient après le Trouvère. Mais ce Grand Inquisiteur, il vient avant Don Carlos, et certaine mélopée n’anticipe-t-elle pas Aida ? Quand Julien va prier sur la tombe de sa mère, n’est-ce pas Arnold qui revient chez son père ? Oui, la situation est analogue, avec le héros solitaire que ses partisans viennent mener au combat, mais l’écriture n’est pas un calque, et Poniatowski donne à la scène une démesure étrangère au classicisme rossinien ! Et quand on est pris par le rythme insidieux d’une valse, Gounod ne l’aurait-il pas entendue ? A maintes reprises l’oreille est sollicitée par ce qui semble une réminiscence et est souvent une anticipation. C’est dire tout l’intérêt que revêt cette redécouverte intégrale après celle effectuée à Cracovie en 2011.
Le rôle de Pierre, le méchant de l’histoire, a été écrit pour un ténor, exception à la constante formulée par Bruno Cagli. Hérissé de redoutables ascensions dans l’aigu, il reflète la virtuosité qui fut celle du compositeur quand dans sa jeunesse avec son frère et son épouse il formait un trio vocal renommé. Patrick Kabongo a-t-il le poids vocal suffisant ? Nous ne nous sommes pas posé la question, parce que l’intelligence avec laquelle ce chanteur si musicien dose son instrument, contrôle son émission et porte le sens des mots nous comble déjà, sans parler de ses prouesses dans les aigus extrêmes et de sa performance au dernier acte, où il parvient à rendre sympathique le personnage blessé, dont la détresse nous touche.
Son frère, le valeureux et malheureux Julien, échoit à un baryton, et dans l’enregistrement de Cracovie Florian Sempey faisait merveille. Sans démériter, César San Martin n’est pas francophone et cela s’entend parfois, même si cela ne brouille que rarement l’écoute. Cette restriction faite, il met la conviction nécessaire à faire croire à ce personnage responsable et clairvoyant, et communique une émotion très juste dans la scène du cimetière.
La belle pour laquelle ils s’opposent est une jeune fille craintive dont le refus de s’enfuir quand Julien le lui propose – ce serait déshonorant – sera la cause de leur malheur. Par suite, devant les menaces de celui qui devrait la protéger, elle entrera en résistance et sa détermination ne fléchira pas. On aurait aimé sentir cette évolution – fragile d’abord, plus déterminée ensuite – plus nettement dans la voix de Claudia Pavone, à l’extension conforme aux requis mais dont l’émission des notes hautes n’est pas toujours exempte d’un soupçon de dureté. Ses vocalises et ses sauts d’octave auront un grand succès et son français est très correct.
L’autre méchant, le Grand Inquisiteur, le complice de Pierre, le vrai salaud, au fond, puisqu’au lieu de la protéger il sacrifie sa pupille à son ambition, revient à une basse, préfigurant le personnage du Don Carlos verdien. On peut grâce à Nathanaël Tavernier se délecter de la clarté de la diction et de la profondeur de la voix, aux inflexions cauteleuses ou brutales quand il le faut.
Paolo est le marin chez qui Laura doit se cacher jusqu’au moment où il lui donnera le signal de rejoindre Julien en chantant. C’est un élève de l’Académie qui s’exhibe dans ce rôle et c’est une heureuse découverte. Ce jeune Chinois, Anle Gou, a une voix de ténor très claire, très bien projetée, et une prononciation du français très correcte, ce qui fait de sa chanson un moment de charme au milieu du climat angoissant de l’attente. Il saura trouver les accents énergiques nécessaires au troisième acte pour exhorter Julien à l’action. Sans nul doute, à suivre.
Quatre autres élèves de l’Académie interviennent. Des deux partenaires du jeu qui finira en querelle, le ténor Paolo Mascari est appliqué mais l’articulation manque de fermeté, si on la compare à celle du baryton Carlos Reynoso dont le français sonne plus fluide. On ne peut en dire autant de l’intervention du ténor Davide Zaccherini, en soldat. Celle du baryton Willingerd Giménez, en héraut guerrier, est en place et correctement émise.
Des brassées de lauriers pour les artistes du Chœur de la Philharmonie-Szymanowski de Cracovie, dont l’engagement supplée le nombre et qui donnent l’illusion de masses. Homogénéité, cohésion, justesse, assez bonne clarté de la diction, ils interviennent sauf erreur à douze reprises, martiaux, religieux, festifs, c’est dire la part qui leur revient dans la réussite de cette résurrection !
Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique- Szymanowski ne sont pas en reste, soit qu’ils se distinguent en solistes comme le piccolo ou la harpe, soit qu’ils abasourdissent aux percussions par leur énergie, soit parce qu’ils font vibrer leurs cordes avec la violence ou la subtilité de l’instant, soit par leur éclat ou leur puissance de suggestion pour les cuivres et les vents. L’exécution intégrale du ballet de l’acte II les a heureusement mis à l’honneur ! Quant à l’orgue enregistré, le dosage sonore était parfait !
C’est debout que bon nombre des mélomanes venus assister au concert ont longuement salué les interprètes de ce maelström sonore, dans une jubilation qui faisait plaisir à voir. Donné sans coupure, avec deux entractes placés après le premier acte et après le deuxième, il a été l’objet d’une captation qui devrait déboucher sur la commercialisation de l’enregistrement de cette première intégrale.