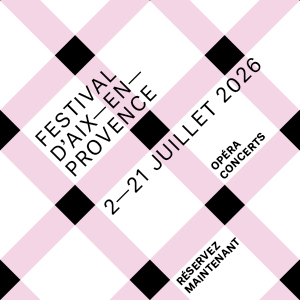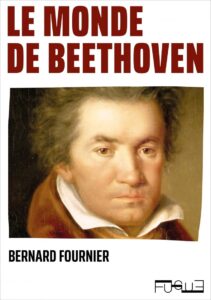Après Lille, Caen et Luxembourg, Marseille découvre ce Falstaff transposé au milieu du XXe siècle – à en juger par les costumes – par Denis Podalydès dans une structure hospitalière entre asile et sanatorium, ainsi qu’il le révèle dans la longue note d’intention. Comment lui est venue cette idée ? Il ne l’explique pas, alors faisons une hypothèse : c’est le premier personnage qui la lui a inspirée, puisque Cajus est présenté comme « docteur ». Et le reste en découle : Ford, qui lui a promis sa fille, sera le chef du service dont Cajus est le pharmacien. Dans la même logique le vin réclamé par Falstaff est fourni en perfusion, celui-ci sera « shooté » avant l’opération destinée à le débarrasser de son obésité morbide et il aura ainsi des visions effrayantes avant de retrouver sa lucidité, délesté de ses kilos.
Reste la question : pourquoi Falstaff se trouve-t-il dans cette institution ? Y a-t-il été convoqué ou y est-il entré de son plein gré pour s’y soumettre à un traitement chirurgical ? C’est ce que suggère le spectacle, où on assistera à son éventration, les kilos surabondants prenant la forme d’un énorme ballon blanc, et Falstaff délivré de leur poids se mettra à danser tel un ludion. C’est spectaculaire, mais est-ce l’esprit de l’œuvre ? Jusqu’à la fin, Falstaff persévère dans son être, et si finalement il change, c’est contraint et forcé par les évidences qu’il ne voyait pas jusqu’alors. Ce que Falstaff perd, à la fin du Falstaff que Verdi et Boito ont signé, ce ne sont pas des kilos, mais ce qui faisait de lui une « enflure ». Pour que crève la bouffissure d’un narcissisme qui le rendait aveugle aux autres et donc incapable de comprendre comment ils le perçoivent, il faudra, outre les sévices du rendez-vous nocturne, qu’il découvre que ceux qu’il croyait dominer se moquent de lui. Cette mise en scène a-t-elle mis la leçon en évidence ? Nous n’en sommes pas convaincu.
De l’option de Denis Podalydès découle le décor unique et dépouillé conçu par Éric Ruf, que des accessoires – lits d’hôpital, tables, armoires-vestiaires, draps sur un étendoir – transforment en espaces divers, chambrée ou buanderie. Faut-il préciser que le pittoresque et la fantaisie des lieux prescrits – auberge de la Jarretière, intérieur bourgeois de Ford, forêt hantée – font défaut ? Certes, le metteur en scène explique que ces noms correspondent à divers endroits de l’établissement, qu’ils seraient en somme une nomenclature propre aux résidents, mais visuellement c’est bien triste. Malgré le soin visible et constant apporté aux éclairages, le spectacle manque de couleurs, et ce ne sont pas les uniformes des commères – ici devenues infirmières – qui suffiront à l’égayer.
Christian Lacroix, quand il les habille en bourgeoises, semble s’être amusé à pasticher les robes fleuries de Patou ou la « Jolie Madame » de Balmain au début des années 1950, sans leur donner de véritable personnalité. Les hommes n’en ont pas davantage : quand ils ne portent pas la blouse de leur fonction, Ford et Cajus sont en costume trois pièces, Bardolfo et Pistola sont vêtus des pyjamas fournis par l’administration, comme aussi Falstaff avant qu’il ne revête la tenue de campagne du séducteur, le smoking, pour finir dans la blouse du patient avant la nudité de l’éventration fantasmée. Seul Fenton échappe à cette uniformité, sans que sa tenue dénote une excentricité particulière.
Heureusement, si la proposition ne nous a pas conquis, l’exécution musicale et vocale nous a comblé ! Dépassant encore sa lecture déjà si attentive à Parme le mois dernier, Michele Spotti nous éblouit par une précision constante qui détaille les moindres ciselures de cette partition-bijou. Verdi l’a sertie de joyaux mélodiques et harmoniques à profusion, de maintes autocitations d’une espiègle brièveté. La direction en épouse les contours capricants, laissant chanter le lyrisme et faisant cingler l’ironie, suivie amoureusement par un orchestre d’où jaillissent, croassent, susurrent, étincellent, les atours de l’ultime parade verdienne. Toute la science, tout l’humour, toute la tendresse du compositeur dans ce feu d’artifice, sont magistralement communiqués dans cette interprétation.
Ce bonheur musical sans mélange, car l’intensité sonore de la fosse ne nuit jamais au plateau, on le savoure grâce à une distribution sans faille. Certes, le Falstaff de Giulio Mastrototaro n’est pas le monstre que l’on peut souhaiter, ni scéniquement, malgré la prothèse de caoutchouc, ni vocalement car le timbre est clair. Mais le personnage est sans nul doute conforme aux souhaits du metteur en scène, qui veut un Falstaff sympathique ; la projection est bonne, aussi vigoureuse que nécessaire, l’extension suffisante, et la minutie de la mise au point du rôle se devine dans l’exacte caractérisation de chaque intervention, où chaque syllabe est ciselée. Du beau travail !
Malgré leurs tenues uniformes, Carl Ghazarossian et Frédéric Caton, respectivement Bardolfo et Pistola, tirent aisément leur épingle du jeu, tant vocalement que scéniquement grâce à leur solide métier. Privé du ridicule qui caractérise sa scène du premier acte, le Cajus de Raphaël Brémard campe le cadre dévoyé sous l’uniforme du bourgeois respectable d’une voix bien sonore. En chef de service cocaïnomane dépendant de son fournisseur et mari craignant de porter les cornes, Florian Sempey donne à entendre toute l’humanité de Ford dans le monologue où celui-ci exhale son désarroi, un air extraordinaire où Figaro croise Iago que le baryton magnifie.
Etranger à l’action sinon parce qu’il permettra à Alice de damer le pion à son mari l’amoureux Fenton est dévolu à Alberto Robert, un jeune ténor mexicain auquel sans être prophète on peut prédire un bel avenir, car il use de sa voix bien timbrée avec une musicalité exquise, et l’expressivité de son visage témoigne d’une aptitude évidente à l’interprétation théâtrale. Sa Nanetta n’est pas en reste : Hélène Carpentier lui confère un charme juvénile, une grâce scénique et une fraîcheur vocale qui rendent le personnage délicieux, et ensemble ces jeunes amoureux forment un couple vocal et scénique des plus séduisants. Elle ravit dans l’air de la reine des fées, d’une souplesse aérienne, et démontre depuis le début toute l’aisance scénique souhaitable.
Remarquable, voire sensationnelle la Meg d’ Héloïse Mas, qui donne au personnage féminin le moins étoffé une présence vocale et scénique délectable. Egale à elle-même bien que le personnage soit beaucoup plus sage qu’à Parme Teresa Iervolino confirme qu’elle est une grande Quickly sans assombrir ou forcer sa voix. Alice, enfin, la maîtresse femme révoltée avant la lettre contre le machisme, trouve dans la virtuosité de Salomé Jicia une interprète à même de faire briller le rôle de tous les ornements prévus, et désormais d’une désinvolture scénique complète, jusqu’à braver l’équilibre dans sa scène avec Falstaff. Ces trois commères confirmées et l’aspirante Nanette démontrent par ailleurs leur souplesse physique en se livrant à des évolutions dansantes volubiles comme leurs propos. Leurs ensembles sont une successions de délices, où la fusion des timbres et la complexité des alliances enchantent. On a admiré évidemment la complexité des enchevêtrements vocaux masculins et féminins du premier acte. On savoure celui de la fugue finale malgré un léger flottement, peut-être dû à la complexité du mouvement scénique auquel les artistes du chœur ont participé pleinement. Aux saluts le succès est tel qu’il semble déconcerter un temps le directeur de l’Opéra. Aimez-vous la musique de Falstaff ? Encore trois représentations !