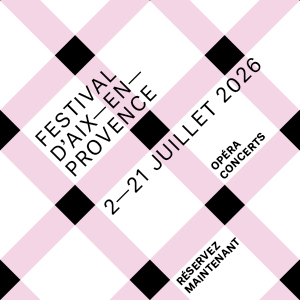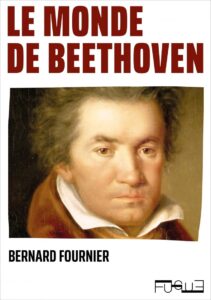Fort de ses récents succès, même relatifs comme à Paris avec son Marino Falliero créé en mars 1835, Donizetti quitte la capitale française peu après, alors qu’il vient de recevoir une commande du Teatro San Carlo de Naples, pour une création à l’automne suivant. C’est là qu’il fait la connaissance de Salvatore Cammarano, jeune dramaturge qui se réoriente dans l’écriture de livrets d’opéras et qui deviendra vite LE librettiste du San Carlo. C’est avec lui que Donizetti va devoir trouver le sujet de l’opéra à venir.

Les deux hommes décident de mettre en musique un roman de Walter Scott, qui est alors très en vogue, et avec lui les idées romantiques véhiculées par les brumes et les ruines des châteaux d’Ecosse. C’est La fiancée de Lammermoor, parue moins de 20 ans plus tôt, qui fait l’objet de cette adaptation. Les deux hommes n’ont pas choisi la facilité : le roman est des plus sombres, garni de personnages secondaires et avec un fond historique assez complexe. or, le San Carlo veut du concis et du précis, qui donne surtout lieu à de beaux airs pour magnifier ses interprètes fétiches et son choeur. Cammarano va donc commencer comme il le fera souvent par faire un grand ménage parmi les personnages pour n’en garder qu’une grosse demi-douzaine, puis il escamote l’intrigue politique de la guerre des clans écossais et concentre classiquement l’action sur un laps de temps réduit alors que le roman est une véritable fresque. Malgré cela, le librettiste va devoir réviser son travail à plusieurs reprises sous la pression de Donizetti, qui multiplie les exigences : il faut des dialogues et des récitatifs courts, des ensembles nombreux, des contrastes marqués dans la psychologie et l’attitude des personnages. Donizetti corrige lui-même certains vers pour les simplifier, y compris en les tronquant si cela sert la musique. Il demande à Cammarano de lui fournir des descriptions hallucinatoires bizarres pour justifier l’emploi de l’harmonica de verre et de ce son si particulier dans la scène de la folie de Lucia.

© Luciano Romano
Avec tout cela, Donizetti réalise quand même sa partition en quelques semaines, mais il craint le pire car le fameux impresario Barbaja, directeur du San Carlo, vient de quitter ce dernier, laissant le théâtre au bord du gouffre (c’est un faux départ, il reviendra l’année suivante). « Nos théâtres vont de mal en pis (…) les ouvrages chutent, le public siffle, la fréquentation est médiocre (…) La crise est proche, le public a une indigestion, la Société théâtrale est sur le point d’être dissoute, le Vésuve fume et l’éruption est proche » écrit Donizetti, cité par Philippe Tanh dans son excellente biographie. Dans ce contexte, les répétitions, au cœur de l’été n’échappent pas aux intrigues coutumières et elles se tendent même brutalement avec l’annonce de la mort brutale de Bellini le 23 septembre. Donizetti est assez perfidemment soupçonné soit d’y être soit pour quelque chose, soit de chercher à en profiter pour s’imposer comme le plus grand compositeur lyrique italien du moment. Les chanteurs choisis par le San Carlo se plaignent par ailleurs de la difficulté de la partition, Antoine Duprez en tête. Mais le compositeur ne cède pas, même s’il effectue quelques ajustements pour les aider, notamment Fanny Tacchinardi-Persiani pour le rôle-titre, dont l’agilité et l’intelligence dramatique sont essentielles en vue d’assurer le succès.

La création, il y a tout juste 190 ans est un triomphe, l’un des plus grands de Donizetti, devant un public presque recueilli et qui éclate soudain en acclamations à plusieurs reprises. « Lucia di Lammermoor est allée bien. Et permets moi aussi, en ami, qu’honteusement je te dise la vérité : elle a plu, et même bien plu, si j’en crois les applaudissements et les compliments que j’ai reçus » écrit le compositeur à son éditeur Ricordi.
L’opéra rencontre le même succès un peu partout en Europe et arrive à Paris dans une version en français et avec plusieurs modifications du livret notamment en 1839. Là encore, le triomphe est au rendez-vous. Mais parmi les spectateurs, un jeune compositeur et critique ne manque rien du spectacle. Hector Berlioz écrit alors pour la Gazette musicale de Paris. Il publie un long article le 9 août 1839. Au sujet du compositeur, il dit ceci : « La partition de M. Donizetti est aujourd’hui trop connue, pour nous croire obligés d’en faire une analyse détaillée. Disons seulement qu’elle contient de fort beaux morceaux, que l’expression dramatique y est généralement beaucoup plus respectée que dans le grand nombre des opéras sérieux des Italiens modernes, et que ses défauts sont ceux que les Français et les Allemands reprochent à la plupart des productions des successeurs de Rossini. Ce sont : peu de distinction mélodique ; des points d’arrêts réguliers à la fin de chaque phrase, qui interrompent le mouvement musical d’une façon constamment identique, pour laisser au chanteur toute liberté de pousser à plein gosier une cadence finale qui est aussi toujours la même ; de grands bruits d’orchestre à propos de rien ; une répercussion excessivement prolongée des accords successifs de dominante et de tonique ou de celui de tonique tout seul dans les péroraisons ; des appogiatures mélodiques de violon redoublées au grave et à deux octaves de distance par une voix de basse ; des dessins sautillans (sic) de petites flûtes dans une scène triste ou imposante ; en un mot les défauts qui doivent trop souvent accompagner la précipitation du travail, et l’emploi des procédés pour ainsi dire mécaniques qui l’encouragent. Ce qui me paraît beau, c’est le grand quatuor qui suit l’arrivée d’Edgard ; l’effet général en est très heureux, éminemment dramatique ; les voix y sont disposées habilement, et l’explosion finale, retardée quelque temps pendant une tenue de la sixte à l’aigu sous laquelle passent différentes harmonies, produit une impression puissante. Le final a du mouvement, de la chaleur; mais je trouve qu’il finit précisément au moment où l’intérêt musical commence à s’élever et le style à se colorer d’accens (sic) inattendus. La scène de folie est habilement traitée, bien que ce ne soit probablement pas là tout ce qu’on aurait pu faire d’une situation pareille. Mais je préfère de beaucoup à tout le reste la dernière scène ; celle où Edgard désespéré, attendant Ashton pour le combattre auprès des tombeaux de sa famille, apprend la folie et la mort de Lucie. Les deux airs dont elle se compose sont d’une tristesse déchirante, sans exagération, sans emphase, bien mélodiques, bien vrais de sentiment et d’accentuation ; la dernière phrase chromatique surtout, où la voix du fiancé mourant s’élève avec effort sur cette belle expression italienne qu’on ne peut rendre en français : O bell’alma innamorata ! m’a toujours paru sublime. Pourquoi faut-il qu’au milieu de cette poétique douleur, le chœur intervienne pour désanchanter l’auditeur par le plus plat de tous les prosaïsmes ! Cette phrase des ténors consolant Edgard est évidemment tirée du répertoire favori des barbiers italiens ; elle me rappelle mon coiffeur de la place d’Espagne, et sa vieille guitare, et le garçon du café Greco, et le portier de notre Académie. Il faut, en vérité, qu’un compositeur soit abandonné de son ange gardien pour tacher ainsi sa partition dans le plus bel endroit ».
On sait que notre Hector national aura encore bien souvent la plume très acérée. Mais Lucia, en italien ou en français, est bien un chef d’oeuvre qui n’a jamais quitté le répertoire. Puisqu’il faut bien choisir parmi les trésors dont il regorge, en voici le fameux sextuor qui clôt le second acte, juste avant que la folie ne vienne dévaster l’infortunée Lucia, ici par une distribution proche de l’idéal sous la baguette fiévreuse de Thomas Schippers.