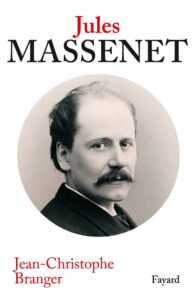A 93 ans, Gabriel Bacquier est aujourd’hui l’un des doyens du chant français, dont il fut l’un des brillants représentants au cours de sa carrière internationale. Il revient sur les grandes dates de son parcours lyrique.
Comment se fait-il qu’un méridional comme vous ait fait ses débuts à Valenciennes ?
Je suis né à Béziers mais j’ai fait l’essentiel de mes études de chant à Paris, au conservatoire. En ce temps-là, on organisait rue Taitbout des auditions pour les directeurs de province, et c’est là que m’a découvert Lucien Brouet qui, après avoir été à la tête du théâtre de Bogota, était alors directeur à Anzin, près de Valenciennes. Pendant l’audition, il m’a demandé de chanter l’air de Figaro du Barbier : quand je me produisais dans les cabarets parisiens pour gagner ma vie, j’étais bien obligé de l’interpréter pour faire plaisir au public, mais ces « Tu vas voler » qu’on répète en conclusion (dans la version française) m’emmerdaient beaucoup. Enfin, il m’a engagé et à Anzin j’ai fait quelques opérettes, un ou deux Offenbach, mais pas tant que ça. Ce qu’il m’a surtout fait chanter, c’est Carmen, Tosca, Rigoletto, des opéras populaires. Vous vous rendez compte ? J’étais très jeune, mais il m’a confié tous ces grands rôles. Ça se passait l’été, et on donnait parfois des représentations en plein air, au Jardin de la Rhonelle, à Valenciennes, et même dans des fermes aménagées en théâtre.
Quel souvenir gardez-vous de cette époque ?
Lucien Brouet est l’homme qui m’a fait débuter dans la carrière, c’est un monsieur dont je m’étais vraiment fait un ami. Des années plus tard, alors qu’étaient réunis quelques artistes et des directeurs de province, certains me disaient « Eh, Gabriel, tu te rappelles, quand tu as chanté ceci ou cela chez moi ? » Je leur ai répondu : « Oui, je m’en souviens bien, mais il y a parmi vous quelqu’un qui m’a fait chanter bien davantage et qui ne dit rien ! » C’était Lucien Brouet. Tout ça m’a laissé des souvenirs touchants, et je suis très ému lorsque j’en parle. Des souvenirs amusants, aussi : je me rappelle qu’un jour, dans un Rigoletto donné en plein air, au moment du duo avec Sparafucile, la basse n’est jamais entrée en scène, alors je me suis mis à chanter son rôle en plus du mien. Je faisais les questions et les réponses, mais là où j’ai été bien embêté, c’est à la fin, quand j’ai dû dire « Va ! Va ! Va ! Va ! » alors qu’il n’y avait personne à côté de moi…
Cela dit, après Anzin, vous êtes allé plus au nord encore, puisqu’on vous a applaudi à Bruxelles.
J’étais encore étudiant au conservatoire, et comme j’étais déjà père de famille, il fallait que je la fasse manger, ma famille. Voilà pourquoi je poussais la chansonnette dans les cinémas : à cette époque-là, les séances commençaient toujours par un petit film, suivi des actualités, avec un entracte avant le grand film. Il m’est arrivé de passer au Paramount, au Gaumont de la place Clichy, mais aussi dans les petits boui-bouis des boulevards, ou dans cette salle où on faisait du catch, l’Elysée Montmartre. Je chantais aussi « Chez ma Cousine », place du Tertre, où un ami m’avait présenté pour que je puisse gagner ma vie. Mais à force d’écrire aux théâtres pour qu’ils fassent appel à moi, j’ai été engagé à la Monnaie, par le nouveau directeur, Joseph Rogatchevsky, qu’on appelait familièrement « Roga ».
Quel répertoire y avez-vous abordé ?
En trois ans, j’ai chanté quantité de choses à Bruxelles, tellement de choses que je ne m’en souviens plus très bien. Il y en avait des intéressantes et des moins intéressantes. Beaucoup d’opérettes, notamment viennoises, comme Valses de Vienne, ou des créations comme le ballet Les Bals de Paris, en 1954, où je tenais le rôle d’un chanteur de rue (j’avais un singe sur l’épaule, que la reine Elisabeth est venue caresser après la représentation !). On donnait alors des choses qu’on ne joue plus aujourd’hui : Si j’étais roi, d’Adolphe Adam, Miss Helyett, d’Audran, Hans le joueur de flûte, de Louis Ganne…
Après ces trois années, quel événement a déclenché votre retour à Paris ?
Au printemps 1955, je chantais Les Pêcheurs de perles. Le baryton belge Julien Haas prétendait que je ne pourrais jamais rien chanter de plus lourd… Martha Angelici était venue de Paris pour interpréter Leïla. A la fin de la représentation, elle me dit : « Gabriel, vous seriez libre pour venir à Paris ? » Je réponds que oui, et je demande pour quel rôle. « Pour faire partie de la troupe ! ». J’étais sur le point de signer un nouveau contrat de trois ans à Bruxelles, alors j’en touche un mot à Roga qui me dit : « A vous de voir. Faites-moi au moins le spectacle d’ouverture de saison ». Il s’agissait de Monsieur Beaucaire, de Messager. J’ai donc fait le gala de la presse, en décembre 1956, puis je suis parti pour Paris.
Où vous avez donc été engagé pour plusieurs années…
A Paris, je chante en audition l’air de Zurga, qui me portait bonheur. On me dit : « Vous n’avez pas le Barbier ? » J’ai dit non ! Après l’audition, Martha me dit : « C’est très bien, je pense que ça va marcher, mais nous sommes obligés d’attendre l’arrivée de M. Hirsch ». Son mari, François Agostini, était le directeur de l’Opéra-Comique, mais Georges Hirsch était le directeur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux. Et d’après lui, les membres de la troupe de l’Opéra-Comique n’étaient pas capables de chanter à l’opéra. Il donne son assentiment, et à Bruxelles, Roga me dit : « Mon pauvre, allez-y ! » Pour mon premier spectacle à Favart, je remplace Roger Bourdin en Sharpless dans Madame Butterfly, avec Geori Boué. Après ça, j’ai chanté dans La Bohème, j’ai fait beaucoup de créations, des ouvrages courts qu’on donnait en début de soirée.
Mais vous n’êtes pas resté « prisonnier » de l’Opéra-Comique ?
Un jour, à Garnier, ils se sont retrouvés à court de Rigoletto ! Aucun des barytons de la troupe de l’Opéra ne pouvait chanter le rôle : l’un était malade, Michel Dens n’était pas disponible, etc. Alors José Beckmans, directeur de la scène à l’Opéra, qui m’avait connu bien des années avant, du temps où je chantais dans sa troupe [La Compagnie Lyrique française, qui se produisait en région parisienne et en Afrique du nord] m’a dit : « Tu viens de me demander une permission pour aller chanter Rigoletto avec Mado Robin, donc tu connais le rôle ? – Oui. – Oui ? alors tu le chantes ce soir ! – Mais comment je fais, sans répétition ? – Oh, tu viens à 4 heures, tu vois Louis Fourestier, le chef d’orchestre, et vous vous mettez d’accord. Quand tu as fini, tu vas essayer tes costumes, et à 8h tu es en scène ». Voilà comment ça s’est passé.
Vous êtes donc passé de Favart à Garnier ?
Ça a tellement bien marché, qu’après ils me foutaient des Rigoletto en pagaille, mais moi je continuais à chanter le répertoire léger à l’Opéra-Comique, donc j’étais emmerdé. Il fallait que je change d’embouchure sans arrêt, pour passer d’un style à l’autre. Un jour j’ai dit : « Je ne peux pas continuer. Ou je suis dans l’un, ou je suis dans l’autre ». Alors ils m’ont laissé à Favart. Puis en mars 1959, ils ont voulu fêter à Garnier le centenaire de Faust, avec une distribution différente à chaque acte, afin de faire travailler toute la troupe. Le Faust, la Marguerite et le Méphiso changeaient à chaque acte, mais il n’y avait qu’un seul Valentin. « Eh, Bacquier, viens chanter Valentin à l’Opéra », qu’ils m’ont dit. A la fin, j’ai protesté : « Je ne pourrais pas faire partie de la troupe de l’Opéra ? Parce que j’en ai marre ! ça fait je ne sais combien de fois que je chante ici ». On m’a répondu : « Qu’à cela ne tienne ! » Et voilà comment j’y suis entré, à l’Opéra. Ça avait beau être la Réunion des théâtres lyriques nationaux, il y avait quand même une sorte de ségrégation…
L’année suivante, des milliers de spectateurs ont pu vous voir à la télévision dans Don Giovanni : qu’est-ce que cela a changé pour vous ?
C’est Gabriel Dussurget m’a donné cette opportunité. Un jour, il est venu m’écouter chanter Don Juan à l’Opéra, où il était conseiller artistique. A l’époque, on chantait encore l’œuvre en français. Il me dit : « Ça vous intéresserait de le faire à Aix, en langue originale ? – Evidemment, mais comment fais-je ? – Ne vous inquiétez pas, mon cher, nous avons Irène Aïtoff, qui va vous faire répéter ». Et pendant trois mois, tous les jours sauf le dimanche, je suis allé chez celle que Dussurget appelait « la veuve Mozart », pour travailler le rôle en italien, surtout les récitatifs, qui sont si importants dans Don Giovanni, même plus importants que les airs que le personnage a à chanter. Je me suis mis au boulot, et quand le grand jour est arrivé, j’avais un peu la trouille. Enfin, j’ai eu ce coup de chance : c’était la première fois qu’un spectacle du festival d’Aix était diffusé en Eurovision. Il fallait que je me tienne à carreau, mais j’ai envoyé ça sans problème, parce que je l’avais rabâché ; je ne dis pas que j’étais vraiment le personnage, mais c’était en place. Et comme c’était diffusé partout en Europe, ils m’ont entendu à Vienne, à Londres, et j’ai tout de suite été engagé un peu partout grâce à ça, pour chanter au cours de la saison suivante.
Donc c’est la télévision qui a lancé votre une carrière internationale ?
A Vienne, j’ai été très étonné, quand ils m’ont proposé de chanter la même semaine Les Noces de Figaro, Tosca, Don Giovanni et Carmen ! Avec eux, là-bas, ce qui faisait partie du répertoire ne se répétait pas. Enfin, on rencontrait une fois avec le chef et les collègues, mais on n’avait aucune répétition d’orchestre, aucune générale ! Quant à la mise en scène… Ils plaçaent à chaque portant, des deux côtés de la scène, un chef de chant en blouse blanche, et quand c’était à toi de chanter, le type te foutait un coup de pied au cul, en disant : « Entre ! » Ce qui m’a encore plus surpris, c’est que chaque fois que je chantais à Vienne, j’avais le sentiment d’être toujours en forme, vraiment en pleine forme. Pourquoi ? Parce que Karajan, qui était le directeur musical, exigeait pour certains ouvrages qu’on remette le diapason à 435. Donc les aigus venaient tout seul ! Au lieu de devoir tirer, je n’avais qu’à laisser aller. C’était la surprise viennoise…
Malgré ces engagements en terres germanophones, vous n’avez jamais chanté en allemand. Vous auriez pourtant pu aborder Wagner à Paris, du temps où on le chantait en français.
Je l’ai fait ! j’ai chanté Wolfram, dans Tannhäuser. Un jour où on avait pu l’entendre à la radio, j’ai reçu une lettre de félicitations d’André Pernet. C’est le seul Wagner que j’aie chanté. Pourquoi ? Je me suis toujours posé la question, mais c’est sans doute surtout à cause du problème de la langue. Je n’étais pas du tout doué pour chanter en allemand. Des amis me disaient : « Tu es un fainéant, tu ne veux pas te donner la peine ». Il y avait un peu de ça. A présent je regrette de n’avoir pas chanté certains ouvrages de Wagner, parce que ce que je n’aimais pas autrefois, je l’aime aujourd’hui. Qu’est-ce que vous voulez y faire, c’est comme ça !
Y a-t-il des rôles allemands qui vous attiraient malgré tout, chez Wagner ou Richard Strauss ?
Je n’ai peut-être jamais eu une voix assez corsée. Et je me connais suffisamment pour pouvoir dire la vérité, aujourd’hui que je ne chante plus : je n’étais pas doué vocalement. Au conservatoire, puis à l’Opéra-Comique, il y avait autour de moi des gens qui avaient un galoubet extraordinaire, mais moi je n’atteignais pas facilement les extrêmes, sinon je ne me serais jamais autant embêté dans Le Barbier de Séville. J’avais un grave modéré, et j’avais un aigu un peu pincé, un peu trop canalisé. Je ne sais pas si ça ne faisait pas beau, pas intéressant, ou pas attirant. Après, je me suis mis à trouver ma vraie embouchure, mais je ne l’ai trouvée qu’à New York, quand j’ai eu à lutter avec les grands.
Quels grands, par exemple ?
Les premiers qu’on m’a foutus dans les pattes, quand je suis arrivé au Met, ç’a été quand même Birgit Nilsson et Franco Corelli, dans une nouvelle production de Tosca. Alors, Nilsson, pas besoin de vous le dire qu’elle n’était pas le personnage, mais c’est la seule que j’ai entendu chanter, à plat ventre, sa prière piano du début à la fin, comme pour elle-même, vraiment, tout en intériorité. Chapeau ! Pendant les répétitions, elle arrivait avec des poireaux dans un sac, elle venait de faire son marché, et je pensais être devenu copain avec elle. Un jour, je lui ai fait une blague, je lui ai dit « Get up, get up » ! comme si c’était un ordre émanant du metteur en scène. Mais les Américains ont été scandalisés : On ne dit pas « Get up » à Madame Nilsson ! Tous les journaux en ont parlé : dans Opera News, on a pu lire « Il a dit ‘Get up’ à Madame Nilsson ! ». Je me suis fait engueuler, mais la principale intéressée ne m’en a pas voulu. Je lui ai demandé : « Ça te dérange ? » Elle m’a répondu : « Je m’en fous ». Enfin, elle ne m’a pas dit « Je m’en fous » parce qu’on se parlait en italien, elle m’a dit : « Non importa ».
Vous êtes devenu une personnalité médiatique.
Pour l’ORTF, j’ai animé pendant un an une émission pour les jeunes. On enregistrait au Théâtre de Paris tous les samedis. L’émission était présentée par Dominique Plessis, la femme d’Emmanuel Bondeville. Il y avait une partie théâtre, dont s’occupait Jacques Charon, et moi j’étais chargé du chant. Et un jour, en 1971, la télévision m’a proposé d’être « L’Invité du Dimanche ». J’avais demandé à dialoguer avec Georges de Caunes, qui avait fait la présentation du Don Giovanni en direct d’Aix-en-Provence. Je me rappelle, je chantais à Lyon et, comme il avait neigé, l’avion que je devais prendre n’a pas pu décoller, j’ai dû aller en chercher un autre à Grenoble, qui a attendu une heure et demie sur le tarmac rien que pour moi ! Quand je suis entré dans la Caravelle, j’ai bien vu que tous les hommes d’affaires qui montaient sur Paris faisaient la gueule. Et à l’arrivée, ils se sont bien demandé qui je pouvais être, en voyant les motards qui m’ont escorté jusqu’à la rue Cognacq-Jay pour que je sois à l’heure à l’émission.
En 1973, comment avez-vous vécu l’arrivée de Rolf Liebermann à la tête de l’Opéra de Paris ?
J’ai un témoignage terrible. Je me rappelle avoir participé à une réunion où il fut question de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, de l’Opéra-Comique, de Monsieur Liebermann, et ainsi de suite. Marcel Landowski a dit : « Comment ? Jamais de la vie je ne supprimerai la troupe de l’Opéra-Comique, ni celle de l’Opéra. Comptez là-dessus ». Il a dit ça devant tout le monde. Et bien sûr, la première des choses qu’il a faites a été de fermer les deux maisons.
Malgré tout, vous êtes l’un des chanteurs français à avoir pu continuer à chanter à Garnier.
Oui, comme Robert Massard ou Alain Vanzo. Liebermann a gardé ceux qui avaient déjà une certaine carrière, un certain nom. Il a quand même dit : « Qu’est-ce que je vais faire des chanteurs de l’Opéra Comique ? » Il a fait passer une audition à Albert Lance, qui l’a envoyé chier, d’ailleurs ! Je crois qu’il a aussi demandé à Andrée Esposito de passer une audition. Il était comme ça. Moi j’avais cette chance d’avoir connu à New York Joan Ingpen, responsable des castings, qui a été appelée à Paris par Liebermann. Elle a dit : « Ah, Bacquier est là ? Alors on le fait chanter ». Par ailleurs, j’avais été pendant trois ans l’amant d’une chanteuse auprès de qui Liebermann m’a succédé, grâce à quoi j’ai pu faire ce que je voulais à l’Opéra, parce que j’appelais Liebermann « Beau-frère » ! Je me garais dans la cour de la direction avec ma voiture, j’avais les clefs de ma loge sur moi, je pouvais entrer à n’importe quelle heure…
Vous avez notamment participé à la fameuse production des Noces de Figaro.
Pendant les répétitions, la collaboration avec Giorgio Strehler a été merveilleuse, et il m’a écrit cette dédicace, moitié en italien, moitié en français : « Je suis ravi d’avoir rencontré un ami qui a la même conception que moi du théâtre » ! C’est lui qui m’a fait faire des choses formidables dans Les Noces, des choses auxquelles je ne m’attendais pas, d’ailleurs : au deuxième acte, cette entrée dans la chambre de la comtesse avec le fusil, en revenant de la chasse, comme un type jaloux. On n’avait jamais vu ça. Il montrait aussi le comte comme un peu ridicule au premier acte, quand il découvre Chérubin dans le fauteuil. Le spectacle avait été très bien monté, mais après, je ne sais pas ce que c’est devenu, avec toutes les reprises.
Y a-t-il des personnages que vous n’avez pas aimé interpréter ?
Uniquement pour des raisons musicales. A part l’air du Barbier qui m’emmerdait, tout le reste ça allait. Iago est un rôle que j’ai beaucoup chanté, mais il y avait l’aigu du « Bevi, be-vi » que j’avais du mal à sortir, alors je le faisais passer en douce, un peu en falsetto. Malin ! Après, il y a des personnages que j’aimais plus ou moins. Vous connaissez Le Chalet, d’Adolphe Adam ? Ah, j’en ai chanté, des conneries comme ça. Le chasseur de chamois, un rôle parlé, dans Manfred de Schumann…
A l’inverse, des rôles que vous auriez aimé chanter mais que l’on en vous a jamais proposés ?
Non. J’aurais aimé créer un Volpone, d’après Jules Romains. Il y a eu un projet : Jacques Charpentier [élève de Messiaen, décédé en juin dernier] avait soi-disant composé cet opéra pour moi, il l’aurait proposé à l’Opéra du temps de Liebermann, mais la partition n’a pas été acceptée.
Vous avez pourtant participé à plusieurs créations d’opéra.
En 1969, à Marseille, j’ai chanté le rôle-titre dans Andrea del Sarto, de Daniel-Lesur. Il avait fallu réécrire toute la partition, enfin, mon rôle, avec Irène Aitoff : elle avait beau avoir été conçue pour moi, ça ne m’allait pas vocalement, et il y avait plein d’acrobaties ! Après, Daniel-Lesur a fait éditer les deux versions, la sienne et la mienne ! A part ça, j’avais demandé à faire un nouveau Cyrano de Bergerac, qu’a composé Paul Danblon avant de devenir directeur de l’Opéra royal de Wallonie, mais le résultat n’était pas très heureux musicalement, indigeste et un peu répétitif. Après la création à Liège et à Bruxelles, en 1980, dans une mise en scène de Philippe Rondest, le neveu de Jacques Charon, j’avais pris la partition et je l’avais apportée à New York, dans l’intention de la présenter à la Columbia. Ils ont accepté de monter l’œuvre, mais à condition de faire des coupures. J’écris ça à Danblon, il trouverait sûrement moyen de couper un peu par-ci par-là, dans le siège d’Arras, ou chez Ragueneau, enfin, c’était à lui de savoir où les faire. Réponse : « Madame Danblon dit non ». Et dire que s’il avait accepté, nous l’aurions chanté à la Maison Blanche, son Cyrano !!! Il y a des choses qui se perdent bêtement. Après ça, j’ai laissé tomber la partition. Il a continué à la faire jouer, mais je me suis retiré de l’opération.
Vous resterez donc associé au personnage de Don Juan !
Et encore, ça dépend des goûts… Quand je suis allé chanter Don Giovanni à Munich, les critiques ont dit : « Trop méridional ». Je leur ai répondu : « Il est d’où, Don Juan ? »
Propos recueillis le 26 juillet 2017