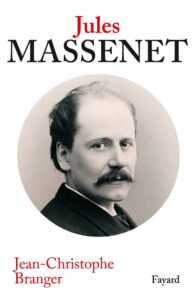Avec sa silhouette juvénile et son frais sourire, Alain Lanceron ferait presque oublier qu’il s’est imposé en trois décennies comme un des producteurs de disques les plus avisés et les plus efficaces du monde musical classique – voire comme le premier d’entre eux. Alors que les bouleversements de la technologie, du marketing, des goûts du public et des métiers de la musique ont fait succomber plus d’un professionnel, Lanceron a survécu, s’est adapté, et a imposé des projets ambitieux au moment où beaucoup croyaient les majors condamnées au cross over sauvage. Patron d’EMI France, il a aussi redéployé le label Virgin pour en faire un fleuron de la production musicale française. Entre les enjeux financiers, les impératifs artistiques, la pression du public, l’attrition du marché, Alain Lanceron évoque pour nous de manière approfondie sa vision du disque aujourd’hui, son parcours et ce en quoi, par-delà les modes, il persiste à croire.
Alain Lanceron, quand êtes-vous arrivé chez EMI ?
Je suis arrivé chez EMI en novembre 1972 comme label manager dans les variétés internationales ; je me suis ensuite occupé des projets spéciaux entre janvier 1974 et novembre 1978, date à laquelle j’ai été nommé directeur du classique. Le microsillon était alors au creux de la vague malgré le DMM (Direct Metal Mastering), un procédé permettant d’inclure sur les microsillons 35 minutes de musique par face. J’ai eu de la chance : quelques années après mon arrivée, ce fut le « boom » du disque compact pour lequel EMI, comme souvent avec les nouvelles technologies, a d’abord fait preuve de beaucoup de prudence.
Vous avez donc vécu la grande vague de l’invention du marketing du disque !
Peut-être pas l’invention, mais son explosion. Il y a eu deux grandes vagues : d’abord l’apparition de la publicité pour le disque à la radio initiée par Paul Lederman qui avait lancé une publicité sur RTL pour une compilation classique. Vu le succès de cet album, DG et EMI ont embrayé, eux avec Les Triomphes de Karajan et nous avec Callas – La Voix du Siècle. Dans les deux cas une grande campagne radio RTL complétait une campagne d’affichage conséquente avec de grands 4 x 3 dans les villes de plus de 100 000 habitants. La deuxième vague a eu lieu lorsque la publicité pour le disque a été rendue possible à la télévision. Là, c’est EMI qui a été pionnier avec une campagne Edith Piaf. Tous les autres majors nous ont ensuite emboité le pas. C’était l’époque où la moindre compilation pouvait grâce à la pub TV atteindre 100 ou 200 000 exemplaires. Notre plus grand succès dans ce domaine a été la compilation Barbara Hendricks – La Voix du ciel vendue à plus de 300 000 exemplaires en un an. Des chiffres qui font aujourd’hui rêver…
La place du marketing n’est-elle pas excessive justement dans votre métier ?
Il y a eu cette période du « tout marketing » favorisée par une convergence de données nouvelles : l’ouverture du marché à la publicité TV, la baisse de la TVA, l’ouverture des Virgin Mégastores et, bien sûr, le boom formidable du disque compact, tout discophile voulant renouveler sa discothèque avec ce nouveau format. Mais la récession s’est vite installée et le marché du disque a perdu plus de 50 % de sa valeur entre 1998 et 2008.
Pour quelle raison ?
La part de marché du disque classique avait augmenté de manière un peu artificielle dans le chiffre d’affaires de l’industrie du disque. En 1986, elle avait atteint son record avec 14,5%. On s’attendait à retomber progressivement à 10%, pourcentage moyen de l’époque pré-compact. Or, on a atteint 8%, puis 7%, puis 6% et, enfin, 4,5% il y a trois ans.
Vous aviez épuisé le filon ?
Certainement. L’explosion du tout marketing avait boosté le marché, mais il l’avait aussi éteint : les séries mid-price ont marqué le pas et, aujourd’hui où les prix font un perpétuel yoyo, la notion de série mid-price ou budget-price est devenue beaucoup plus floue qu’auparavant. Les compilations se sont faites plus rares et le cross-over, dont le phénomène « 3 ténors » avait été l’exemple le plus probant. Depuis trois ans, cependant, la part du classique est remontée autour de 8 %, le marché s’est en quelque sorte assaini et nous avons l’impression de repartir aujourd’hui sur des bases nouvelles.
Pardon, mais pour vous, qu’est-ce que le cross-over ?
Pour répondre par une pirouette, je vous dirais « c’est tout ce qui se vend à plus de cent mille exemplaires ! ». Mais lorsqu’on édite un disque Barbara Hendricks, la Voix du Ciel, est-ce du cross-over ? Non, ce sont des airs classiques que l’on a marketés. A de rares exceptions près, le cross-over reste une notion fondamentalement locale. Prenez Vanessa Mae ou Charlotte Church : en France, ça n’a jamais marché. En revanche, Mozart L’Egyptien chez nous ou Roberto Alagna chante Luis Mariano chez Universal ont réalisé une part prédominante de leurs ventes en France.
Dans ces conditions, comment voyez-vous votre mission aujourd’hui ?
Je pourrais peut-être me comparer à un funambule avec un gouffre artistique à ma gauche et un gouffre marketing à ma droite : attention à garder l’équilibre ! Il faut entretenir une vraie exigence artistique sans se déconnecter de la réalité économique, car nous sommes là pour faire gagner de l’argent à nos actionnaires. Il faut aussi savoir attirer l’attention du public et nourrir son intérêt sans utiliser les ficelles du marketing d’il y a quinze ans. Le marché du disque classique aujourd’hui pèse environ 45 millions d’euros. C’est donc un marché très contracté, en diminution de 10 à 15% par an depuis une décennie maintenant. Je parle ici du marché physique, mais le marché du digital n’a pas encore comblé la différence comme certains experts l’avaient prévu il y a 4 ans. Avec un marché aussi ténu, un succès ou un échec peut faire varier d’une manière significative la part de marché d’un label. Souvenez-vous du succès planétaire de la BO du film Titanic qui avait fait exploser la part de marché de Sony en 1997 ou, plus récemment, le succès de la grosse boite Mozart de Brilliant Classics qui avait propulsé son éditeur Abeille Musique à la 2ème place en France en 2006. Le marché a toujours eu besoin de locomotives.
Pour vous, cela se traduit comment ?
Jamais je ne refuserai de produire un disque dont je pense qu’il pourra se vendre à cent mille exemplaires ou plus. Mais la contrepartie, c’est que je m’autorise des « jokers », hors mode, hors marketing, comme le coffret Cziffra, le coffret Ciccolini, le coffret Nat. C’est ma façon de réagir à un marché où n’importe qui peut se dire éditeur, et où l’image des « majors » est totalement brouillée, ce qui à mon avis est préjudiciable à toute la profession.
Vous arrivez à convaincre vos actionnaires que cette manière de faire est la bonne ?
Oui, parce que nous avons aussi su adapter notre manière de vendre des disques. En 1978, quand je suis arrivé chez EMI, le disque avait la vie longue. On avait du temps pour installer une nouveauté. Je me souviens du concerto de Brahms par Perlman et Giulini, qui n’avait rencontré qu’un succès d’estime à sa sortie. Arrive sept mois plus tard la Tribune des Critiques de disques, qui l’encense : et voilà le disque lancé. Désormais, au bout d’un mois, un disque qui se vend médiocrement est déjà dans les bacs retours des disquaires ! D’où l’importance pour nous des récompenses type Choc de Classica ou Diapason d’Or, qui « boostent » les ventes. D’où aussi l’importance d’un mix marketing calibrant au plus juste la promotion, la date de sortie, la couverture presse… A présent, vendre 5 ou 6000 disques constitue déjà un réel succès : on n’a donc pas le droit de se tromper sur la façon dont on le lance.
Artistiquement, quelles sont les tendances lourdes ?
Assurément, le genre qui a le plus souffert, c’est le symphonique traditionnel. Au concert, il continue d’attirer du monde. Au disque, c’est beaucoup plus difficile. Très peu de chefs d’orchestre vendent sur leur seul nom. Nous avons encore sous signature pour le symphonique deux chefs, Simon Rattle (avec le Philharmonique de Berlin) et Antonio Pappano (avec la Santa Cecilia de Rome), contre une dizaine il y a 20 ans et il en est de même chez nos concurrents. En revanche, le baroque, dont beaucoup avaient prédit qu’il ne s’agissait que d’une mode éphémère, est désormais en vitesse de croisière. La musique sacrée et le lyrique sont les genres les plus prisés aujourd’hui. Malraux ne s’était pas trompé en prédisant : « le XXIè siècle sera religieux ou ne sera pas ». En ce qui concerne le lyrique, il y a cependant une évolution dans les ventes. Il y a 20 ans c’était la mode des intégrales de studio : pour retenir nos artistes, on leur enregistrait de temps en temps un récital. Il se passe exactement le contraire aujourd’hui, avec la santé évidente des récitals sans commune mesure avec les ventes beaucoup plus faibles des intégrales qui se sont beaucoup raréfiées. Il faut dire que compte tenu des espérances de ventes, nous ne pouvons plus, sauf à de rares exceptions près (la Butterfly de Pappano avec Angela Gheorghiu, les Vivaldi de Biondi…), réaliser des enregistrements purement studios. La mode est plutôt au live ou semi-live avec patching, c’est-à-dire des séances supplémentaires d’enregistrement pour corriger les défauts du live (bruits, applaudissements, etc). Mais personnellement je n’aime pas le live. Je considère que ce n’est pas mon métier, c’est une captation radio. En revanche, ce que j’aime dans le studio, c’est le côté laboratoire où les artistes peuvent se mettre en danger, essayer de nouvelles choses, modifier leur interprétation et aussi entrer plus profondément dans la musique. Le premier à l’avoir compris a bien sûr été, chez nous, Walter Legge qui a été jusqu’à créé un orchestre – le Philharmonia de Londres – spécialement pour les besoins du disque !
A titre personnel, comment analysez-vous la situation actuelle ?
Je crois que nous sommes entre deux ères. Le déclin du disque physique est très avancé. En même temps, le marché du digital en France n’explose pas. Nous ne disposons pas de données fiables côté SNEP. Aux Etats-Unis, ces ventes peuvent représenter jusqu’à 50%, car il n’y a plus du tout de disquaires et l’effet iTunes est très fort. En France, le marché physique résiste plutôt bien. Nous tentons de trouver les moyens de faire face, par exemple par des partenariats avec la FNAC, des collaborations avec Radio Classique et parfois les deux réunis : voyez le succès de la collection que nous avons lancée à l’automne dernier.
Ce sont des constats relativement négatifs…
Peut-être, mais c’est parce que j’ai parfaitement conscience que notre métier a beaucoup perdu de son prestige, et que le disque lui-même a perdu de son côté « merveilleux ». Songez à ce que représenta lors de sa sortie La Walkyrie de Solti ! C’était la première intégrale de cette œuvre en stéréo : événement ! Aujourd’hui, on dispose de plus de quarante Ring remarquables (entre les studios, les live et les vidéos) et un des derniers en date, le Keilberth, est un live vieux de 55 ans ! En 1978, chez EMI France, on avait trente-deux pianistes sous contrat, on faisait tout en interne, car nous avions la salle Wagram à disposition. Pour revenir à Solti, le fameux « son Decca » appartient au passé : les ingénieurs du son, les directeurs artistiques ont été externalisés et travaillent indifféremment pour tous les labels. Les pressages sont faits dans les mêmes usines. Nous avons aussi brûlé nos vaisseaux dans le domaine du disque historique : le succès considérable de la collection « Références », qui a duré plus de deux décennies, ne serait plus possible aujourd’hui, car la loi étendant à soixante quinze ans la tombée dans le domaine public ne sera pas rétroactive.
Pourtant on a le sentiment que vous tirez très bien votre épingle du jeu. Votre longévité est unique et les disques que vous produisez obtiennent la reconnaissance de la critique comme du public. Quel est votre secret ?
Je ne me vois pas comme un visionnaire, ni comme un théoricien. Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis toujours adapté. Je continue de croire à quelques principes fondamentaux du métier. Notamment, je crois qu’il faut un flair adapté à cela, car notre métier reste de faire découvrir de nouveaux talents et de leur offrir un espace de liberté créatif suffisant pour s’exprimer. Et ce flair, aucune étude de marché ne pourra le remplacer.
Ce flair, comment le cultivez-vous ?
Je sors beaucoup. Je vais au concert le plus possible, je prends des contacts, je vais dans les magasins, je cherche la prise directe avec le public, avec les artistes. C’est comme cela que se produisent les rencontres.
Et c’est pour exprimer librement ce « flair » que vous avez créé Virgin ?
Virgin a été créé en 1988 et a été racheté par EMI en 1992 avec le catalogue variétés. Mais c’est en 1996 que le label est venu s’installer à Paris, avec des équipes dédiées. Ce fut en effet une étape majeure. Auparavant, EMI France produisait des disques sur mesure pour l’hexagone, avec peu de marketing hors de France. C’était la grande époque des Plasson, Hendricks, Collard, Dumay,… Aujourd’hui, Virgin Classics est un label indépendant au sein d’une major dont le centre de décision est à Londres. Bien sûr, notre siège londonien voudrait lisser les méthodes, en matière de panels, de reporting, etc. mais nous continuons à travailler de façon assez indépendante. Du reste, j’ai pendant deux ans été Vice-Président A & R du label EMI Classics, mais j’ai renoncé à cette fonction pour me consacrer pleinement à Virgin Classics et à l’activité française, car la France est – de loin – n°1 du groupe en ce qui concerne le chiffre d’affaires classique. .
Quelle est la ligne éditoriale de Virgin Classics ?
Le point capital pour moi est de lui donner une identité. Il ne s’agit pas de dire oui à tout, mais de constituer un puzzle où chaque artiste a sa place, et où tous les artistes ont quelque chose en commun. Un contrat, c’est un bout de papier. C’est l’alchimie artistique qui compte. Une de mes fiertés est par exemple la rencontre entre Emmanuelle Haïm et Rolando Villazon. Entre eux, le courant est passé immédiatement, alors que cela n’était pas évident. C’est cela qui donne des disques intéressants. Je déteste les disques tièdes.
Peut-on parler aujourd’hui d’une « écurie Lanceron » ?
Oh, mon principe est simple : nous donnons une chance à des artistes, et c’est à eux ensuite de gravir les dernières marches. C’est ce qui s’est passé avec Natalie Dessay, avec Philippe Jaroussky… Nous leur offrons les conditions nécessaires pour s’épanouir, et nous leur proposons des partenaires qui leur permettent de s’exprimer et un réseau international pour développer leur carrière en dehors de nos frontières.
Votre acclimatation à la musique baroque n’était guère prévisible…
Franchement, j’ai très longtemps détesté la musique baroque. Pour moi, c’était l’affaire de chanteurs médiocres recyclés dans un genre opportuniste. Comme pour beaucoup, l’Atys de Christie a été un déclic. On ne dira jamais assez tout ce que l’on doit à William Christie. Chez Virgin, j’ai signé assez vite Fabio Biondi, qui est merveilleux pour la musique intalienne. Mais il nous manquait justement un William Christie. Je l’ai trouvé avec une de ses disciples, Emmanuelle Haïm, une musicienne hors pair et une travailleuse acharnée.
D’autres sont restés lettre morte ?
Oh oui. Pour ne citer que quelques projets avec Michel Plasson : le Fervaal de D’Indy. Le Roi Arthus de Chausson avec Thomas Hampson, Les Troyens de Berlioz avec Ben Heppner…
Votre implication récente dans l’Opéra de Nice vous permettra peut-être de faire voir le jour à quelques rêves enfouis ?
J’espère ! Pour l’heure, j’ai simplement accepté de contribuer à la remise à plat de la politique artistique de l’Opéra de Nice, ville d’où je viens et à laquelle je suis très attaché. Avant tout, c’est pour moi une autre manière d’envisager la musique. C’est aussi une respiration salutaire et une possibilité de m’exprimer différemment que par le disque. La programmation peut-être beaucoup plus aventureuse qu’avec le disque qui doit répondre à des critères bien définis et, un définitive un peu limités. Le champ d’action est beaucoup plus vaste au théâtre. Cette responsabilité est pour moi un nouveau défi. L’avenir nous dira comment cette expérience prendra forme.
Alain Lanceron, merci.
Propos recueillis par Sylvain Fort à Paris, en novembre 2009
Douze enregistrements lyriques majeurs selon Alain Lanceron
- Roussel / Padmâvatî : Horne, Gedda, Van Dam, Orfeon Donostiarra, Toulouse, Plasson
- Ravel / Mélodies : Berganza, Lott, Mesplé, Norman, Bacquier, Van Dam, Baldwin
- Chabrier / L’Etoile : Alliot-Lugaz, Raphanel, Gautier, Bacquier, Le Roux, Opéra de Lyon, Gardiner
- Bizet / Jolie Fille de Perth : Anderson, Zimmermann, Kraus, Quilico, Van Dam, Philharmonique de Radio France, Prêtre
- Enesco / Œdipe : Van Dam, Hendricks, Lipovsek, Gedda, Bacquier, Aler, Quilico, Monte Carlo, Foster
- Gounod / Faust : Studer, Leech, Van Dam, Hampson, Toulouse, Plasson
- Airs d’Opéras Français : Blake, Monte Carlo, Founillier
- Mozart / Héroïnes : Dessay, Age of Enlightenment, Langrée
- Offenbach / Orphée aux Enfers : Dessay, Naouri, Beuron, Gens, Fouchecourt, Podles, Opéra de Lyon, Minkowski
- Monteverdi / Combattimento : Villazon, Ciofi, Lehtipuu, Concert d’Astrée, Haim
- Vivaldi / Heroes : Jaroussky, Matheus, Spinosi
- Vivaldi / Bajazet : D’Arcangelo, Ciofi, Genaux, Garança, Mijanovic, Daniels, Europa Galante, Biondi.