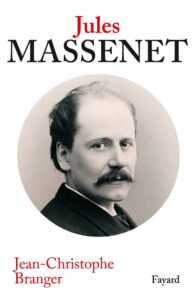Dix ans ont passé depuis Zurga, le rôle qui le révéla à Paris. Son répertoire, à l’exemple de sa voix de baryton, s’élargit au fil des saisons. Wagner coudoie désormais Mozart tandis que Golaud se place en tête de peloton, « tout d’un bloc » pour commencer, « très solide », « magnifiquement cuivré » puis bouleversant à la fin de l’opéra, « lorsque ce bloc se fissure – d’après notre confrère Claude Jottrand à Lille en début d’année. Solide comme un roc et plus fragile que la rose, tel que l’affirme le proverbe turc ? Sur scène peut-être mais entre deux séances de répétition, jovial, loquace confirmant ce qu’il énonçait en 2011 lors de son premier – et jusqu’alors dernier – entretien dans nos colonnes : « un baryton lyrique s’émancipe vraiment vers l’âge de 35-40 ans. »
Marcello dans La Bohème, n’est-ce pas une promenade de santé pour qui vient d’interpréter Alberich ?
Les deux sont différents. J’adore Marcello parce que, déjà, il arrive pile au bon moment dans ma carrière. Je l’ai étrenné à Marseille en 2020, dans une mise en scène de Louis Désiré, dirigé par Paolo Arrivabeni, en pleine pandémie, sans public donc, en streaming. Je prenais mes marques. J’ai adoré le chanter. Depuis, ma voix a changé mais Marcello me correspond encore idéalement. Alberich exige une résistance physique mais pas une technique belcantiste ; il faut être dans le caractère, dans les mots. Marcello, lui, veut une vraie technique. Le rôle est écrit souvent sur le passage au niveau du mi bécarre. Il faut savoir exactement ce que l’on fait.
Comment avez-vous acquis cette technique vocale ?
A travers des rencontres, notamment avec ma professeur, Susan McCulloch, qui est écossaise et enseignait à la Guidhall School à Londres. Avec elle, j’ai vraiment appris le fondement, la base du chant : comment atteindre l’aigu sans effort, comment bien respirer, comment gérer son souffle. Elle m’a appris à me servir de mon instinct en le mettant au service de la technique et à garder mon côté « taureau fonceur » dans l’apprentissage de nouveaux rôles et de nouveaux challenges. Elle me disait souvent : « Alex, tu as le choix : soit y aller intelligemment, sans pression ; soit y aller avec ta nature et ton instinct ». J’avais cette chance, qui est en même temps une malchance, de réussir à passer les obstacles en mettant un « coup de turbo ». Elle a été formidable. Il y a eu aussi Malcom Walker, Yves Sotin et Alain Fondary qui m’ont également beaucoup appris. C’est un apprentissage passionnant car sans fin. Je me sens souvent comme un sportif, un tennisman par exemple qui dirait « Tiens si je tentais ça pour améliorer mon coup droit ? Ah oui, c’est encore plus efficace et je me fatigue moins. Et ça… et ça… ». La technique n’est pas une fin en soi, mais un moyen qui permet de se libérer, d’être encore plus au service du texte, et donc de prendre plus de risques… Et je pense que plus on prend de risques, plus le public peut être ému.
Donizetti ou Bellini n’offrent-ils pas davantage de possibilités vocales que Puccini.
Marcello en offre autant. Le rôle est peut-être moins exposé. Il n’a ni air, ni cabalette mais l’écriture est très large, le medium très dense avec des aigus qu’il faut savoir gérer. Dans le duo avec Rodolfo à l’acte quatre par exemple, il y a un fa dièse qu’il faut bien préparer. Marcello est un rôle très humain qui permet beaucoup de contrastes. Il a beaucoup d’humeurs, traverse des moments de colère, de tendresse, de complicité.
Interpréter un personnage sympathique n’est pas dans vos habitudes.
J’aime être sur scène ce que je ne suis pas dans la vie. D’ailleurs, c’est drôle, parfois certains se disent : « Tiens, Duhamel a une certaine bonhomie, comment va-t-il faire pour jouer les méchants ? ». En ce moment, le rôle que je préfère chanter et que je chante le plus, c’est Golaud. On ne peut pas dire que le personnage soit des plus sympathiques, même si j’ai appris à le connaitre et que j’ai beaucoup de tendresse pour lui. Plus je le travaille, plus je comprends son cheminement psychologique. Le rôle, très sombre, convient à la nature de ma voix. C’est d’ailleurs dans ces emplois que je me sens maintenant le plus à l’aise. Je le constate en travaillant Iago, et Scarpia, pour moi-même. Je les ai refusés jusqu’à maintenant, mais je sens que ça vient, qu’il y a une adéquation, une évidence. Je me fatigue désormais moins quand je chante l’air de Rigoletto que lorsque je chante un répertoire plus léger. Voilà une vraie indication.
Votre répertoire comprend pourtant quelques rôles comiques : le vice-roi dans La Périchole ou prochainement Jupiter dans Orphée aux Enfers à Hambourg. Est-il plus difficile de faire rire que de faire peur ?
Oui, faire rire me semble plus difficile. On peut vite tomber dans le cabotinage, dans un extrême qui au bout d’un moment peut lasser. Alors que pour faire peur ou pour émouvoir, on est tellement aidé par la musique, par l’expression, par nos tripes que cela paraît plus évident, en tout cas pour moi. Heureusement, dans le répertoire comique, j’ai eu la chance d’être accompagné par Laurent Pelly et Marc Minkowski : un tandem d’excellence !
Orphée à Hambourg sera d’ailleurs dirigé par Marc Minkowski.
Oui, j’explore surtout ce répertoire avec lui. Nous avons une vraie complicité. Je travaille énormément avec Marc Minkowski et nous nous comprenons. Il comprend ma voix, il comprend ma manière de faire. Et moi je trouve qu’il y a chez lui un génie, un instinct théâtral et musical. Il a tellement fait pour moi. Il m’a donné mon premier Don Juan, mon premier Golaud, mon premier Sancho quand il a commencé son mandat à Bordeaux. Je ne sais pas si mes pas me porteraient naturellement vers Offenbach. Mais à chaque fois, il me le propose et moi, je ne peux rien lui refuser !

Votre voix a évolué, disiez-vous, a gagné en ampleur. Est-ce un processus naturel ou un effet recherché ?
Il y a quelque chose qui me dérange parfois dans l’opéra, c’est quand une voix semble artificielle, le côté « oh » [il chante avec emphase]. Je trouve que cela coupe complètement les émotions et sert davantage l’ego du chanteur que le texte et la musique. J’ai donc tout fait pour ne pas assombrir artificiellement. Lutter, lutter, lutter, mais au bout d’un moment, je ne peux pas cacher ce qu’est ma voix. Je peux tout faire pour chanter léger et clair mais je ne peux pas éclaircir à outrance et dénaturer ma voix. J’ai fait beaucoup de Ramiro par exemple, des rôles qui appellent une clarté française et je veux continuer à les chanter le plus longtemps possible. Mais je sens bien que ma voix évolue. Je parlais l’autre jour avec Guilhem Worms – superbe Colline dans cette production de La Bohème – de l’évolution de l’instrument chez un homme vers l’âge de 40 ans, et c’est un âge charnière pour les barytons. Je m’en rends compte. C’est très intéressant parce que depuis un an, je ressens quelque chose. A force de travailler, de me muscler, d’apprendre à me connaitre, il s’est passé quelque chose. Avant, il me fallait une heure pour me chauffer la voix. Et maintenant, même pour Marcello, en dix minutes, ça y est, je suis prêt. Tout commence à avoir une signification, une logique. Avant, dans ma loge, je pensais être prêt, être en forme mais une fois sur scène, j’arrivais à 60 % de mes capacités. Je me disais « Pourquoi ? Pourquoi je me mets autant de pression ? » Ce n’est plus le cas maintenant. J’ai eu une saison très particulière parce que j’ai perdu ma mère au mois de décembre. Elle était très malade depuis trois ans. Ma peine a évidemment été énorme mais il y a eu un déclic dans ma tête, dans l’artiste, dans l’homme que je suis, dans le lâcher prise. Le fait d’être encore plus conscient du côté précieux de la vie et de me dire : « A quoi bon ? Je fais ce métier. Je l’aime. Je pense être fait pour lui. Il faut que ce soit un plaisir, je ne peux plus être dans un perpétuel jugement ». Sur scène, ce n’est plus l’heure de se juger, le travail se fait avant et après ! Maintenant, je laisse faire mon souffle, je fais confiance à mes cordes et à mon corps. J’avais avant un côté démonstratif ; c’est un fait, même si ce n’était pas une volonté de ma part ; c’était plutôt un manque de confiance et un défaut de jeunesse.
C’est la maturité…
Oui, un déclic, la maturité, à la fois vocale et mentale. Quand ma mère est partie, J’ai chanté le lendemain à Toulon le Vice-roi dans La Périchole. Un rôle comique !
Vous avez chanté malgré tout ?
Ils ont été très compréhensifs, à l’Opéra de Toulon. Ils m’ont permis de ne pas faire la pré-générale et de rentrer à Paris pour lui dire au revoir. Et le lendemain, j’ai chanté pour elle. Elle n’aurait jamais voulu que j’annule. Je me suis servi de cette force, de cette urgence de vivre pendant toute la saison. Et cela ne me quitte pas. Quand Golaud doit dire au revoir à Mélisande au dernier acte de Pelléas et que Debussy a écrit ses deux dernières notes, ses sanglots, avec un petit losange, je peux vous dire que je…. Enfin voilà. Toutes les scènes comme celle-là, quand Marcello dit au revoir à Mimi puis « Corragio » à Rodolphe, je les ressens au plus profond de moi-même
Entre Verdi et Wagner, vous semblez aujourd’hui avoir opté pour le second ?
Je ne sais pas encore. En ce moment, c’est vrai, j’ai un nouveau Wagner par saison : Alberich, Kurwenal la saison prochaine et dans deux saisons, mon premier Hollandais. J’ai chanté sa grande scène pour la première fois à Lille avec orchestre dans un concert dirigé par Alexander Bloch. J’ai ressenti un sentiment que je n’avais jamais éprouvé. J’étais transcendé. Ce n’est pas très original de dire cela quand on chante Wagner, mais je me suis dit : « C’est incroyable, je viens de chanter cet air qui dure douze minutes, et je suis frais, je suis tellement frais. Pourquoi ? Pourquoi suis-je frais quand je chante douze minutes de Wagner alors qu’à la fin de « Finch’han dal vino », j’ai besoin de boire trois verres d’eau ? ». Wagner, je veux y aller doucement. Le Hollandais reste quand même très belcantiste. J’aimerais aussi aborder Wolfram, Amfortas… Chaque rôle en son temps. Je ne veux pas avoir un vibrato d’une tierce dans cinq ans. Mais je sens que oui, ma voix va dans ce sens : Iochanaan, Mandryka, ce genre de rôles. Pour autant, je n’ai pas envie de me couper de l’opéra italien et j’espère pouvoir combiner les deux. Ils se nourrissent l’un l’autre.
Et l’opéra français ?
Evidemment. Je n’en parle même pas parce que c’est évident. Je vais refaire Zurga à Toulouse. Je suis content. C’est mon rôle porte-bonheur. C’est le premier rôle que j’ai chanté dans ma carrière, avec Roberto Alagna, Salle Pleyel. Quand on me l’a proposé, j’ai dit à mon agent : « Ils se sont trompés, c’est une erreur ». J’étais encore à l’Atelier lyrique. Puis il y a eu Guillaume Tell que j’ai adoré, Golaud évidemment. Athanaël va venir, Méphistophélès dans La Damnation de Faust… Il est de notre devoir en tant que chanteurs français de défendre notre répertoire. Et puis ça tombe bien, nous autres barytons, sommes quand même très bien servis.
Oui, la France est une terre généreuse en barytons, hier comme aujourd’hui. Comment vous positionnez-vous par rapport à vos confrères ?
Jamais, je n’oserais me comparer. René Massis, qui était un de mes agents et un excellent chanteur, m’a toujours dit : « Alexandre, si vous voulez être heureux dans ce métier, ne regardez ni à droite ni à gauche mais devant vous ». J’écoute ce que font les autres, évidemment mais il ne faut jamais se comparer. Le chant est une rencontre avec soi-même. Certes, il se passe rarement une journée sans que j’écoute Ernest Blanc qui reste pour moi la référence. Il a tout : la beauté du timbre, la rondeur, la brillance, l’homogénéité, le texte, le personnage…
Pour Marcello, vous n’écoutez tout de même pas Ernest Blanc.
Non, pour Marcello, j’écoute des italiens : Bastianini et le jeune Cappuccilli.
Etre chanteur d’opéra, c’est être aussi être comédien…
Quand j’avais sept ans, je passais mon temps à me déguiser, à prendre les vêtements de mes parents, à monter sur la table et chanter du Michel Sardou. J’adorais cela. J’avais cet instinct-là. En classe, j’étais intenable. Mes profs m’appréciaient, mais je les agaçais beaucoup. J’ai commencé le théâtre au lycée dans une troupe que nous avions créée. Après mon bac, je suis entré au cours Florent. Je savais que je voulais faire des planches mon métier. Puis j’ai suivi des cours de chant. J’ai tenté le Conservatoire National et j’ai été pris. Après il y a eu l’atelier lyrique. J’aime la scène. J’en parle beaucoup à Eric Ruf (ndlr : le metteur en scène de La Bohème) : « crois-tu qu’un chanteur d’opéra pourrait aussi être comédien de théâtre ? ». Je n’ai pas envie de me fermer des portes, on ne sait jamais !

Le chant demande une certaine discipline. Vous imposez-vous une hygiène de vie ?
Oui, je bois très peu d’alcool par exemple. Si je me sens fatigué vocalement, je me tais. Mes amis et ma famille disent que je fais « ma diva ». Mais je ne parle pas ; je ne réponds pas au téléphone, je ne communique que par texto, même parfois à mes enfants. Je fais vraiment attention.
Est-il difficile d’être père et chanteur d’opéra ?
J’ai pour règle de ne jamais laisser passer plus de 15 jours sans voir mes enfants. Ils sont ma joie, mon inspiration et participent à mon équilibre. Je préfère parfois être fatigué mais épanoui que reposé et triste ! Le plus difficile est d’être loin et de se retrouver confronté à un metteur en scène ou un chef d’orchestre avec qui on n’est pas du tout d’accord. Je ne citerai pas de nom mais le métier est parfois très difficile. Avec les metteurs en scène, surtout. Au Théâtre des Champs-Elysées, les conditions sont idéales. Je chante dans la ville où j’habite. Nous formons une famille. L’ambiance est chaleureuse. A la pause, nous buvons souvent un café avec Michel Franck et Baptiste Charroing à l’étage de leur bureau. Je connais peu de directeurs comme eux qui viennent aux répétitions, qui écoutent, qui aiment autant la voix et les chanteurs ; Nous avons aussi la chance de travailler avec le metteur en scène Eric Ruf qui respecte la musique, le livret et qui arrive à créer un climat de confiance et de travail idéal ; un chef… – nous n’en avons pas encore parlé mais Lorenzo Passerini est un chef génial, intense. Puccini, on l’entend dans ses tripes et il respire avec nous. Quand on se retrouve loin dans un rôle que l’on n’adore pas forcément avec une mise en scène discutable, dirigé par un chef avec lequel le courant ne passe pas, l’état d’esprit n’est pas le même.
Pouvez-vous vous permettre de refuser certains engagements ?
Pas toujours. Il y a des rôles que j’aime moins chanter, mais je les accepte encore quand c’est par exemple l’occasion de mes faire mes débuts dans une grande maison. Quand on signe un contrat, c’est parfois quatre ou cinq ans à l’avance, on ne connaît pas toujours le nom du metteur en scène et il y a malheureusement parfois des choix très étranges. Je ne suis pas nécessairement partisan uniquement des mises en scènes traditionnelles, d’un classicisme total. J’aime certaines idées modernes. Iphigénie par Carsen au Théâtre des Champs-Elysées était intemporelle, classique et moderne mais magnifique, intelligente. La mise en scène de La Bohème par Eric Ruf est plutôt classique, mais vraiment superbe, et elle regorge de trouvailles. Je ne suis pas hostile à toute modernité. En revanche, quand on va à l’encontre de la musique, quand on va à l’encontre du personnage, quand on nous demande de chanter vers l’arrière ou à quarante mètres du chef, je ne suis pas d’accord. Il faudrait que certains metteurs en scène nous considèrent comme des alliés et non comme des obstacles ou des pions qui vont à l’encontre de leur projet.
Avec un chef d’orchestre, le différend est d’une autre nature, j’imagine.
Oui, des désaccords sur des tempi, sur des couleurs, sur le caractère. Mais cela arrive moins fréquemment et permet parfois de modifier sa conception du rôle. On grandit avec les rôles que l’on chante et on s’enrichit des idées des autres. Je ne suis pas le genre de chanteur à dire : « si je ne fais pas ce point d’orgue sur cet aigu, je pars ». Je l’ai vu ! Il m’est arrivé une fois de voir une soprano répondre au chef d’orchestre : « Maestro, qui remplit la salle ? Vous ou moi ? Alors, ce point d’orgue, je le ferai ! ».
Et alors ?
Elle a eu le dernier mot ! Le plus difficile, c’est quand un chef ne respire pas avec nous, lorsqu’il nous considère comme un simple instrument. Ce que nous sommes… Mais notre instrument est en nous, et c’est un instrument à vent et à cordes en même temps. Donc on a besoin de respirer, on a besoin de se sentir en osmose. Être chanteur d’opéra, c’est s’exposer. Il est si important d’être ancré et serein.
Crises sanitaire, économique, politique… Les temps sont difficiles. Certains prédisent la mort de l’opéra. Peut-on le sauver ?
Vaste question. L’opéra a survécu jusqu’à maintenant. Quel serait la raison de sa chute ? Souvent, j’entends parler du prix des places. Mais un billet pour Beyoncé est plus cher qu’un billet d’opéra. C’est un faux argument. Beaucoup autour de moi disent : « moi je ne vais plus à l’opéra car je ne vais pas dépenser 100€ ou 150€ pour ne rien comprendre pendant trois heures ». Je pense qu’il faut faire énormément de projets pour le jeune public, qui est notre futur public. Cela, à mon avis, est capital parce qu’à chaque fois que je chante pour mes enfants, pour des enfants – j’ai chanté dans une classe l’autre jour –, ils ouvrent des yeux énormes. J’ai découvert l’opéra en écoutant des disques chez ma grand-mère et en les lui empruntant. Maintenant, il n’y a plus vraiment de disque. Il y a la culture de la musique immédiate. On est sur Spotify et hop, on zappe. Tiens, j’écoute ça ou ça. Il est certain qu’un jeune de douze ans ne se dira pas : « tiens, si j’écoutais Beethoven ou Wagner ». Restent les films ou la télé. Certaines initiatives subsistent mais je pense qu’il faut en faire plus. Aller dans les écoles, expliquer ce qu’est l’opéra, expliquer la magie de ce métier qui réunit tellement d’acteurs différents : la mise en scène, les costumes, les décors, les lumières. C’est magique ! Expliquer que l’on chante sans aucune intervention de la technologie, que les textes que l’on défend, que les histoires que l’on raconte sont toujours d’actualité. Inculquer la culture du beau, la culture de l’effort partout, à l’école, à la maison, dans les médias. Peu importe l’origine sociale ou géographique ; personne n’est insensible à la voix. J’ai passé des vacances au Sénégal en janvier. Un soir, j’ai chanté Escamillo accompagné au djembé par des musiciens sénégalais. Certains entendaient de l’opéra pour la première fois. Ils étaient si émus ! Nul ne peut être insensible à cet art. Non, l’opéra ne mourra pas !