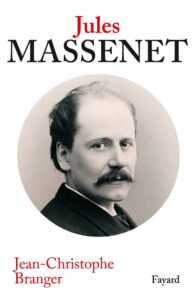Ni le besoin – voire la soif – de créer, ni le talent pour le faire, n’ont jamais eu de genre. Comme on ne le sait que trop bien, cette évidence d’aujourd’hui n’a pas eu le même écho par le passé, y compris jusque récemment. Bien sûr, les femmes qui le pouvaient avaient toute latitude pour jouer de la musique. Elles y étaient même encouragées – en particulier dans les milieux favorisés – pour parfaire leur éducation et ajouter cette jolie décoration aux talents multiples qu’elles devaient déployer dans le cadre de leur ménage. Parfois même pouvaient-elles devenir des virtuoses célèbres et célébrées pour leur art de l’interprétation. À l’extrême rigueur pouvait-on tolérer qu’elles présentent quelques pièces de leur composition dans le cadre relativement intime d’un salon, voire même en publier certaines. Penser à faire davantage suscitait bien souvent railleries ou anathèmes : soit une femme n’était pas capable d’écrire une œuvre digne de ses collègues masculins, soit elle n’était pas à sa place si elle osait s’y attaquer et encore moins si elle prétendait en vivre. Le mépris misogyne vient de loin et a touché jusqu’à des génies comme Mendelssohn, qui a littéralement interdit à sa sœur Fanny de donner libre cours à son propre talent ; Schumann qui a fait le coup de « choisis entre tes compositions et moi » à Clara ou encore Mahler qui tenait les lieder d’Alma pour une quantité négligeable qu’il ne fallait même pas chercher à publier. Il y eut bien sûr de remarquables exceptions, qui ont cependant souvent dû affronter une autre condamnation : celle qui va du désintérêt immédiat à l’oubli rapide. Puisqu’elles cherchaient à venir sur le même terrain que les hommes, quitte – il faut le souligner – à être défendues farouchement par certains d’entre eux, elles seraient donc vouées à n’être que des « petits maîtres » dont on oublierait jusqu’au nom.
Malgré ces tristes vicissitudes, précisément parce que la soif de créer n’est pas sexuée, on compte une liste – beaucoup plus longue que l’on pourrait penser – de femmes courageuses qui ont osé affronter les regards condescendants pour composer vaille que vaille, et le faire savoir. Y compris, bien sûr, des opéras, et ce dès les premiers pas de cette forme. Cette Journée internationale des Droits des femmes est une occasion de vous présenter quelques unes de ces compositrices, aux parcours et aux destins bien différents, de façon évidemment non exhaustive et dans un ordre chronologique. Ces quelques courtes biographies accompagnées de plusieurs extraits, doivent surtout nous aider à enfin les reconnaître au-delà du seul 8 mars.
- Francesca Caccini, pionnière d’un art nouveau
Florentine née en 1587 (et morte vers 1641), Francesca baigne dans la musique. Son père, est en effet un compositeur et chanteur au service des Médicis et sa mère est également chanteuse. Le père Caccini initie lui-même sa fille aux premiers rudiments musicaux et entend lui fournir une éducation complète en arts et en sciences. Chanteuse très réputée elle-même dans les cours d’Europe – notamment en France où elle viendra à l’occasion du mariage d’Henri IV avec Marie de Médicis – elle compose de nombreuses partitions pour la voix. Mais on lui connaît aussi un opéra entier, créé le 3 février 1625, à peine 18 ans après L’Orfeo de Monteverdi : La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina. On a coutume de dire qu’il s’agit là du premier opéra complet composé par une femme, bien que tous les autres soient perdus.
- Elisabeth Jacquet de la Guerre, un (autre) soleil à la Cour de Louis XIV
Cette autre enfant de la musique (elle est la fille de Claude Jacquet et Anne de la Touche, et son père est lui-même issu d’une dynastie célèbre de musiciens) et née à Paris en 1665 et où elle mourra 64 ans plus tard, sera l’une des grandes exceptions à cette règle qui relègue les femmes musiciennes à la sphère privée. Son don de virtuose du clavecin est admiré par le roi lui-même, devant lequel elle se produit à l’âge de 5 ans. Devenue compositrice assumée et reconnue, elle se pose en novatrice et touche à tous les genres avec un égal bonheur. Mais à l’opéra, elle n’échappera pas à la réprobation liée à sa condition, bien qu’on considère aussi la faiblesse du livret comme responsable de l’échec : sa tragédie lyrique Céphale et Procris (17 mars 1694, le jour de ses 29 ans) est rapidement retirée de l’affiche de l’Académie royale de musique. Mais heureusement, la postérité, cette fois, ne l’a pas oubliée. En témoignent ces quelques extraits dirigés à … Bayreuth par la cheffe Daniela Dolci.
- Wilhelmine de Bayreuth, pas seulement « sœur de »
Puisqu’il est question de Bayreuth, pourquoi ne pas justement évoquer une compositrice beaucoup plus occasionnelle, mais tout à fait talentueuse, Wilhelmine, margravine de Brandebourg-Bayreuth (1709-1758) ? Née Wilhelmine de Prusse, puisque fille du terrible roi-sergent Frédéric-Guillaume Ier et de Sophie de Hanovre, la petite princesse subit non seulement la violence pathologique et sadique de son père, tout comme son petit frère Frédéric, le futur Frédéric II, mais aussi celle de sa propre gouvernante. Elle en développera une relation extrêmement fusionnelle avec son frère, par solidarité et parce que son seul plaisir d’enfant était de le retrouver. Comme lui était flutiste de talent, Wilhelmine était une excellente joueuse de luth, mais composait pour divers instruments, après avoir bénéficié de l’enseignement du compositeur de la cour de son mari Frédéric – décidément – le margrave de Brandebourg-Bayreuth : Johann Pfeiffer, qu’elle avait elle-même choisi. Elle compose tout un opéra, Argenore, en 1740, pour l’anniversaire de son mari. La mort prématurée de cette amie de Voltaire à 49 ans laissera son frère absolument inconsolable, le plongeant dans une profonde dépression qui durera plusieurs années. Il fera bâtir à sa mémoire 10 ans plus tard dans le parc du château de Sans-Souci, un petit temple baptisé « Temple de l’amitié ».
- Maria Teresa Agnesi, la surdouée
C’est la sœur de Maria Teresa Agnesi, Maria Gaetana, qui est restée la plus célèbre des deux comme mathématicienne de renom et de génie. Née à Milan en 1720 et morte dans la même ville presque 75 ans plus tard, Maria Teresa se fera quand même elle aussi connaître pour ses dons d’interprète au clavecin, profitant de la tolérance remarquable avec laquelle, dans le Milanais, les femmes pouvaient alors se produire en public. Le président de Brosses, dans le récit fameux de son voyage en Italie, écrira son émotion à l’écoute d’un concert de Maria Teresa à Milan. Elle laisse de nombreuses partitions pour son instrument – seul ou avec petit ensemble – mais aussi plusieurs opéras dont beaucoup sont malheureusement perdus. Mais pas Ciro in Armenia, dédié au duc de Modène et créé à Milan le 26 décembre 1753 en ouverture de la saison du Carnaval. Il s’en est pourtant fallu de peu qu’on ne le perde aussi : la partition a été conservé à Dresde et n’a échappé que par miracle aux terribles bombardements de la Seconde guerre mondiale. Emmenée à Moscou par l’Armée rouge, elle est aujourd’hui conservée à la Bibliothèque d’Etat. Plusieurs extraits, restés à Milan ont également été préservés. Le Guardian en a fait en 2015 l’un des 10 meilleurs opéras composés par une femme.
- Lucile Grétry, le papillon foudroyé
Lucile-Angélique-Dorothée-Louise-Dominique Grétry (ouf) est bien la fille d’André Modeste et de l’artiste peintre Jeanne-Marie Grandon (on aime les prénoms composés dans la famille). Rien d’étonnant à ce que la jeune Lucile embrasse bien vite la vie artistique elle-même, et son père lui enseigne évidemment la musique. Rien d’étonnant non plus à ce que le genre lyrique et l’opéra-comique lui aient très tôt donné des fourmis dans les doigts. À 14 ans, elle écrit coup sur coup deux opéras comiques pour la Comédie italienne : Le mariage d’Antonio (1786) dont voici un enregistrement intégral bien qu’imparfait, puis Toinette et Louis en 1787, qui subira un échec. Mariée dès ses 16 ans et fort malheureuse, elle ne pourra hélas jamais développer ses dons, terrassée à 17 ans par la tuberculose.
- Louise Bertin, victime par procuration
Bénéficier d’un librettiste nommé Victor Hugo et d’un soutien indéfectible nommé Hector Berlioz, cela devrait suffire à asseoir durablement une réputation, construite sur un incontestable talent. Louise Bertin (1805- 1877) est elle aussi une « fille de », celle de Louis-François Bertin, patron du Journal des Débats, figure libérale opposée aux Bourbons et soutien de Louis-Philippe en 1830. Son célèbre portrait par Ingres suffit à s’imaginer une personnalité bien trempée. On peut aussi se figurer l’ambiance dans laquelle la petite Louise, dont la mère, Geneviève Boutard, est pianiste, grandit. Atteinte de poliomyélite et ne pouvant se déplacer qu’avec des béquilles, c’est son père qui lui assure un enseignement complet. Dans le foyer gravite tout ce que la France d’alors compte de talents et même de génies, écrivains, poètes, peintres… Louise s’imprègne de tout et montre elle-même des dons multiples dans plusieurs disciplines. Sur le plan musical, c’est le célèbre critique et musicologue Fétis qui lui enseigne le chant, tandis que Reicha – l’un des musiciens les plus réputés de son temps – lui fait découvrir la composition. Avec tout cela, Louise a le bagage pour commencer à produire ses propres créations. À deux premières œuvres qui obtiennent un certain succès entre 1827 et 1831 (Le Loup-Garou et Fausto) succède un opéra plus ambitieux : l’adaptation de Notre-Dame de Paris, roman que Louise avait adoré. Victor Hugo est un ami très proche de Bertin et les deux familles se visitent très souvent. Alors, bien que ne voulant « pas de musique sur (ses) vers », même en prose, Hugo accepte de bâtir lui-même le livret. Tout au long de la genèse de l’opéra, il sera d’une patience absolue pour se plier à la musique et un soutien constant. Tout comme Berlioz, qui la conseillera et qui ne tarira pas d’éloges pour cette Esmeralda, créée le 14 novembre 1836. Las ! Fille d’une figure politique qui ne manque pas d’ennemis, aidée pour le livret par une autre figure non seulement littéraire, mais tout aussi politique et de surcroît mondaine, conseillée pour la musique par une nouvelle figure de la vie musicale tout aussi controversée, Louise Bertin, dont la circonstance aggravante est d’être une femme, infirme qui plus est, attire contre son gré tout ce que Paris peut compter d’ennemis de ces trois là. Il s’en trouve même qui se persuadent que c’est Berlioz lui-même qui a composé l’œuvre et qui se cache derrière une femme… laquelle bien entendu ne pouvait nullement écrire une telle partition. Les représentations sont un vaste charivari, une cabale comme on n’en compte plus durant cette période. Louise n’écrira plus jamais pour la scène mais heureusement, elle ne renoncera pas à la composition. Voici le fameux air des cloches de cet opéra qui mérite une autre renaissance après celle assurée par le festival de Montpellier en 2008.
- Carlotta Ferrari, une Verdi féminine
Née à Lodi en 1827, Carlotta Ferrari va apprendre le chant auprès de l’oncle de la compagne de l’idole vénérée par toute l’Italie, Giuseppe Verdi, Francesco Strepponi au Conservatoire de Milan. Puis elle poursuivra avec Mazzucato, compositeur aujourd’hui oublié qui sera l’un de ses meilleurs soutiens. Comment une musicienne qui entend composer, passerait-elle, à cette époque et en Italie, à côté de l’opéra ? Il lui faudra pourtant lutter sans cesse pour arriver à faire entendre sa musique malgré des monceaux d’obstacles et de quolibets. Elle présente enfin Ugo, au Teatro Radagonda de Milan, en 1857 ; puis Sofia une dizaine d’années plus tard. Elle a la même conception du théâtre que son modèle Verdi, et elle veut en faire un art populaire. Comme on lui tourne le dos dans les théâtres, elle lève des fonds, aidée par Mazzucato, mais aussi Verdi et l’éditeur Ricordi, pour monter elle-même ses opéras, qu’elle dirige. En 1868, un Requiem lui est commandé à Turin pour l’anniversaire de la mort du roi Charles-Albert. Ce succès important ne suffira pas à lui ouvrir les portes des théâtres, mais Carlotta enseignera néanmoins à Bologne, où elle mourra en 1907. On ne trouve hélas pas d’extraits de ses opéras sur les plates formes, mais je vous propose cet air, tout à fait lyrique, sur un texte de Jacopo Vittorelli, qui sera mis en musique par d’autres compositeurs, dont un certain… Giuseppe Verdi, Non t’accostare all’urna.
- Elfrida André, la combattante
Elfrida Andrée est née sur l’île suédoise de Gotland en 1841 où son père est médecin. Elle entame des études musicales auprès d’un des plus grands compositeurs du pays, Niels Gade. C’est l’orgue qui est son instrument de prédilection et elle veut en faire son métier. Seulement voilà, en Suède à cette époque, impossible de devenir organiste professionnelle lorsqu’on est une femme. Elfrida obtient quand même son diplôme mais doit faire face à l’hostilité de l’Eglise suédoise lorsqu’il s’agit de lui donner un poste, en l’occurrence celui de second organiste de l’église Saint-Jacques de Stockholm. Puisque les rétrogrades veulent la guerre, elle va la leur faire. Elle se bat pour faire adopter une loi en 1861, alors qu’elle a à peine 20 ans, pour mettre fin à cette situation. Victorieuse, elle est dans la foulée nommée organiste à la Congrégation finlandaise de la capitale suédoise, puis à l’église réformée française de la ville. Ce ne sera pas son seul combat : les femmes ne peuvent pas exercer un certain nombre de métiers ? Elle se battra pour elles et gagnera à chaque fois, quitte à être la toute première à exercer ledit métier, quitte à ce que ce soit comme… télégraphiste (elle sera la première en Suède). En 1897, elle devient la première cheffe d’orchestre professionnelle de Suède et dirigera 800 concerts pendant les 30 ans qui suivent jusqu’à sa mort en 1929. Parmi sa centaine d’œuvres figure un opéra, Fritiofs saga, d’après l’œuvre de Selma Lagerlöf, dont voici le prélude, intégré dans la suite d’orchestre tirée ensuite de cette partition.
- Augusta Holmès, l’indépendante
Si on dit qu’Alfred de Vigny, son parrain, était son père biologique, ce qui est certain c’est qu’Augusta Holmès (1847-1903) avait une mère qui ne supportait pas la musique… Elle interdisait jusqu’à la présence d’un piano dans leur logement. C’est d’ailleurs pour cela qu’Augusta étudiera la peinture et non la musique, du moins, jusqu’ à la mort de sa mère, en 1858. C’est alors comme si on lâchait un ressort : en peu de temps, Augusta devient une virtuose du piano et rencontre au fil des ans le tout Paris musical, et notamment Saint-Saëns, qui la demandera plus tard en mariage – en vain – et qui restera l’ami d’une vie. Elle apprend la composition auprès de César Franck, lui aussi très fasciné par la jeune femme, et se met à écrire de nombreuses partitions. Elle laisse ainsi une œuvre abondante dans tous les genres, notamment plusieurs poèmes symphoniques, forme alors en vogue à la suite de Liszt et de son ami Saint-Saëns. Elle ne comprend que trop bien le handicap que constitue le fait d’être une femme pour pouvoir ne serait-ce que publier ses œuvres. Comme George Sand, elle prend donc un pseudonyme masculin, Hermann Zenta. D’origine anglo-irlandaise, elle est naturalisée française après la guerre de 1870 et ses œuvres sont alors créées sous son vrai nom. La compositrice affiche plus que jamais une indépendance farouche et entend faire ce qui lui plaît sur le plan musical, d’autant qu’elle en a les moyens. Mais, fait nouveau, aux yeux de ses nombreux détracteurs, le fait qu’on trouve sa musique « wagnérienne » (elle admire beaucoup Wagner, qu’elle rencontrera) prend le pas sur le fait qu’elle soit une femme… Cela conduira irrémédiablement à l’échec de l’un de ses opéras les plus ambitieux, qui est dans le même temps son dernier : La Montagne noire (1895). Elle écrira elle-même 5 autres livrets d’opéras. L’œuvre d’Augusta Holmès a été abondamment enregistrée, bien qu’elle soit fort rare au concert. Ce n’est hélas pas le cas de ses 4 opéras. Mais l’Ouverture pour une comédie, qui a beaucoup fait pour sa renommée, donne une petite idée de son style, dont Reynaldo Hahn dira : « Holmès osa tous les abandons, toutes les agonies…. Ce don de l’accent populaire, peu de musiciens l’ont eu à l’égal d’Holmès, et c’est à lui qu’elle devra l’immortalité véritable. ». Espérons le encore.
- Ethel Smyth, l’infatigable
Point commun avec Augusta Holmès, outre son ascendance franco-britannique, Ethel Smyth (1858-1944) se voit interdire par ses parents de faire de la musique et plus encore de composer, alors que c’est précisément ce qu’elle a l’intention de faire, dès son adolescence. Son général de père ne veut pas que ses huit enfants deviennent des saltimbanques. Mais à 19 ans, elle quitte le foyer familial et l’Angleterre pour entrer au Conservatoire de Leipzig, où elle est la première femme élève. Son professeur est un musicien très expérimenté, Carl Reinecke, et elle bénéficie des conseils de Brahms. De passage à Leipzig et l’entendant jouer l’une de ses propres œuvres, Tchaïkovski se montre enthousiaste et encourageant. À son retour en Angleterre, en 1890, elle s’est fait un nom et reçoit des commandes officielles. C’est pour elle un véritable âge d’or artistique, durant lequel elle écrit plusieurs opéras, dont les plus importants sont La Forêt (1902), qui sera repris jusqu’au Met et The Wreckers (Les Naufrageurs) qu’elle monte avec le soutien du très riche Thomas Beecham. C’est à peu près à ce moment là qu’elle épouse la cause des Sufragettes, pour lesquelles elle écrit un hymne, The march of the women. Condamnée pout avoir cassé la vitre d’un ministre lors d’une manifestation, elle est emprisonnée avec plusieurs de ses camarades. Cela ne l’empêchera ni de s’engager comme infirmière pendant la guerre, ni de devenir plus tard Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique. The Wreckers, créé à Monte-Carlo, est sans doute le plus remarquable de ses partitions lyriques et on y retrouve le souffle caractéristique de son style.
Et en bonus :
- Germaine Taillefferre, la prolifique
Peu à peu, on entend enfin parler à nouveau de cette compositrice au catalogue impressionnant et qui fut la seule femme du fameux groupe des Six, groupe d’amis aux styles si divers et qui travailleront si peu ensemble. Pour Germaine Taillefferre (1892-1981) aussi, le chemin de la musique a été semé d’embûches. Elle aussi, comme Holmès ou Smyth, a dû subir le refus catégorique de ses parents pour qu’elle se lance dans des études musicales. Son père jugeait même qu’entrer au Conservatoire ou faire le trottoir, c’était pareil… C’est donc en cachette que Germaine va y entrer, et avec la complicité de sa mère, finalement convaincue qu’il fallait la laisser faire. Lorsqu’il s’en aperçoit, son père devra se résoudre à l’évidence, mais refusera de financer. C’est le début d’une longue aventure durant laquelle Germaine Taillefferre ne cessera de travailler, tout en fréquentant assidûment les milieux artistiques parisiens qui la mèneront derrière Cocteau, jusqu’au groupe des Six. Même au cœur du XXe siècle, elle rencontrera des obstacles pour continuer à créer, puisque ses maris successifs vivent assez mal qu’elle poursuive ses activités. Elle n’en laissera pas moins des dizaines de partitions, dont la grande majorité est inédite et attend une redécouverte. Parmi elles, une demi-douzaine d’opéras, dont la série de 5 opéras de poche Du style galant au style méchant, dans lesquels Germaine Taillefferre rend hommage ou revisite divers styles, dont le baroque et le classique, qu’elle aime particulièrement, tout en montrant sa vie durant un éclectisme réjouissant. Voici par exemple quelques extraits de La fille d’opéra, qui n’a semble-t-il pas toujours fait le bonheur des candidats du bac musique il y a quelques années.
- Peggy Glanville-Hicks, la voyageuse
Australienne née à Melbourne en 1912, Peggy Glanville-Hicks poursuit ses études musicales au Royal College of Music à Londres, auprès de Ralph Vaughan Williams pour la composition ou Malcom Sargent pour la direction d’orchestre. Elle vivra ensuite aux Etats-Unis, où tout en composant, elle travaillera comme critique mais aussi comme directrice de la musique du Museum of Modern Art de New York. Peu après avoir obtenu la nationalité américaine, la voilà partie pour la Grèce, où elle vivra pendant 18 ans avant de revenir en Australie. Sa musique est elle-même très inspirée des voyages, des grands espaces, de l’océan. C’est d’ailleurs le cas d’un de ses principaux opéras, Nausicaa, Sappho ou encore The transposed heads (1954), court opéra en 6 scènes dont elle écrit le livret d’après l’œuvre de Thomas Mann et qui a pour cadre une légende hindoue. En voici la scène finale.
- Kaija Saariaho, la novatrice
Intéressée par la musique comme par la peinture, Kajia Saariaho, née en 1952 à Helsinki, choisit néanmoins de devenir compositrice pour mieux trouver son propre mode d’expression artistique. Elle se perfectionne en Allemagne puis à l’IRCAM à Paris, notamment autour de la musique spectrale et électronique. Elle a écrit 4 opéras, mais son plus grand succès, public comme critique, est L’Amour de loin, sur un livret en français d’Amin Maalouf, opéra hors du temps, bien qu’il se déroule au Moyen-Âge, à l’atmosphère étrange et au langage original, couvert de prix lors de sa création en l’an 2000. Tout un symbole.