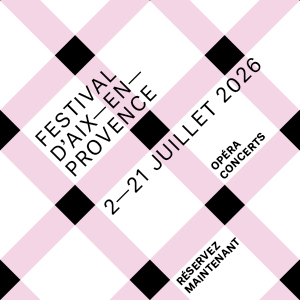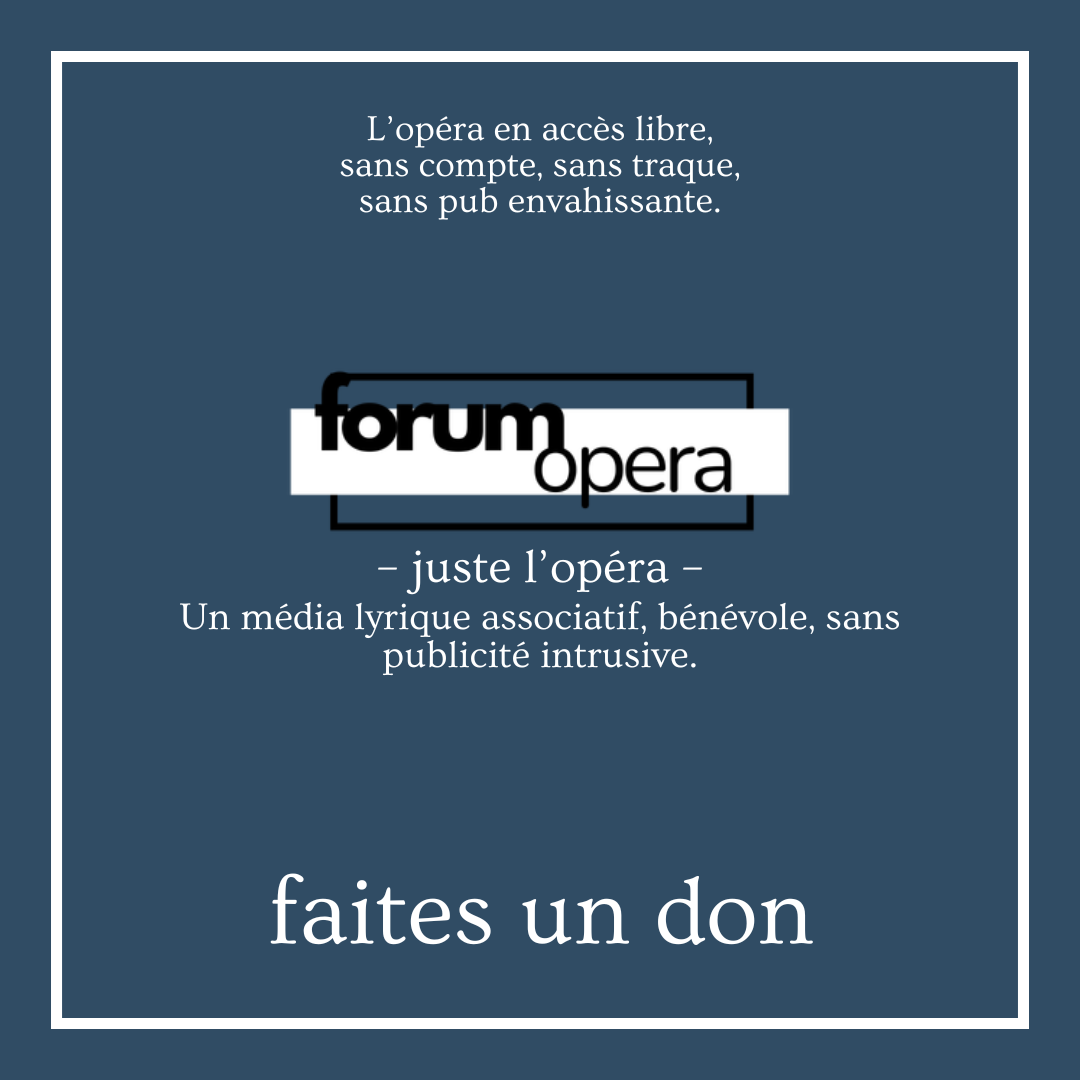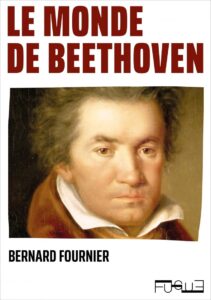Commençons par l’actualité. Vous venez d’achever à Paris une belle série de Werther.
Si je regarde en arrière tout ce que j’ai fait, je pense que Werther, ce Werther-ci est le rôle qui restera pour moi longtemps comme le plus important. Ce fut une expérience incroyable ; en arrivant à Paris, je me suis posé la question : « Comment donner de Werther une image différente de celle que les gens attendent, une image qui me ressemble en fait ? » Un amoureux, certes, mais moins violent, moins agressivement amoureux si je puis dire les choses ainsi, mais au contraire plus humain, plus proche de ce que je suis. C’était la première production à laquelle je participais, qui ne me sortait pas de la tête, à laquelle je pensais en permanence, même quand nous l’avions terminée. Et cette production a eu un succès incroyable, peut-être dû justement à cette couleur un peu particulière que nous avons voulu donner au personnage.
Autre beau souvenir en France, Les pêcheurs de perles à Aix-en-Provence.
Nadir, au début je pensais que je ne pourrais pas le chanter, trop difficile pour ma voix. Mais le directeur artistique Julien Benhamou m’a fait confiance en me disant ; « Toi tu penses que tu ne peux pas, mais moi je suis sûr que si. » Et ce fut aussi un beau succès !
Vous avez décidément une relation particulière avec la France.
C’est parce que j’ai fait mes débuts européens en France, à Bordeaux précisément (c’est pourquoi Bordeaux est vraiment mon chez-moi en France et quand j’y suis, j’entends des « il est bordelais » ! »). Plus sérieusement je crois que le public français a d’abord et avant tout une connexion émotionnelle à la musique, en opposition avec une approche plus technique. En d’autres termes, on recherche moins en France celui qui chante le mieux que celui qui est le plus honnête, le plus profond, et cela me correspond exactement. J’aime à penser que je chante suffisamment bien, mais ce n’est pas cela mon objectif ultime. Mon objectif c’est moins comment impressionner que comment toucher l’auditeur émotionnellement. Et le public est très sensible à cela, vous comprenez donc ma relation particulière avec la France. Et si en plus on ajoute le rugby … !
J’ai eu beaucoup de chance que ce public, dès le premier jour, m’a pris dans ses bras, et n’a pas dit : avant tout voyons de quoi il est capable.
On peut comparer avec d’autres pays ?
Oui, ce n’est pas pareil dans les autres pays. En Italie, par exemple, les gens veulent entendre la passion. S’il y a une note aigüe dans le rôle, vous avez intérêt à la chanter ! Ce n’est pas du tout la même chose avec le public français au passage. En Italie si vous ne chantez pas ou ne réussissez pas LA note, ce sont tout de suite les huées. Les Allemands sont « techniques » en quelque sorte, le public est très ouvert, beaucoup plus que ce que j’attendais. J’ai adoré chanter à Berlin et Hambourg (Munich a un public plus réservé) et je trouve que le public allemand se situe en quelque sorte à mi-chemin entre les publics français et italien.
Vous vivez maintenant la plupart du temps en Europe. Mais où vous sentez-vous chez vous ?
Sans conteste en France. Il y a Bordeaux bien sûr je l’ai déjà dit, mais aussi Paris en général, où j’ai des connexions dans beaucoup d’endroits (TCE, Bastille, Opéra-Comique). Mais je dois dire que ce qui compte beaucoup pour moi, plus que la ville, c’est la maison d’opéra elle-même, j’ai besoin de m’y sentir bien. Par exemple quand j’étais « Jeune artiste », j’ai reçu un accueil extraordinaire à l’Opéra de San Francisco, qui reste important pour moi. Au Staatsoper de Berlin aussi, j’ai reçu dès le premier jour un accueil comparable à celui de Bordeaux. Mais il ne faut pas croire que toutes les maisons font cela ; dans certaines, vous venez pour travailler, point final. Vous voyez, ici à Toulouse où je viens chanter pour la première fois, l’accueil a aussi été excellent, on m’a emmené voir l’équipe de rugby locale et l’entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola, m’a même offert un maillot floqué à mon nom et est venu à l’une de mes répétitions ! Donc mes premières impressions sont forcément excellentes !
De ce fait, vous retournez peu chez vous, aux îles Samoa ou en Nouvelle-Zélande.
J’essaie toutefois d’y retourner quand je peux. C’est rendu difficile parce que l’opéra de Wellington prépare ses saisons un an à l’avance alors que dans les grandes maisons les saisons sont préparées trois ou quatre années en amont. Mais cette année, par chance, j’ai eu un petit espace entre la Scala et San Francisco et donc nous allons faire un saut en Nouvelle-Zélande pour chanter Manon ! Mais c’est important pour moi de retourner respirer l’air de là-bas où j’ai toute ma famille, à l’exception de mon frère bien sûr [Amitai Pati est également ténor] .
Et de votre épouse également !
Mais oui ! Il nous arrive bien sûr de chanter ensemble avec mon épouse [Amina Edris est soprano] mais nous ne faisons jamais de forcing. Il y a des couples de chanteurs qui posent leurs conditions et imposent en quelque sorte les conjoints. C’est ainsi que nous menons nos carrières parallèlement et parfois nos chemins se croisent quand même ! Par exemple nous chanterons ensemble Manon à Wellington puis à San Francisco et l’an prochain à Paris-Bastille nous serons dans Roméo et Juliette.
Vous n’avez pas choisi votre voix, mais auriez-vous opté pour le ténor si on vous avait laissé le choix de votre tessiture ?
Oh c’est une question difficile, mais je crois quand même que oui, même si j’aurais adoré aussi être baryton. D’ailleurs ma voix se transformera peut-être dans bien des années comme celle de Placido Domingo ; du reste dans le grave de ma tessiture il y a déjà quelques accents barytonants.
Vous chantez beaucoup actuellement Roméo, Mantoue, Werther, Percy, Nemorino, Alfredo, Roberto. Mais est-ce que ce ne sont pas un peu tous les mêmes rôles ?
Alors les rôles de Bel Canto se ressemblent beaucoup c’est vrai, sauf peut-être Nemorino. Je dirais qu’effectivement les rôles italiens se ressemblent mais pas les rôles français. Werther est très différent de des Grieux par exemple, ou de Faust. Don José, que je ne chante pas encore, est encore tout autre. Et ce que j’aime énormément dans les rôles français, c’est la transformation de leur caractère qui s’opère tout au long de l’œuvre : regardez Roméo, Werther, Faust ou don José : je trouve leurs évolutions fascinantes. On n’a pas cela chez Edgardo par exemple. Il aime Lucia du début à la fin, point. Il finit par se tuer mais ses sentiments n’ont pas évolué. Pareil pour Rodolfo. C’est aussi la raison pour laquelle j’aime choisir les rôles qui me lancent un défi, non seulement de chanteur, mais aussi d’acteur. Et les rôles de l’opéra français vous obligent à aller au fond de vous-même. Regardez l’évolution de Don José, que l’on voit d’abord comme un soldat et puis qui se transforme sous l’effet de la jalousie en un être tout différent. Je suis beaucoup moins en phase, personnellement, avec Edgardo ou Rodolfo.
Quant à l’allemand, je ne le parle pas. La seule chose que j’ai jamais chanté en allemand c’est Das Lied von der Erde. En fait, je ne vois pas ce que je pourrais chanter ! Lohengrin peut-être. Tamino bien sûr.
Nous parlions des rôles français, on a l’impression que la langue française ne vous pose pas de difficultés ?
Figurez-vous que j’ai appris à prononcer votre langue grâce à une application (Memorize) sur mon smartphone ! Alors que je ne connaissais pas un mot de français ! Et j’ai répété, répété pendant très très longtemps. Mais au-delà de cela, c’était pour moi très important de bien prononcer, c’était une façon de montrer le respect qui est le mien de la langue et donc du public.
A votre âge il y a bien sûr des rôles dont vous rêvez ?
Oh que oui ! Il y a d’abord don José, qui est déjà en projet dans les trois ou quatre prochaines années. Mais ce que j’aimerais par-dessus tout, même si je ne crois pas avoir la voix pour, c’est Pagliacci ou Otello.
Vous n’auriez pas la voix ?
Plus précisément, Otello il faudrait que je le teste d’abord dans une salle pas trop grande, comme ici à Toulouse ou à Bordeaux ou à l’Opéra-Comique. Au Met ou à Bastille, je ne sais pas comment le dire, c’est vraiment très personnel, mais il y a déjà eu tellement de grands ténors, c’est tellement impressionnant. Non pas qu’ils chanteraient plus fort que moi mais ils ont plus d’expérience que moi des grands rôles sur de grandes scènes. Pourquoi j’aime ce personnage d’Otello ? Mais justement à cause du voyage incroyable auquel il nous convie pendant toute la pièce, entre le début glorieux et la fin tragique, la manipulation par Iago et toutes ces nuances de caractère que j’aimerais montrer. Vous savez, pour le dire autrement, j’aime chanter dans des salles plus intimes où vous êtes en communion plus directe avec le spectateur.
Des modèles ?
Mon modèle absolu a été Nicolai Gedda, mais j’ai beaucoup admiré Pavarotti et Domingo bien sûr. Toutefois en terme de technique, Ludovic Tézier est un grand-maître ! Si moi, ténor, j’arrivais à avoir son style, ce serait fantastique.
Alors on peut rêver d’un duo Tézier-Pati en Iago-Otello !
Oh là là, j’adorerais.
Les rencontres qui ont compté.
Quand j’étais jeune, mon entraîneur de rugby qui était en même temps mon professeur de piano a été déterminant pour moi. Il me faisait chanter dans le club comme c’était de tradition et un jour il m’a dit : « je crois que tu possèdes un talent que tu ignores ». Moi je lui ai répondu : « non, non, je veux continuer à jouer au rugby ». Et c’est grâce à lui, qui a cru en moi, que j’ai trouvé ma voie.
Et puis, pendant ma formation musicale, l’un des moments les plus forts pour moi a été un dîner avec Montserrat Caballé, en 2014. Je participais à une compétition que j’avais gagnée et elle m’a dit. « Pene, venez dîner chez moi ». J’étais très impressionné. J’y suis donc allé, et j’ai découvert qu’il y avait aussi José Carreras et Juan Pons à ce dîner. Elle m’a invité à m’asseoir à côté d’elle et nous avons parlé toute la soirée. Elle m’a dit : « Je vous ai invité parce que vous me ressemblez ! Et je vais vous dire : dès que vous allez commencer à vous faire un nom, vous allez voir apparaître autour de vous des tas de gens qui vont vouloir changer votre voix. Comme ils ont voulu changer la mienne. Quand je chantais pianissimo, ils voulaient que je chante forte ! Alors je vous le dis : ne changez jamais votre façon de chanter. Des gens adoreront, d’autres détesteront mais ne changez jamais ». Alors je lui ai demandé (c’est la première fois que j’en parle au cours d’une interview) : « Madame Caballe, que pensez-vous de mon nom ? Ne devrais-je pas en changer (en effet mon prénom, en italien et en espagnol signifie « pénis ») ? Les gens vont se moquer de moi ». Elle m’a répondu : « Que signifie-t-il pour vous ce prénom ? ». Je lui ai dit que c’était le nom de mon père et que en samoan, ce mot avait une toute autre signification ; il veut dire quelque chose comme « l’espérance ». Alors elle m’a dit : « C’est le nom que porte votre père, ne le changez pas et dites-vous bien, a-t-elle ajouté dans un rire, que les Italiens et les Espagnols qui se moqueront en entendant ce nom, au moins ils ne l’oublieront jamais ! »