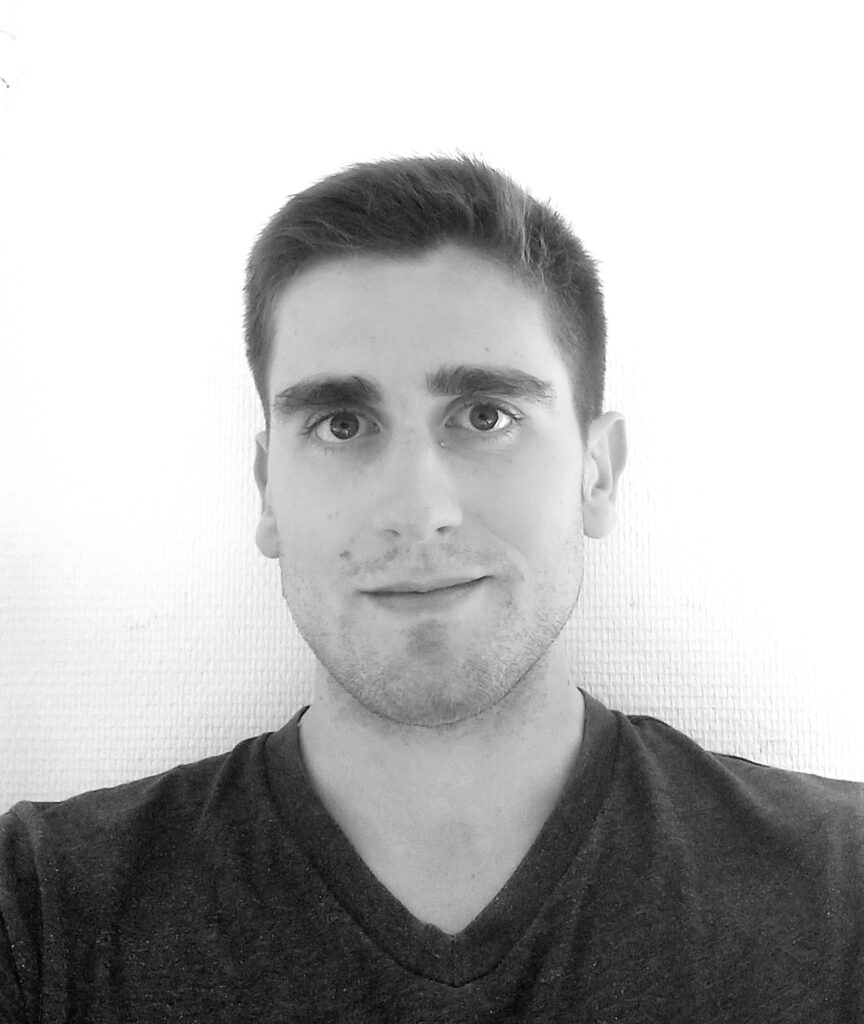Que reste-t-il du scandale de La Bohème de Claus Guth, huit ans après sa création ? Pas grand-chose si on en croit la réaction enthousiaste de la salle, bien remplie pour cette soirée d’ouverture de la saison lyrique de l’Opéra de Paris. Il faut dire qu’une fois les esprits refroidis et parvenus à la quatrième présentation de cette production, on se rend compte que celle-ci n’est pas aussi iconoclaste qu’on a pu le penser (elle a connu de menus ajustements). Ce qui nous frappe ce soir, c’est à quel point la dimension spatiale s’affaiblit après l’entracte, accentuant l’impression, fugace jusque-là, que, si la scénographie nous amène bien loin du Quartier latin, la mise en scène à proprement parler (la façon d’occuper l’espace scénique) est finalement très proche d’une Bohème traditionnelle : les quatre amis font leurs numéros, la neige tombe sans fin, Musetta chante en exhibant sa jambe, on souffle (lourdement) une bougie lors du finale (comme si l’orchestre déchaîné ne faisait pas déjà entendre les trompettes du destin). Les deux premiers actes, inscrits dans le vaisseau spatial en perdition, sont nécessairement marqués par la claustration et la froideur d’un monde où l’on ne trouve le bonheur que dans son imagination : il n’y a pas là de trahison magistrale du livret, hormis la scène de ventriloquisme du cadavre de Benoît. Mais une fois le crash du vaisseau survenu, l’espace n’est plus qu’une toile de fond dans les deux derniers actes pour des chanteurs qui jouent tout en avant-scène. Alors au bout du compte restent une scénographie spectaculaire, un déplacement pas si radical que ça qui fonctionne parfois assez bien pour suggérer une déréliction diffuse, et quelques détails confus qui remplissent sans rien apporter (le cortège funèbre de Mimi, le mime qui truste la scène jusqu’au finale, les échanges de vêtement entre Rodolfo et son double).
Une conséquence inattendue de ce regard rétrospectif in articulo mortis sur l’histoire d’amour entre Mimi et Rodolfo est de porter un coup au paradigme de la petite femme puccinienne. Ici Mimi a presque un sort enviable, elle repose en paix dans un monde passé bercé d’une lumière douce, un monde de cabaret et de robes rouges, rempli de références enfantines ; elle échappe à la faillite mystérieuse, à l’agonie glacée et désespérée de Rodolfo et de ses amis. Cela rééquilibre la dynamique des sexes et gomme ce que La Bohème peut avoir d’anecdotique dans son déroulé narratif. Il n’est pas sûr que cette production ait un jour des thuriféraires, mais elle n’a plus, de toute évidence, de vrais détracteurs.
S’il y avait une raison d’applaudir au tombé de rideau, c’était pour acclamer Domingo Hindoyan, qui nous fait penser que La Bohème gagnerait à être plus souvent envisagé comme un opéra de chef. Il fait chanter le flux foisonnant de l’orchestre de Puccini, en accordant son importance à chacune des cellules mélodiques qui s’entrelacent avec complexité, sans rien négliger du drame. Les tempi sont très convaincants et Hindoyan parvient à moduler le son de l’orchestre pour créer de vraies atmosphères aux teintes franches (on croit parfois entendre des grandes orgues dans la fusion parfaite des timbres de l’harmonie et des cordes). La plénitude et le phrasé de l’orchestre de l’Opéra de Paris rappelle que, si La Bohème est un opéra limité en termes d’action, on trouve dans l’orchestre les événements et la progression qui manquent au livret. Un bémol cependant : les deux premiers actes sont émaillés de décalages plutôt légers mais audibles, notamment avec les chœurs au deuxième acte.
Le plateau vocal est globalement solide mais sans rien de franchement saillant. Le trio des amis de Rodolfo est très bien servi : on aime toujours autant la voix puissante et claire d’Étienne Dupuis, qui campe un Marcello crédible et attachant. En Colline, Alexandros Stavrakakis fait des débuts remarqués à Paris : sa voix de basse est exceptionnellement sonore et facile, et sa « Vecchia zimarra » est chaudement applaudie par le public, à juste titre. Le rôle étant moins étoffé, Xiaomeng Zhang se démarque moins en Schaunard mais livre une prestation très soignée. La Musetta idoine d’Andrea Carroll bénéficie de son timbre clair malgré des si aigus attaqués par en-dessous un peu trop laborieux pour être intégrés à la ligne de chant dans « Quando m’en vo ». On apprécie cependant sa présence scénique dans le dernier acte.
En Rodolfo, Charles Castronovo a semblé en difficulté pour la première. « Che gelida manina » le surprend sans mediums et sans graves, comme s’il s’économisait, avec des aigus tendus qui ne semblent pas totalement sous contrôle et un contre-ut qui sort sans brillant, de telle sorte qu’il opte pour la version sans aigu extrapolé de « O soave fanciulla ». Surtout, il semble au premier acte en désaccord avec le tempo du chef qui résiste, ce qui occasionne, sinon de gros décalages, un manque de symbiose regrettable dans toute la scène de la rencontre. Il semble moins gêné dans les deux derniers actes, sans que l’on ait le sentiment d’une aisance suffisante pour permettre une incarnation totale du poète parisien.
Enfin Nicole Car est une Mimi solide, qui convainc par ses indéniables qualités de chanteuse. Une direction d’acteur plus soignée aurait sans doute pu tirer plus de cette artiste qu’on sait être par ailleurs bonne actrice : la scénographie des deux premiers actes semble l’engoncer, mais elle trouve plus d’aisance scénique par la suite. Passés des aigus un peu tendus au début de la soirée (qui font que « Si, mi chiamano Mimi » n’a pas la grâce suspendue qu’on aime y trouver), on apprécie son art du legato et son émission assurée ; c’est elle qui offre au troisième acte le premier moment d’émotion de la soirée.
En sentant son cœur se dérober lors du finale irrésistible, alors qu’on fait face à des amants séparés de vingt mètres qui ne se regardent pas et sont situés de part et d’autre de débris lunaires sous le regard d’un mime en tenue de deuil, on a surtout envie de saluer une fois encore le sens impeccable du drame dont était doté Puccini. Il assure le succès d’une œuvre qui demeure bouleversante dans presque toutes les situations – surtout quand le chef est au rendez-vous.