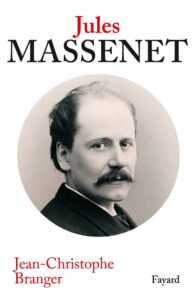Malgré la beauté du lieu et les fenêtres largement ouvertes sur les toits ensoleillés de la vieille ville, l’ambiance était un peu mélancolique, ce 10 juin 2011 à Salzbourg, pour la conférence de presse dressant le bilan des cinq années passées par Riccardo Muti à la direction artistique du Festival de Pentecôte. Le maestro cède la place à Cecilia Bartoli avec, dès à présent, des partis-pris sinon opposés du moins différents. Fin de partie.
Le projet Muti
Fondé par Karajan en 1973, le Festival de Pentecôte. s’était depuis 1998 concentré sur la musique baroque, particulièrement justifiée en ce lieu riche en monuments de la période, mais hésitant toutefois sur la formule, tantôt uniquement concertant, tantôt avec une création scénique. Les splendides Boréades des Hermann en 1999, avec un Simon Rattle inattendu mais très performant au pupitre en marquait alors l’apogée, avant une retombée dans le nettement plus ordinaire pour le Radamisto à la fois incongru et très pâle d’Hans Gratzer en 2002, de surcroît mené à la trique par un Martin Haselböck peu inspiré par la scène. Avec Händel au centre de la programmation, la suite paraissait avoir abandonné définitivement la partie visuelle. L’arrivée de Muti, appelé par Jürgen Flimm marquait un spectaculaire renouveau. Avec un programme cohérent, sur tous les plans, et une formule soigneusement mise au point et appliquée sans faille pendant les trois années du premier contrat, renouvelé après son succès pour deux années supplémentaires.
Pour la formule : sur quatre journées bien remplies, matin et soir, une création scénique d’un opéra inédit, donné deux fois, une œuvre de musique sacrée pour le lundi de Pentecôte, et deux concerts complémentaires confiés à d’autres chefs et ensembles, dont l’un pour une version concertante d’une œuvre vocale. Non moins important : des distributions sans véritables stars internationales et au contraire centrées sur les jeunes interprètes, récemment issus des concours ou en tout début de carrière – à commencer par l’ « Orchestra Giovanile Luigi Cherubini » du maestro, démontrant rapidement qu’il n’avait rien à envier aux meilleurs ensembles, avec un sérieux et un enthousiasme qui sont l’apanage de la jeunesse. Et pour le programme : « La scuola napoletana » ou « Naples métropole du souvenir », comme titre générique, pour un répertoire consacré uniquement aux compositeurs originaires du lieu ou directement associés à lui, pour des raisons diverses.
Le projet pouvait au départ laisser un peu sceptique. Car les Napolitains n’étaient pas inconnus assurément : plaisants, légers, charmants, hors les fulgurances de Pergolèse, le génie foudroyé (en 1736), ou la science intimidante d’un Alessandro Scarlatti (mort en 1725). Sans doute les textes, reprenant le constat établi par Charles Burney lors de son fameux voyage de 1770,s’accordaient à dire l’importance de la ville pour les plus grands venus d’ailleurs ou particulièrement attentifs à cette école de Naples, de Händel (venu en 1708) à Mozart (de passage en 1770) ou à Haydn (par le biais des œuvres au répertoire d’Eszterhaza). Mais pour insister aussitôt sur un « dépassement » rapide de cette production, pour le second cité tout particulièrement.
A l’école de Naples
En 2007, Il Ritorno di Don Calendrino de Cimarosa donné en ouverture, dans une mise en scène inventive rendant pleine justice à la fantaisie de cet excellent livret (attribuable à Giuseppe Petrosellini, le librettiste probable de La Finta Giardiniera et celui du Barbier de Paisiello), remettait les pendules à l’heure : en 1778, cinq ans après ses débuts à la scène, le jeune maître y donnait une version quasiment parfaite de l’opéra napolitain, avec ses deux actes concluant par de longs et brillants finales (le premier avec un étonnant passage mineur lent et introspectif, pour lequel on ne pouvait pas ne pas évoquer les Mozart et Haydnultérieurs), suivis d’un troisième plus court, pour une conclusion enlevée. Au lieu de l’inusable Matrimonio segreto de 1792, toujours séduisant, mais entraînant inévitablement les considérations sur la survie d’une conception à cette date « dépassée » en effet par Mozart, c’est un modèle exemplaire que l’on découvrait : déjà suivi et poussé à l’extrême de ses ressources par le maître salzbourgeois dans la merveilleuse Finta de 1775 (version originale italienne retrouvée en 1978 seulement, attestant mieux de l’étroite parenté…), maisauquel Haydn, nourri des œuvres napolitaines qu’il dirigeait à Eszterhaza, devait en revanche rester toujours fidèle, jusqu’à l’impasse de l’Anima del filosofo.Découverte complète ? Pas vraiment non plus car, comme pour Paisiello, une bonne quinzaine d’enregistrements antérieurs pouvaient déjà éclairer les passionnés sur cette production opératique considérable du compositeur (environ soixante dix titres). Mais dans des conditions acoustiques souvent médiocres et avec des interprétations très nettement moins performantes. Avec cette œuvre entre autres, apparaissait une perfection « classique » on peut dire en effet, dans tous les sens du terme, innovant par rapport au « baroque » qui précède. Le 11 juin, Muti prend précisément feu sur ce terme, et s’énerve presque : absolument rien de « baroque » dans sa programmation d’opéras, qui commençait en 1770, mais au contraire l’invention de l’opéra « moderne », dont la paternité doit être rendue à cette école napolitaine… La démonstration devait être donnée autant dans le seria que dans le buffo : celui-ci répété en 2008 avec Il Matrimonio inaspettato de Paisiello (1779), celui-là illustré en 2009 par le Demofoonte de Jommelli (1770). Et vérifiée a contrario dans les concerts, consacrés eux, à la génération vraiment baroque.
Dans cette programmation soigneusement élaborée, ces derniers ont en effet donné l’autre versant, étroitement complémentaire, et encore moins bien connu, de l’école napolitaine : celui du grand oratorio sacré entretenu par les ordres religieux (Théatins, Jésuites et Oratoriens), dont Scarlatti donnait le modèle initial (Oratorio a quattro voci ou La Vergine dei dolori) de 1717 donné en 2007 dans le cadre acoustiquement très difficile mais visuellement très approprié de la Kollegienkirche de Johann Fischer von Erlach (1707) – expérience renouvelée seulement en 2008 avec Hasse), mais poursuivi avec la même constance dans une inspiration souvent extraordinairement émouvante : l’oratorio de 1732 Sant’Elena al Calvario de Leonardo Leo, sur le remarquable texte de Métastase (repris en 2007 par Fabio Biondi et son Europa Galante) puis le non moins impressionnant I pellegrini al sepolcro di Nostro Signore de 1742de Johann Adolph Hasse (donné par Muti) ont constitué à cet égard des révélations que nous ne sommes pas près d’oublier.
Le plus étonnant d’une certaine façon, a été de ne pas hésiter à aller droit au cœur du problème en confrontant en 2010 sur le même livret de Métastase (1734), Jommelli et Mozart, avec leurs deux Betulia liberata respectives, de 1743 et 1771 (la seconde pour une des rares mises en scène de l’œuvre). Pour conclure à l’injustice d’une comparaison hors contexte, le Jommelli ayant à sa date la perfection de sa sereine beauté propre, dans les limites du genre, là où le Mozart, tout en suivant strictement la forme napolitaine en deux parties, construit un oratorio grandiose et à l’expressivité souvent pathétique, conduisant au renoncement à la formule au profit définitif du vrai théâtre.
Pour explorer aussi les aboutissements de cette trajectoire : l’essai de renouvellement, plus que méritoire à son grand âge, de Hasse dans son étonnant Piramo e Tisbede 1768 (déjà connu il est vrai, et redonné en 2010par Fabio Biondi au fil d’une tournée) – qui serait à mettre en parallèle avec cet autre « unicum » qu’est L’Isola disabitata de 1779 de Haydn, tentative sans lendemain elle aussi d’échapper à la formule napolitaine, par le développement inusuel, entre autres de l’accompagnato. La surprise la plus grande peut-être venait pourtant la dernière année avec le surprenant I due Figaro de Mercadante, bien tardif (1826 : Paisiello, après une évolution marquée, était mort dix ans plus tôt…), mais bien napolitain, et intégrant sans complexe, et sans faiblesses, sur le versant tragi-comique (« melodramma giocoso ») l’apport mozartien, pour le réunir, via Rossini (formé à la leçon de Cimarosa et de Paisiello on le sait), au modèle napolitain.

Riccardo Muti © Silvia Lelli
Distribution et mise en scène
Pour servir cette programmation exemplaire, les distributions n’ont été que très rarement défaillantes, pour au contraire contribuer à lancer ou à faire rayonner, à côté de quelques figures connues (Marcus Werba ou Marie-Claude Chappuis en 2008 dans Il Matrimonio inaspettato, Luca Pisaroni la même année dans le Hasse, Dmitry Korchak en 2009 dans le Jommelli et en 2010 dans sa Betulia, Vivica Genaux et Désirée Rancatore accompagnant en tournée Fabio Biondi dans le Piramo e Tisbe de 2010…) des noms qu’on a ensuite cru avoir la fortune de découvrir sur plateaux plus regardés : pour citer presque au hasard, Franco Fagioli, Anita Bonitatibus ou Ekaterina Gubanova (en 2007 dans le Scarlatti) ou Marco Vinco et Juan Francisco Gatell (la même année dans le Cimarosa), qu’on a célébrés ensuite à Paris, Gemma Bertognolli et Roberta Invernizzi dans le Leo de la même année encore, Baniela Barcellona dans le Hasse de 2008, Maria Grazia Schiavo en 2009 dans Demofoonte et en 2010 dans la Betulia de Mozart, Michael Spyres dans la même œuvre, Vito Priante dans celle de Jommelli, de même qu’Eleonora Buratto, revenue en 2011 dans I due Figaro, rejointe par Antonio Poli, autre nom dont l’avenir paraît certain.
Côté mise en scène, où l’on sait les exigences particulières de Muti, et ce qu’on pourra considérer ou non comme une trop grande prudence (peut-être préférable en effet pour des œuvres à découvrir : on l’opposera aux risques parfois inconsidérés que René Jacobs aura pris sur ce plan à Innsbruck), le bilan est nettement plus mitigé, avec des spectacles toujours d’une belle qualité plastique, mais souvent timides à l’excès dans la direction d’acteurs, et bridant du même coup les potentialités dramatiques des œuvres. Le Calandrino de Ruggiero Cappuccio (avec les décors d’Edoardo Sanchi) était un succès, comme encore, un peu moindre, l’assez ingénieuse Betulia mozartienne de Marco Gandini (avec le beau décor d’Italo Grassi), le Demoofonte de Cesare Lievi restant nettement inférieur à sa tâche, et le Matrimonio inaspettato de Andrea De Rosa, trop simplificateur et modestement illustratif, de même que le joli Mercadante d’Emilio Sagi.
Des limites de l’exercice
Quelques considérations plus générales peuvent compléter.
Pentecôte, qui est bien partie intégrante du grand « Festival de Salzbourg » – contrairement au festival de Pâques, autre création de Karajan, mais qui reste gérée indépendamment – est comme lui étroitement lié au lieu, à ses espaces, à son « esprit », et en l’occurrence plus particulièrement à sa date, Muti ayant particulièrement tenu à lui conserver sa dimension religieuse grâce aux concerts du Lundi (conclus éloquemment, en 2011, comme l’ensemble du cycle, par le Requiem en do majeur de Cherubini, dont on sait à quel point il lui est cher, répondant à celui, plus rare, de Paisiello 1789-1797, donné en 2009). Une transposition en d’autres lieux restait problématique, avec le risque de lui enlever une bonne partie de son caractère.
Malgré l’utilité ou même la nécessité, autant artistique que financière, des coproductions, celles-ci sont donc restées limitées – hors la reprise systématique de la création scénique dans le cadre du festival de Ravenne, dont Muti est également le maître d’œuvre. Et les rares exportations partielles (Las Palmas pour le Calendrino, Paris pour Demofoonte, Madrid en 2012 pour le récent Mercadante – justifié par le sujet et le lieu de création… et c’est tout !) auront pu se révéler dommageables, comme pour le Demoofonte présenté au Palais Garnier en 2009, où un beau mais lourd décor devenait particulièrement incongru, et qui aura surtout servir à enrichir le sottisier d’une partie de la critique parisienne.
Du même coup l’écho de cette série de manifestations pourtant exceptionnelles est resté limité : pour la dernière saison, la plus fréquentée depuis l’ouverture de la série, avec 7 600 spectateurs payants, 65 journalistes étaient présents, mais pour 37 revues germanophones, 7 italiennes, et … seulement deux françaises (dont Forumopera.com !) – moins que pour le plus petit festival provincial de qualité discutable ! Ce manque de curiosité intellectuelle ne peut guère s’excuser par le resserrement sur un petit nombre de journées du festival. L’argument ne vaudrait pas mieux pour le Festival d’Innsbruck, qui depuis de plus longues années effectue un travail aussi remarquable en distendant au contraire sur une période d’un mois, qui rend encore plus difficile de rendre compte des deux créations scéniques annuelles sans avoir la possibilité de séjourner au voisinage. Le nom et la qualité de Jacobs pour ce dernier, celle de Muti pour Salzbourg auraient pourtant dû jouer, à défaut de curiosité pour la rareté et la qualité intrinsèque des œuvres.

Cecilia Bartoli © DR
Et après ?
Est-ce la raison de ce qui semble un changement d’orientation sensible, avec l’arrivée d’Alexander Pereira, le nouvel intendant ? Nouvelle directrice artistique, Cecilia Bartoli paraît avoir tout misé sur son propre nom. Outre sa présence dans les distributions, la plutôt luxueuse plaquette d’annonce de programme 2012 joue d’abord sur son image : en couverture, côté pile, pour sa photo dorée, répétée en damier, à la Warhol, avec une pose en Cléopâtre – justifiée par le choix de ce qui devient un thème annuel, mais tout de même bien curieuse ; et côté face pour un portrait pleine page servant de publicité au nouveau sponsor, Rollex, succédant à un autre illustre manufacturier de montres, Lange & Sohne, qui n’avait pas exigé pareille prestation du maestro– ou ne l’avait pas obtenue. Plus sérieusement, et sans préjuger naturellement de la qualité des résultats à venir, on notera précisément le passage à un programme thématique qui renonce aux attaches avec la ville (Cléopâtre donc, pour la première année), le retour d’œuvres sûres et bien fréquentées du répertoire (le Giulio Cesare de Händel) , et celui du vedettariat dans les distributions (Netrebko et Gergiev, Kasarova et Gardiner, Sophie Koch, Ludovic Tézier et Véronique Gens dans la Cléopâtre de Massenet en version de concert – un titre rare cette fois, qui à lui seul ne ferait sans doute pas courir les foules…).Malgré quelques éléments de continuité (une œuvre « baroque », la présence de Giovanni Antonini pour ce Händel…) une page est vraiment tournée. On rendra hommage au chef qui l’a écrite, dont la gloire et les nombreuses activités par ailleurs ne l’obligeait pas à faire ce travail de recherche, de préparation et de montage d’œuvres inédites – et pour le seul amour de l’art, avec malheureusement, jusqu’à présent, aucun enregistrement pour en conserver la mémoire. Naples est sa ville natale il est vrai, et Muti était à l’âge de lui payer sa dette.
François Lehel