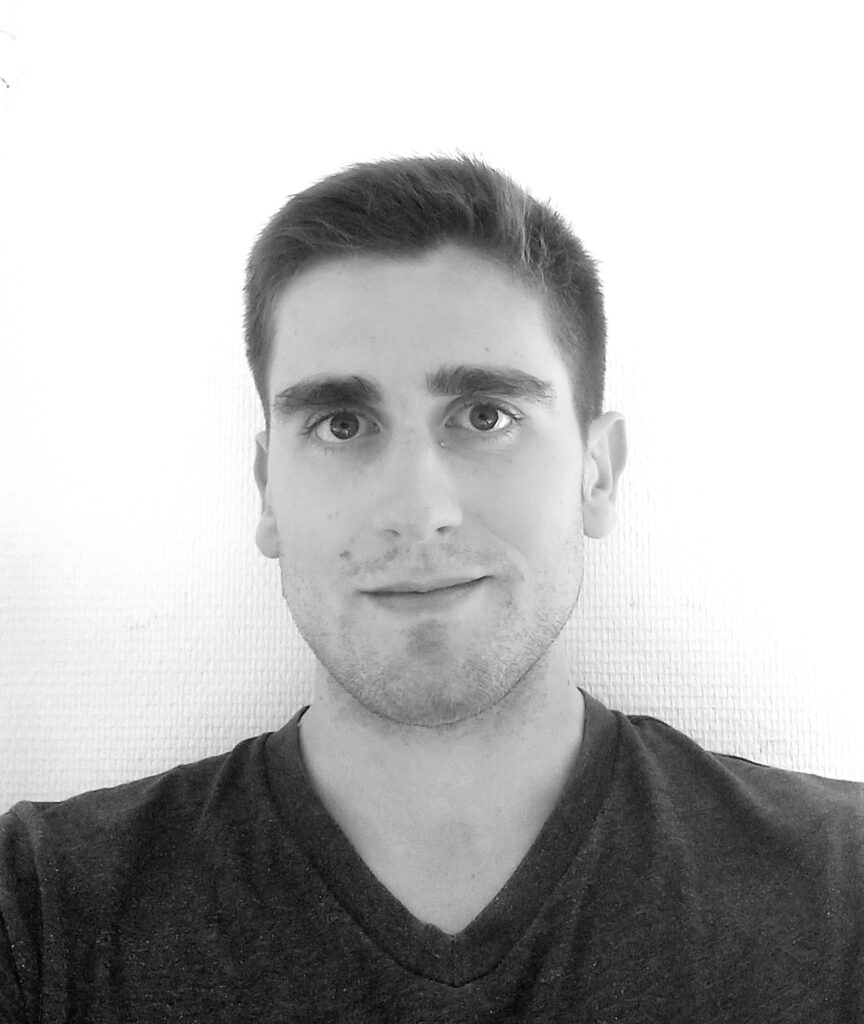En ce début de septembre, alors que la plupart des salles de concert sont encore fermées au public, la Philharmonie a proposé la première édition de son festival de rentrée, baptisé les Prem’s en clin d’œil aux très populaires BBC Proms de Londres. Pour un coup d’essai, il faut reconnaître que la programmation est très alléchante, avec quatre phalanges d’envergure mondiale accompagnées de leurs chefs non moins célébrissimes : le Gewandhausorchester de Leipzig d’Andris Nelsons, le Berliner Philarmoniker de Kirill Petrenko, l’Orchestre de Paris de Klaus Mäkelä et l’Orchestre et les Chœurs de la Scala de Milan sous la baguette de Riccardo Chailly. Le parterre est débarrassé de ses sièges pour l’occasion et accueille en bordure de scène des spectateurs debout, pour 15 euros (11 euros pour les moins de 27 ans).
On ne peut dire assez à quel point on est heureux de voir se développer à la Porte de Pantin une institution inventive, dynamique, qui ne ménage pas ses efforts pour attirer un public large et des artistes de premier plan, dans une volonté de création, d’ouverture et de rajeunissement qui est seule à même d’assurer l’avenir de la musique classique. Les Prem’s s’achèveront les 10 et 11 septembre, mais on peut déjà affirmer qu’ils ont été un triomphe, le public parisien (et jeune) ayant incontestablement été au rendez-vous de ces concerts de haute tenue. Dès lors, on peut imaginer que la Philharmonie travaille à renforcer la dimension populaire de l’événement dans les années à venir, pourquoi pas en exploitant les grandes pelouses du parc de la Villette qui jouxte la Cité de la Musique. Les possibilités sont nombreuses pour aller plus loin encore, car on a bien observé que la salle Pierre Boulez, même partiellement peuplée de spectateurs debout, demeure un temple de sérieux et de silence qui n’est pas tout à fait l’esprit des concerts promenades qui ont donné leur nom aux Proms.
Riccardo Chailly, qui restera jusqu’à la fin 2026 directeur musical de la Scala avant de céder la place à Myung-whun Chung, signe un excellent concert, jouant sur les deux immenses instruments que sont l’orchestre et le chœur sans se perdre en gestes inutiles, faisant la démonstration d’une symbiose qui marque le prix et la singularité des grandes formations. Particulièrement attentif aux équilibres et aux jeux de nuances, il est aidé par des pupitres à la discipline exemplaire et au son remarquablement homogène, qui semblent jouer comme un seul homme – c’est notamment frappant chez les cordes, aux trémolos légèrement amples très unis et ainsi parfaitement expressifs. On remarque un très beau quatuor de solistes dans l’harmonie (flûte, clarinette, hautbois, basson) que le programme sollicite régulièrement.
La première partie, consacrée à Verdi, est une grande réussite. Faisant la part belle à des pages moins célèbres du compositeur (si l’on excepte les chœurs de La traviata), ce programme propose quelques morceaux de bravoure chorale. L’entrée a cappella de « Viva Italia » dans La battaglia di Legnano met en avant les qualités propres à cette formation d’exception : un son brillant, très homogène, une diction remarquable mais jamais appuyée, des nuances parfaitement maîtrisées. Après les accents martiaux de ce premier opéra, on entend un « Silenzio, mistero » tiré de I due Foscari qui manque un peu de relief et de narration et se repose trop sur le piano subito, certes magnifiquement chuchoté par les hommes du chœur. Les pages de La traviata trouvent la formation scaligère à son sommet : un rutilant « Si ridesta in ciel » de la fin de l’acte I ; un très beau pupitre de mezzos qui donne une profondeur agréable au célèbre chœur des gitanes et un staccato enjôleur dans « Di Madride noi siam mattadori ». Cet effet signature du chœur verdien est difficile à assumer avec à la fois netteté et musicalité, mais on entend ici d’agréables lignes phrasées et sculptées avec soin. Après une exécution envoûtante de la musique de ballet du troisième acte d’Otello dont on avait oublié le charme et les audaces, le chœur achève cette première partie par un exceptionnel « Dove guardi splendono » du même Otello. Entendue sans les parties solistes et sans les chœurs d’enfants qu’on utilise habituellement, cette page prend une dimension inouïe, où le chœur est traité comme un orchestre à part entière, seulement soutenu par deux harpes. Une grande réussite.
Après une première partie si bien construite et si magnifiquement interprétée, on est un peu moins emporté par la section Rossini. Il faut évoquer d’abord une question d’acoustique : peut-être à cause de la modification du plan du parterre, une réverbération inhabituelle se fait entendre dès le début du concert. Si elle accompagne voire amplifie les chœurs verdiens retenus, volontiers épiques et jouant sur des contrastes entre fortissimi et pianissimi, cette caractéristique dessert une écriture aussi dentelée que celle de La gazza ladra. La pâte orchestrale paraît un rien terne et les caisses claires de la sinfonia d’ouverture sont bien trop présentes du point de vue de l’équilibre sonore. Entendons-nous, cette deuxième partie reste très bien exécutée et soulève l’enthousiasme général, mais elle est moins idéale que la partie verdienne. On apprécie néanmoins la tension dans le chœur de Semiramide « Ergi omai la fronte altera », qui prouve que le chœur de la Scala sait raconter en plus de phraser comme les meilleurs chanteurs de belcanto.
Le public des Prem’s, qui semble chauffé à blanc, applaudit à tout rompre les forces vives de la Scala, dont on ne tire toutefois qu’un seul bis, tiré de Guglielmo Tell (acte I, scène 8) pour couronner ce beau concert. Une belle manière d’ouvrir la saison lyrique et de rendre hommage aux artistes permanents qui font l’âme d’une maison.