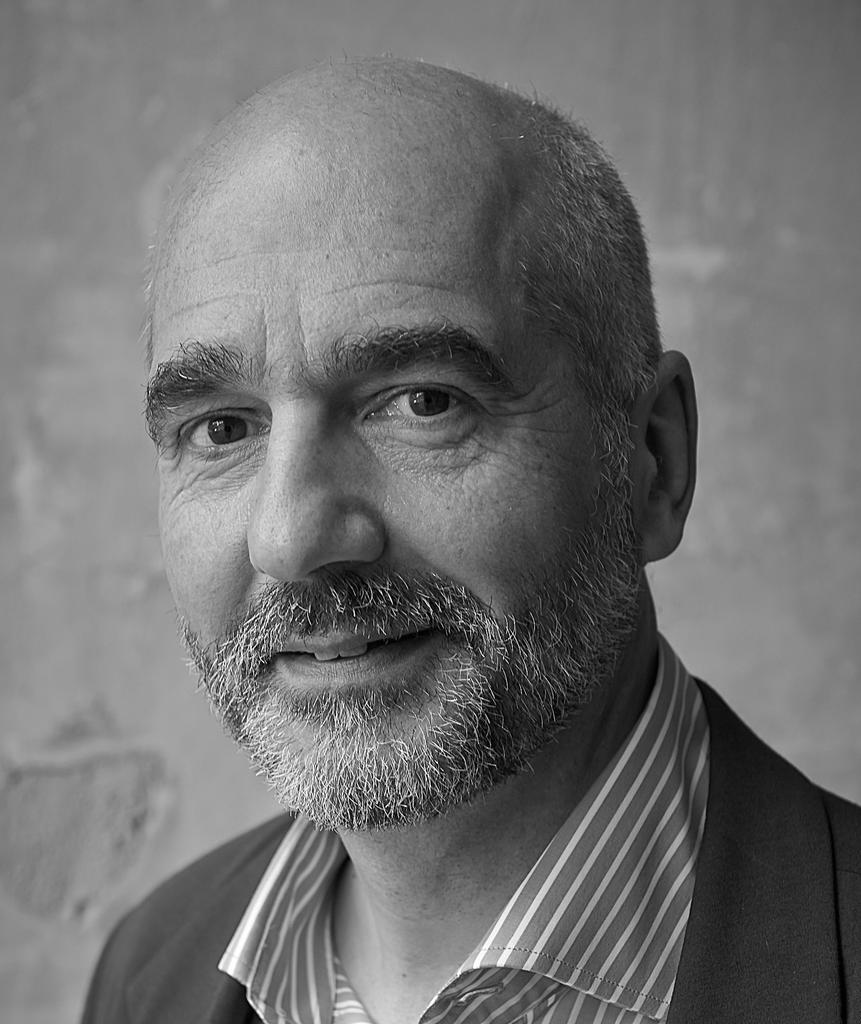Dans une interview que Dmitiri Tcherniakov a accordé à sa dramaturge et qui figure dans le programme du spectacle, le metteur en scène exprime ses craintes face au défi que lui a lancé le Festival de Salzbourg, à savoir s’attaquer pour la première fois à une œuvre baroque, un univers avec lequel il est peu familier. Il confesse également n’être jamais allé en Égypte et avoir tenté d’oublier tout ce qu’il savait de César et de Cléopatre ; de manière générale, il revendique souvent le droit d’ignorer son sujet pour garantir sa liberté de créateur. Le pari a-t-il été tenu ?
Dans les opéras de Haendel, les défis sont multiples : il y a d’abord la difficulté à réunir une distribution de solistes chevronnés, voix puissantes et rompues à l’art de la vocalise, nous y reviendrons. Il y a aussi les difficultés liées à la forme elle-même, une longue suite d’air – à peu près tous formatés sur le même schéma ABA – et de courts récitatifs qui concentrent le fil de l’action. Mais cette action n’est pas nécessairement faite pour être montrée, elle est seulement racontée, et ce récit contient suffisamment d’horreurs pour qu’à les imaginer, on puisse aisément se passer de les voir. Le propos de Haendel est de mettre en musique les sentiments des hommes et des femmes qui mènent ou subissent ces événements, qui doivent bien être extrêmes pour que les victoires soient plus éclatantes, les colères plus noires et les crimes plus horribles de sorte qu’on ait aussi les airs les plus éblouissants et les lamentos les plus beaux !
Tcherniakov, qui s’est toujours penché jusqu’ici sur des œuvres du XIXe ou du XXe siècle, dont la dynamique est tout autre, entend, lui, prendre tout cela au pied de la lettre et nous montrer l’horreur de la guerre par le menu, nous la faire vivre en direct, depuis les caves d’un immeuble transformé en refuge, à moins qu’il s’agisse des tunnels de Gaza, décor unique qui réunira tous les personnages du drame. De même, il s’attachera à montrer avec une complaisance malsaine les viols, crimes, inceste et autres violences insoutenables dont les évocations émaillent le livret ad nauseam. De ce regard sans illusion porté sur la nature humaine, le metteur en scène tire un constat désespéré qui ne peut conduire qu’à la fin du monde. Et c’est bien ce qu’il va nous montrer, puisqu’après avoir résolu de faire peur au spectateur (à défaut de pouvoir le charmer) en figurant peu avant l’entracte une attaque à la bombe plus vraie que nature, il termine son spectacle par une explosion cataclysmique débouchant sur le noir définitif. Exit l’humanité !
Aucune évocation de l’Egypte, ni celle d’aujourd’hui ni celle de l’Antiquité, César et Cléopatre pourraient être n’importe qui d’autre dans un contexte de guerre, détachés de toute référence historique. Le spectacle ne réussit pas non plus à donner une identité psychologique aux personnages – c’est une dimension non pertinente dans une œuvre de cette époque – et peine à les occuper pendant qu’ils chantent. Il leur accorde cependant une identité par le costume et par des attitudes très typées, faisant par exemple de Sesto un adolescent rebelle à peine sorti de l’enfance, et de Tolemeo un être veule au genre indécis, passablement névrosé et le visage enté d’une immense mèche blonde. A Cornelia, il n’octroie aucune grandeur, pas même celle du désespoir, pourtant si présente dans la magnifique musique de Haendel.
© SF Rittershaus
Ces partis étant pris, Tcherniakov a-t-il réussi son défi ? Sans doute pas entièrement. Le spectacle très monochrome est peu séduisant, en constant décalage esthétique et sémantique avec la musique, et renonce à trouver un fil à l’action qui se résume finalement en une suite de scènes décousues, ce que précisément il disait redouter dans l’interview, entrecoupées de quelques instants de noir absolu faute d’avoir trouvé comment les articuler l’une à l’autre. Mais il aura montré tant et plus, et avec une agressivité parfois difficile à supporter, les horreurs de la guerre et les outrances du récit, pour qui n’en serait pas encore convaincu.
Au plan musical, il faut saluer la qualité du travail d’orchestre très abouti mené par Emmanuelle Haïm à la tête de ses troupes du Concert d’Astrée, qui insuffle une énergie constante à son discours et soutien sans faillir la dynamique musicale de la soirée. Avec un grand souci du détail, une belle richesse d’exécution du continuo et animée d’un véritable amour de la partition, la cheffe signe ici une très belle performance. Emmanuelle Haïm avait déjà participé à deux reprises au Festival de Salzbourg : une première fois en 1999 en tant que claveciniste dans un production des Boréades de Rameau dirigée par Simon Rattle, et une deuxième fois en 2004, lorsqu’assistante de Rattle elle dirigea David et Jonathas de Charpentier au festival de Pâques. Elle y revient donc aujourd’hui par la grande porte et ne démérite pas.
Le casting vocal réunit quelques grandes pointures du chant baroque, mais les performances individuelles ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. La distribution est dominée comme il se doit par le César de Christophe Dumaux, le roi de la vocalise, qui maîtrise parfaitement les difficultés techniques du rôle, fait preuve de puissance vocale quand il le faut et nous campe un César barbu et viril très convaincant. Pour lui donner la réplique, il trouve une Cléopatre à se mesure en la personne de Olga Kulchynska, présentée d’abord comme une bimbo en perruque rose lorsqu’elle se cache sous les traits de sa suivante, puis sous les siens propres, ceux d’une très belle brune longiligne. La voix est magnifique, solaire, les vocalises sont aisées et brillantes, pour ces deux-là, le contrat est parfaitement rempli. Lucile Richardot, qui chante Cornelia, nous a paru en petite forme vocale. Ses vocalises manquent de fluidité et la voix parait peu homogène, avec un registre grave presque masculin manquant de moelleux et de grâce. Le cas de Federico Fioro est différent. Certes, ce jeune homme est fin musicien, en plus d’être un acrobate accompli. Ses agitations permanentes nuisent cependant à la ligne vocale et il allège tellement la voix pour réaliser ses vocalises qu’elle en devient presqu’inaudible et sans couleur. Il tente bien de faire de cette faiblesse une force et accentue le côté adolescent fragile submergé par ses émotions, essayant de trouver ainsi une cohérence au personnage ; on finirait presque par y croire, mais il faut vraiment tendre l’oreille… Le contre-ténor ukrainien Yuri Mynenko ne convainc pas non plus totalement dans le rôle de Tolomeo ; mixant constamment entre voix de tête et voix de poitrine, il peine à trouver un socle technique pour vocaliser à son aise. Sans homogénéité de timbre il ne parvient pas non plus à stabiliser son discours musical, qui s’en trouve dès lors fort décousu et peu crédible. Andrey Zhilikhovsky est un Achilla solide et efficace, mais peu investi par le metteur en scène. Les deux interventions du chœur, dont Tcherniakov n’a su que faire sur scène et qu’il a donc relégué dans les coulisses, furent parfaites, rien à redire, mais on aurait aimé les voir.
Fait tout à fait inhabituel à Salzbourg, il y avait quelques sièges vides au début de la représentation. Il y en eut encore d’avantage après la pause. Cela n’empêcha pas de solides applaudissements à la fin du spectacle, mais un seul rappel.