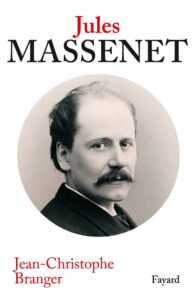En onze ans, les Dialogues des Carmélites mis en scène par Gilles Bouillon en 1999 à Tours et repris cette saison, n’ont pas pris une ride. Cela n’a rien de surprenant. Le sujet de l’opéra de Francis Poulenc, d’après la pièce éponyme de Georges Bernanos, n’autorise ni transposition, ni actualisation, ni interprétation qui, les années passant, pourraient en dater la représentation. Il y a d’ailleurs fort à parier que les images de la création milanaise (1957) ne nous paraitraient pas si démodées. La vision de Gilles Bouillon se montre donc proche de toutes celles que l’on a pu connaître, en accord avec la succession hiératique des douze tableaux de l’opéra, envisagés par le compositeur comme les douze stations de la Passion du Christ. Dépouillement des décors et sobriété des gestes soulignés par la lumière et relevés de quelques accessoires déjà vus ailleurs : les chaises empilées pour la scène de la chapelle profanée, les draps blancs que l’on tend sur un fil, que l’on froisse ou qui, roulés en boule, représentent lors du tableau final le chef des religieuses décapitées. A ce moment, les carmélites s’avancent tour à tour sur le devant de la scène, s’agenouillent et déposent sur le sol cette balle de tissus avant de s’effondrer foudroyées par le bruit de la guillotine. Dernière image dont la force participe depuis toujours au succès de l’œuvre et que Gilles Bouillon dans la note du programme explique vouloir baignée « dans la lumière d’un vaste cantique où malgré la scansion implacable du couperet, triomphe la Joie ». La Joie, thème si essentiel à Bernanos qu’il en a fait le titre d’un de ses livres. C’est dire si l’esprit est respecté à la lettre.
L’iconoclastie, on le cherchera plutôt du côté de la direction de Jean-Yves Ossonce à la tête d’un Orchestre Symphonique Région Centre-Tours qui occupe les loges sur le côté de la scène, en plus de la fosse, trop petite pour accueillir l’ensemble des instruments nécessaires à la partition. La clarté de la musique et le sens du texte sont respectés dans un juste équilibre entre fosse et plateau qui montre combien le chef d’orchestre connaît son théâtre et ses musiciens. Mais la rapidité avec laquelle il conduit le drame à son aboutissement surprend, entraînant une lecture sans épanchement, ni commisération, d’une fièvre maîtrisée au détriment d’une certaine religiosité.
Au sein d’une distribution homogène, à la diction suffisamment irréprochable pour rendre les surtitres superflus, on relève aussi quelques paradoxes qui ne sont pas tous pour nous déplaire mais qui modifient sensiblement la donne. Ainsi, l’une des figures les plus humaines de la pièce est celle de Mère Marie dont le timbre légèrement voilé de Marie-Thérèse Keller émousse la virulence.Poussée dans ses retranchement par une écriture qui sollicite l’aigu en force, la chanteuse apporte au rôle moins d’orgueil et plus de compassion que de coutume. Le rapport avec Madame Lidoine s’en trouve inversé. D’autant que le chant acéré de Mireille Delunsch, se réalise mieux dans l’affrontement que dans l’épanchement maternel. On prête souvent à la nouvelle Prieure une bonhommie rassurante que l’on attendra ici en vain. Derrière chaque inflexion, affleure la tragédienne. A rebours aussi de notre imagerie, Sophie Marin-Degor, superbe de ligne et de noblesse, possède un tranchant qui atténue la vulnérabilité de Blanche. De même, le Chevalier de Christophe Berry ne se dépare jamais de la raideur due à son rang, y compris dans un duo avec sa sœur, interprété de part et d’autre avec trop de rigidité pour que, derrière les notes, poigne la tendresse. Plus conformes à l’habitude, le Marquis de Didier Henry laisse au contraire, d’un ton assuré, transparaître ses sentiments et Sabine Revault d’Allonnes rayonne dans le rôle si touchant de Sœur Constance. Comme eux deux, Marie-Ange Todorovich s’inscrit dans la tradition. Faisant des blessures de sa voix celles de son personnage, elle joue de l’accent, de la couleur et des écarts de registre pour composer une première Prieure imposante dont l’agonie impressionne. Un tour de force qui – ultime pied de nez au culte établi – déporte l’acmé émotionnelle de l’opéra, de la fin du dernier acte à la fin du premier.